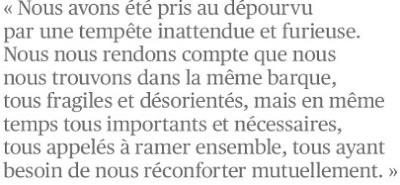Lecture d'un texte de Arnaud Desjardins :
mercredi 30 avril 2025
S'ouvrir à l'espérance
mardi 29 avril 2025
Acceptation de ce qui est
lundi 28 avril 2025
Rencontre avec le pape
Que François vous a-t-il apporté en tant que chrétien, en tant qu’écrivain ?
Le regard que François portait sur chaque chrétien était un regard de bienveillance et de fraternité. Il avait une merveilleuse écoute et il m’a confirmé cette idée que la foi est une liberté de penser, d’interpréter, de faire sien un message. Il légitimait cette part active : dégager la religion de l’obéissance pour la restituer à l’individu en pleine conscience, qui réfléchit, s’empare de l’histoire et des textes.
Ce qui est étonnant de la part d’un pape, censé être le gardien des interprétations et des canons. François avait cette ouverture-là. On échangeait sur des sujets où j’avais des positions très éloignées du dogme.
Pouvez-vous nous donner un exemple ?
J’ai pu lui parler de ma conception de Judas : pas du tout un traître mais le disciple préféré et celui qui se sacrifie par amour… « C’est très intéressant », m’avait dit François, dans un grand sourire. Et j’avais continué en expliquant qu’on évitait ainsi l’antisémitisme chrétien qui a prospéré à partir de l’idée de Judas, de la figure tentée par l’argent, etc.
Ce que je racontais était bien sûr de la fiction, mais François avait cette idée qu’elle ouvrait justement à la réflexion. C’est pourquoi il était très attentif aux écrivains et autres artistes.
Après le très beau discours sur l’art qu’il avait prononcé dans la chapelle Sixtine, il a publié le texte sur la littérature en juillet 2024 : une reconnaissance de l’importance de l’art dans la vie spirituelle. Et aussi du rôle des artistes pour communiquer, témoigner, dire autrement que l’Église. Ce qui a déclenché des réactions de détestation car, en somme, il « déclergisait » le message évangélique.
Je l’ai rencontré à travers cette caractéristique qui lui était essentielle. Il m’a invité à faire le voyage à Jérusalem, ce qui a été un formidable cadeau, et m’a permis de donner corps au défi de la fraternité sur une terre trois fois sainte et fratricide.
Vous êtes ensuite devenu un familier de la maison Sainte-Marthe, mais quand avez-vous rencontré François pour la première fois ?
Au terme du mois passé à Jérusalem, d’une richesse extrême sur les plans spirituel, historique, théologique. Le dernier jour, j’étais encore à la bibliothèque de l’École biblique, j’ai reçu un appel du Vatican : « IL vous attend. » Je suis allé au rendez-vous, nous nous sommes retrouvés seul à seul. Lui parlant en italien et moi en français, chacun comprenant l’autre. Un grand moment. Car qui étais-je pour qu’il ait envie de me rencontrer ?
Ce fut d’abord pour moi un étonnement enfantin, puis la conscience lucide que je suis un chrétien qui n’est pas à la hauteur des exigences du christianisme… J’étais impressionné face à la grande figure spirituelle, plus que l’homme de pouvoir, le chef d’un État et d’une Église sur toute la terre. C’était cet homme accompli spirituellement, qui pouvait me citer le Mémorial de Pascal en français par cœur et qui était capable de toutes les discussions. Cette légitimité qu’il donnait à l’autre m’a bouleversé.
Revenir de Jérusalem, la ville importante pour les trois monothéismes, c’était avoir ressenti le défi du « Écoutez-vous », après que Dieu a dit trois fois « Entendez-moi ». Se rendre compte que nous sommes frères. Le fratricide, c’est l’oubli de l’origine commune, que pratiquent les « grimaceurs » de chaque religion. François a tendu la main aux représentants du judaïsme et aux imams. Lui-même avait pris l’initiative, « ce ne sont pas eux qui m’ont couru après », nous confiait-il.
Qu’attendez-vous du prochain pape ?
Que perdure cet ébranlement spirituel qu’a provoqué François : il a bousculé l’édifice tout en ne voulant pas le briser, c’est pourquoi il a ralenti le train des réformes. Je pense que restera cette Église beaucoup plus proche des Évangiles, une Église qui n’est pas une fin en soi mais qui est mission, qui est service. Et puis une Église qui ne met pas au premier plan le magistère moral, qui intègre l’ouverture faite aux couples divorcés, aux homosexuels : j’espère que continuera ce respect des trajets de vie.
François avait une grande peur du schisme et tous les papes à venir vont se retrouver face aux deux fissures de notre temps : celle qui sépare traditionalistes et progressistes, celle qui éloigne le Nord et le Sud. Entre le désir de réconciliation et la nécessité d’avancer, tout pape sera désormais coincé.
Le catholicisme a ces deux tensions à l’intérieur de lui qui sont de plus en plus exacerbées : si un pape traditionaliste est élu, il aura la moitié de l’Église contre lui, de même si c’est un progressiste… François a été un grand pape empêché ! Tout ce qu’il a débusqué et devant quoi il a dû reculer est désormais clairement marqué.
Dans un monde de plus en plus chaotique, comptez-vous sur la force de résistance du prochain pape ?
Le christianisme est plus que jamais important, à l’heure où un nombre croissant de dirigeants n’affirment plus que deux choses : la force et l’argent. Et souvent la force au service de l’argent… La vocation même du christianisme, depuis Jésus au sein même de la société de son temps, est de lutter contre le règne de la force, le mercantilisme, le matérialisme de l’intérêt.
On dit aujourd’hui que l’Église est minoritaire, mais une force de résistance est toujours minoritaire. C’est comme la philosophie, face au fameux bon sens et aux préjugés. On a besoin de la dynamique que le christianisme représente et de la proposition d’un autre rapport social fondé sur le respect et l’affection, non sur la peur et l’intérêt. C’est encore plus inaudible aujourd’hui donc encore plus nécessaire. C’est la folie du christianisme d’être la religion de l’amour, dans un monde excessivement brutal.
Interview de Eric-Emmanuel Schmitt
--------------------------------------------
dimanche 27 avril 2025
Hommage et réconfort mutuel
samedi 26 avril 2025
La pratique Beat
Voici deux planches extraites de la BD sur la beat generation de Etienne Appert. Les dessins sont vraiment impressionnants.
vendredi 25 avril 2025
Quand la vie m'emmène
Je n'ai jamais l'impression que ce que je n'ai pas fait est non-accompli. Je vois les choses qui ne sont pas faites comme des choses qui nécessitent un autre timing ; le monde et moi sommes mieux sans ces choses, pour l'instant.
Cette vie ne m'appartient pas. La voix me dit : "Fais la vaisselle" – OK, je la fais. Je ne sais pas à quoi ça sert, je le fais, c'est tout. Si je n'exécute pas l'ordre, ce n'est pas grave. Mais c'est un jeu à propos de où la vie me mènera quand je suivrai les règles du jeu. Il n'y a rien de plus excitant que de dire oui à une chose aussi folle. Je n'ai rien à perdre. Je peux me permettre d'être idiote.
~ Byron Katie
-----------
jeudi 24 avril 2025
Bienvenue dans les réseaux asociaux
mercredi 23 avril 2025
Lucide et prêt
mardi 22 avril 2025
4 grands inévitables
Face à ces quatre grands inévitables que sont la souffrance, l’absurdité, la solitude et la mort, quelle fut l’attitude du Christ ?
Celle d’un être « capable de Dieu », c’est-à-dire de pure Présence, vivant la non-dualité et la non-violence avec tout ce qui est et tout ce qui arrive, libre de tout fatalisme, dans une plénitude de conscience et d’amour…
Y a-t-il d’autres chemins pour ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance, de l’absurdité à l’absurdité, de la solitude à la solitude, de la mort à la mort ?
La croix n’est-elle pas cette grande patience et cette extrême lucidité face à tous ces inévitables qui nous harcèlent ?
N’est-ce pas dans cette « lumière sanglante » que nous pouvons nous approcher de la « force invincible et vulnérable de l’humble amour » qui transforme nos impasses en issues ?
Découvrir qu’à côté de nos « morts fatales », il est une « mort pascale », une joyeuse et possible résurrection ?
Le temps n’a qu’un temps. Passe ce qui ne peut que passer. La Vie est éternelle !
Jean-Yves Leloup, Avril 2025
-----------------------------------
lundi 21 avril 2025
Joyeuses fêtes de Pâques à chacune et à chacun de vous !
Pour illustrer cette notion si mystérieuse de la Résurrection, voici celle - toute païenne - d'Orion, dans la mythologie grecque, le chasseur terrestre accidentellement tué par Diane-Artémis, puis transformé par ses soins en chasseur céleste, constellation brillante, à l'image de tout ce qui nous unit. Orion abandonne ici sa dépouille mortelle dans le cercle du O, la lettre de l'Ouverture infinie, pour y renaître en lumière, sous sa forme rayonnante.
Sabine Dewulf
Source : Illustration de Marie Dewulf, pour L'Oracle alphamythique - Sabine Dewulf et Antoine Charlet.
-----------------
dimanche 20 avril 2025
Passage vers le Royaume
De tout temps, l’homme a craint la mort. L’angoisse existentielle face à sa finitude s’inscrit dans son cœur dès qu’il sort de l’enfance, l’âge de raison signant l’ouverture de sa conscience au néant qui l’attend au bout de sa trajectoire. L’adolescent puis l’adulte auront à apprivoiser l’idée de la mort comme faisant partie intégrante de la vie afin d’accepter cette donnée inhérente à la condition humaine.
Cependant, là où nos ancêtres vivaient avec le sentiment prégnant qu’à chaque instant ils pouvaient quitter ce monde, l’espérance de vie d’antan étant beaucoup plus courte et aléatoire que la nôtre, les progrès techniques et médicaux permettent aujourd’hui de reculer toujours davantage le terme de notre parcours terrestre, incitant l’homme moderne à refuser l’ultime échéance et même à nourrir un rêve d’immortalité.
Dans cette lignée, à l’heure de l’intelligence artificielle, savez-vous qu’il est possible de « ressusciter » numériquement une personne disparue ? En Chine, aux États-Unis, au Japon, en Espagne, des entreprises, s’emparant de ce fantasme, proposent de recréer les caractéristiques d’un défunt (voix, apparence physique et tempérament) pour permettre à des particuliers de discuter virtuellement avec cet avatar post mortem.
Le réalisme de cette conversation apparaît aussi troublant que contestable sur le plan éthique. Si certains de nos contemporains peuvent être tentés de chercher un réconfort en recréant le dialogue avec un double informatique, est-il moralement et psychologiquement souhaitable de s’accrocher à une représentation artificielle d’un individu, forcément réductrice, aucun algorithme n’étant capable de copier la complexité d’une personnalité ?
Outre la question du respect de la volonté du défunt qui, par définition, ne peut consentir à ce que dit son fantôme virtuel, l’échange avec ce dernier risque de fabriquer une fausse relation et de faux souvenirs avec la personne disparue et d’exacerber le chagrin de la perte, en empêchant le nécessaire et salutaire travail de deuil.
La suprême Bonne Nouvelle
Aux antipodes du business de la « résurrection » numérique, l’espérance chrétienne nous invite à changer radicalement notre regard sur le sens de la finitude humaine. « C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il vient à mourir, vivra. Le vivant, celui qui croit en moi, ne mourra pas pour toujours » (Jean 11, 25-26), répond Jésus à Marthe, alors que cette dernière lui reproche de n’être pas venu secourir à temps son ami Lazare et de l’avoir laissé mourir.
La Pâque illustre de façon magistrale que la mort n’est pas pur néant mais marque le passage vers le royaume de Dieu, qu’à l’image du Christ, nous irons rejoindre. La résurrection du Fils nous ouvre grands les bras du Père, voilà la suprême Bonne Nouvelle ! De cette foi, naît une confiance inédite dans le processus de transmutation et de renaissance à l’œuvre en toute chose, reflet de la puissance céleste, auquel la mort participe. Riche de l’instant dont est fait le présent où s’illustre l’éternité de Dieu, l’existence se dévoile alors à nous dans sa majestueuse splendeur.
Loin de vivre dans la crainte de mourir, le Christ nous appelle à nous inscrire sereinement dans l’élan universel gouvernant le monde, qui nous emmène sans cesse vers la nouveauté du devenir et nous fait entrer en Vie dès ici-bas en cocréant avec le Créateur à travers l’expérience incandescente de son Amour.
Cécilia Dutter
Écrivaine et critique littéraire, elle a publié des romans, dont À toi, ma fille (Cerf), ainsi que des essais, dont Etty Hillesum, une voix dans la nuit (Robert Laffont) et Aimer d’un cœur de femme (Cerf).
-------------------
samedi 19 avril 2025
Cette douleur qui ne part pas
Tu crois que tu pleures une rupture. Tu crois que c’est la perte de l’autre qui t’écrase. Mais la vérité, c’est que chaque départ réveille quelque chose de bien plus ancien. Tu vis une fin… mais ton cœur, lui, revit un abandon. Un que tu n’as jamais su digérer. Celui de l’enfance. Celui où tu n’as pas été choisi. Pas écouté. Pas assez regardé. Et tu ne t’en rends même pas compte. Tu souffres aujourd’hui comme si c’était disproportionné… mais c’est simplement accumulé.
Chaque fois que tu t’attaches à quelqu’un, c’est comme si une partie de toi espérait secrètement que cette fois-ci, on va rester. Qu’on va t’aimer sans condition. Qu’on va réparer ce que d’autres ont cassé. Tu ne cherches pas seulement un partenaire. Tu cherches un refuge. Une preuve que tu vaux la peine. Et c’est ça le piège. Parce que tant que tu ne guéris pas cette blessure originelle, tu vas continuer à confondre l’amour avec le besoin d’être sauvé.
Et quand ça casse, ce n’est pas juste une histoire qui se termine. C’est un schéma qui se répète. Encore. Et encore. Tu te demandes pourquoi tu tombes toujours sur les mêmes types de personnes. Pourquoi tu souffres toujours autant. Pourquoi ça fait aussi mal. C’est parce que ce n’est pas elle ou lui que tu perds… c’est l’espoir que, cette fois, ça allait enfin réparer ce vide que tu traînes depuis l’enfance. Un vide que tu n’as jamais appris à remplir toi-même.
Tu vois, l’enfant en toi a été blessé un jour. Il s’est senti rejeté, invisible, pas assez bon. Et comme personne ne l’a rassuré à ce moment-là, il a grandi avec cette peur viscérale : celle de ne jamais être aimé pour de vrai. Depuis, à chaque relation, il tend les bras. Il dit : « S’il te plaît, choisis-moi. Reste. » Et quand ça s’écroule, il s’effondre avec. Ce n’est pas l’adulte en toi qui pleure. C’est cet enfant qu’on a laissé derrière.
Tu n’as pas besoin d’un amour parfait. Tu as besoin de te retrouver. De revenir vers toi. De reconnaître cette part de toi qui a été blessée, et de lui dire : « Tu n’es plus seul. Je suis là maintenant. » Parce que personne ne viendra guérir ça à ta place. Personne n’a ce pouvoir. Même l’amour le plus sincère ne suffira pas, si tu ne te donnes pas, toi aussi, cette présence que tu attends des autres depuis toujours.
Tu peux continuer à courir après des gens pour combler ce vide. Tu peux aussi décider de t’arrêter. De respirer. Et de regarder en face ce qui a vraiment besoin d’attention. Ton cœur. Ton histoire. Ton passé. Tu ne peux pas changer ce que tu as vécu. Mais tu peux arrêter d’en faire un automatisme. Tu peux transformer ce schéma en le regardant droit dans les yeux. Tu peux aimer autrement. Commencer par toi.
Parce qu’un jour, tu vas aimer sans avoir peur qu’on parte. Tu ne supplieras plus pour qu’on t’aime. Tu ne seras plus à genoux pour être choisi. Tu seras debout, solide, en paix. Tu sauras que tu es entier, même si l’autre s’en va. Et ce jour-là, l’enfant blessé en toi ne criera plus. Il sera fier. Fier de toi. Fier de la personne que tu es devenue. Fier que tu sois enfin rentré chez toi.
Francis Machabée
--------------------