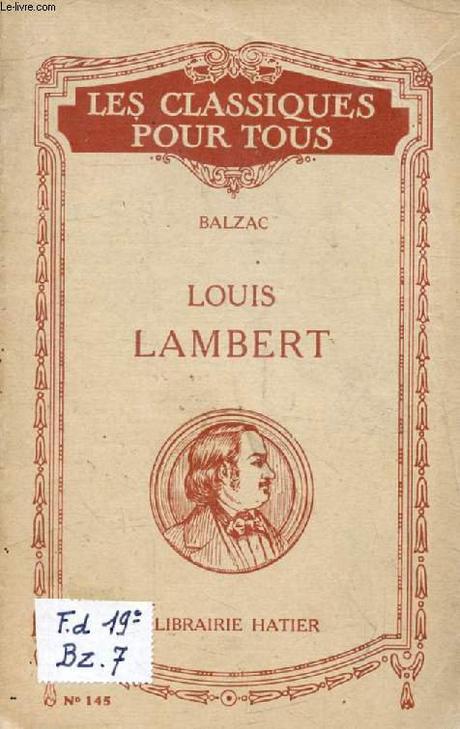
Avec ce roman, Balzac a voulu faire oeuvre de savant et de penseur. Il a cherché à systématiser les velléités philosophiques de ses premières années. De 1832 à 1846, le roman a été publié sept fois. Les premières éditions furent à ce point remaniées qu'à peine peut-on parler de la même oeuvre. Louis Lambert et le Père Goriot sont, dans l'optique de la Comédie humaine, des oeuvres complémentaires, contemporaines, et à situer sur le même plan. À l'invention unificatrice du retour des personnages, à la dramaturgie unitaire de la société fictive, s'ajoute une spéculation sur les rapports de l'homme et du cosmos. La quête de Louis Lambert est une affaire sérieuse, une affaire de vie et de mort. La promenade au manoir de Rochambeau est pour Lambert l'occasion d'une expérience : ce château qu'il voit pour la première fois, un rêve le lui a déjà montré. Mais Lambert ne sait pas tirer parti de « cette soudaine clarté ». Quand la raison s'acharne sur cet instant incomparable, il lui échappe, il se dilue dans une analyse qui n'a pas de mots pour le décrire. De cette expérience que Lambert appelle un « témoignage », il voudrait extraire un concept : il la transforme alors et l'abstraction la dénature. Emporté par son ambition, Lambert perd le contrôle de sa découverte, quand au contraire il devrait, à partir de l'image ambiguë du manoir de Rochambeau, isoler dans le doute universel sa pure perception de l'être spirituel comme mouvement et comme volonté, pour en faire la pierre de touche de son système. Il semble que Lambert n'arrive pas à combler l'abîme qui sépare son expérience et l'idée de volonté. Aussi son Traité de la volonté, en tant qu'oeuvre philosophique, n'est sans doute qu'une vaste construction de l'intelligence avec tout l'arbitraire qui s'attache à ce genre de tentative. Lambert dont la première tentation est un rêve de puissance (comme Raphaël dans la Peau de chagrin, qui, lui aussi, écrivait une Théorie de la volonté) croit toucher à Rochambeau la force mystérieuse dont la maîtrise lui donnerait le pouvoir d'éluder les servitudes de notre condition. Il sait qu'à de certains instants qu'il s'agit de reproduire, l'esprit se détache du corps, abolit l'espace et le temps, pénètre même la matière selon des lois inconnues.
On devine que les théories de Balzac-Lambert sont bien moins une explication de notre univers qu'une justification du sien, dont elles dévoilent peut-être l'architecture morale. Lambert s'efforce d'imposer une explication globale du monde inspirée sans doute à Balzac par la conception mesmérienne de l'unité de la substance cosmique. L'homme, selon Lambert, doit s'élever de la sphère de l'instinct à celle de l'abstraction. Balzac emprunte à Swedenborg le langage et l'imagerie de ces croyances encore un peu confuses qui ne trouveront leur expression que dans les pages lumineuses de Séraphîta. Balzac décrit en Louis Lambert une maladie réelle de l'âme, dont il note non seulement les phases psychologiques mais aussi les manifestations somatiques avec une telle précision et une telle acuité que des spécialistes lui ont fait l'honneur d'avoir le premier rédigé l'observation clinique d'un cas de schizophrénie. Louis Lambert est le récit d'une aventure mystique, et le héros, un ange égaré qui cherche par la raison, puis par l'amour, la porte du ciel.
Louis Lambert est un roman auquel Balzac attachait un grand prix et qui mérite de retenir l'attention par sa valeur autobiographique et par les lumières singulières qu'il jette sur la structure spirituelle de la Comédie humaine.
Louis Lambert naquit en 1797 à Montoire. Son père exploitait une tannerie de médiocre importance et comptait faire de lui son successeur. Mais les dispositions qu'il manifesta prématurément pour l'étude modifièrent cet arrêt paternel. L'Ancien et le Nouveau Testament étaient tombés entre les mains de Louis quand il avait cinq ans. Cela avait décidé de sa destinée. Louis parcourut Montoire à la recherche de livres qu'il obtint à la faveur de ces séductions dont le secret n'appartient qu'aux enfants. Il fut sauvé de la conscription en 1807 en étant renvoyé chez son oncle maternel qui était curé de Mer près de Blois. Il resta trois ans chez son oncle qui était un vieil oratorien assez instruit.
En 1811, Louis entra au collège de Vendôme. Il fut entretenu aux frais de Mme de Staël. Il devait la protection de cette femme célèbre au hasard ou sans doute à la Providence. Il passait ses vacances dans la maison paternelle. Il prenait des livres pour aller méditer au fond des bois et se dérober ainsi aux remontrances de sa mère laquelle pensait que ces constantes études paraissaient dangereuses. Admirable instinct de mère ! Il prenait plaisir à lire des dictionnaires. L'analyse d'un mot, sa physionomie, son histoire étaient pour Lambert l'occasion d'une longue rêverie. Louis pensait que par leur seule physionomie, les mots ranimaient dans notre cerveau les créatures auxquelles ils servaient de vêtements. La passion de Louis pour la lecture avait été fort bien servie. Le curé de Mer possédait environ deux à trois mille volumes. Ce trésor provenait des pillages faits pendant la Révolution dans les abbayes et les châteaux voisins. L’absorption des idées par la lecture était devenue chez Louis un phénomène curieux ; son œil embrassait sept à huit lignes d’un coup, et son esprit en appréciait le sens avec une vélocité pareille à celle de son regard ; souvent même un mot dans la phrase suffisait pour lui en faire saisir le suc. Sa mémoire était prodigieuse. Il se souvenait avec une même fidélité des pensées acquises par la lecture et de celles que la réflexion ou la conversation lui avaient suggérées. Enfin il possédait toutes les mémoires : celles des lieux, des noms, des mois, des choses et des figures. À l’âge de douze ans, son imagination, stimulée par le perpétuel exercice de ses facultés, s’était développée au point de lui permettre d’avoir des notions si exactes sur les choses qu’il percevait par la lecture seulement, que l’image imprimée dans son âme n’en eût pas été plus vive s’il les avait réellement vues ; soit qu’il procédât par analogie, soit qu’il fût doué d’une espèce de seconde vue par laquelle il embrassait la nature. Quand il employait ainsi toutes ses forces dans une lecture, il perdait en quelque sorte la conscience de sa vie physique, et n’existait plus que par le jeu tout-puissant de ses organes intérieurs dont la portée s’était démesurément étendue : il laissait, suivant son expression, l’espace derrière lui. Un grand penchant l’entraînait vers les ouvrages mystiques. Cette prédilection lui fut fatale. Ce goût pour les choses du ciel, autre locution qu’il employait souvent, était dû peut-être à l’influence exercée sur son esprit par les premiers livres qu’il lut chez son oncle. Cette étude, ce goût élevèrent son cœur, le purifièrent, l’ennoblirent, lui donnèrent appétit de la nature divine, et l’instruisirent des délicatesses presque féminines qui sont instinctives chez les grands hommes. Grâce à ces premières impressions, Louis resta pur au collège. Cette noble virginité de sens eut nécessairement pour effet d’enrichir la chaleur de son sang et d’agrandir les facultés de sa pensée.
La baronne de Staël, bannie à quarante lieues de Paris, vint passer plusieurs mois de son exil dans une terre située près de Vendôme. Un jour, en se promenant, elle rencontra sur la lisière du parc Louis presque en haillons, absorbé par un livre. Ce livre était une traduction du CIEL ET DE L ’ENFER. À cette époque, MM. Saint-Martin, de Gence et quelques autres écrivains français, à moitié allemands, étaient presque les seules personnes qui, dans l’empire français, connussent le nom de Swedenborg. Étonnée, madame de Staël prit le livre avec cette brusquerie qu’elle affectait de mettre dans ses interrogations, ses regards et ses gestes ; puis, lançant un coup d’œil à Lambert : – Est-ce que tu comprends cela ? lui dit-elle. Il lui demanda si elle comprenait dieu en guise de réponse. Ils discutèrent. Elle le considéra comme un « vrai voyant ». Madame de Staël voulut arracher Louis Lambert à l’Empereur et à l’Église, pour le rendre à la noble destinée qui, disait-elle, l’attendait ; car elle en faisait déjà quelque nouveau Moïse sauvé des eaux. Elle chargea l’un de ses amis, monsieur de Corbigny, alors préfet à Blois, de mettre en temps utile son Moïse au collège de Vendôme ; puis elle l’oublia probablement. Louis sortit du collège à 17 ans en 1814. Il avait achevé sa philosophie. Corbigny quitta Blois au même moment et Mme de Staël perdit tout contact avec son protégé. Louis Lambert se trouvait à cette époque et trop pauvre et trop fier pour rechercher sa bienfaitrice, qui voyageait à travers l’Europe. Néanmoins il vint à pied de Blois à Paris dans l’intention de la voir, et arriva malheureusement le jour où la baronne mourut. Le collège de Vendôme où Louis reçut son instruction était tenu par des Oratoriens. Une fois entrés, les élèves ne sortaient du collège qu’à la fin de leurs études. Les vacances externes étaient interdites. Les punitions jadis inventées par la Compagnie de Jésus, et qui avaient un caractère aussi effrayant pour le moral que pour le physique, étaient demeurées dans l’intégrité de l’ancien programme du collège. Les lettres aux parents étaient obligatoires à certains jours, aussi bien que la confession. Ainsi les péchés et les sentiments des collégiens se trouvaient en coupe réglée. Les deux ou trois cents élèves que pouvait loger le collège étaient divisés, suivant l’ancienne coutume, en quatre sections, nommées les Minimes, les Petits, les Moyens et les Grands. La division des Minimes embrassait les classes désignées sous le nom de huitième et septième ; celle des Petits, la sixième, la cinquième et la quatrième ; celle des Moyens, la troisième et la seconde ; enfin celle des Grands, la rhétorique, la philosophie, les mathématiques spéciales, la physique et la chimie. Chacun de ces collèges particuliers possédait son bâtiment, ses classes et sa cour dans un grand terrain commun sur lequel les salles d’étude avaient leur sortie. Les élèves se retrouvaient tous au réfectoire où ils avaient le droit de parler en mangeant. Pour adoucir la vie des collégiens, privés de toute communication avec le dehors et sevrés des caresses de la famille, les Pères leur permettaient d’avoir des pigeons et des jardins. Un commerce avait été introduit par la boutique établie dans l’intérieur des cours. Cette boutique était tenue par une espèce de maître Jacques auquel grands et petits pouvaient demander, suivant le prospectus : boîtes, échasses, outils, pigeons cravatés, pattus, livres de messe (article rarement vendu), canifs, papiers, plumes, crayons, encre de toutes les couleurs, balles, billes ; enfin le monde entier des fascinantes fantaisies de l’enfance. Un nouveau venu dans cet établissement si cloisonné était un événement. L’arrivée de Louis Lambert fut le texte d’un conte digne des Mille et une Nuits. Le père Haugoult se mit donc à raconter fort complaisamment les singuliers événements qui allaient, le lendemain, valoir aux collégiens le plus extraordinaire des Nouveaux. Aussitôt les jeux cessèrent. Tous les Petits arrivèrent en silence pour écouter l’aventure de ce Louis Lambert, trouvé, comme un aérolithe, par madame de Staël au coin d’un bois. Après l’avoir examiné, monsieur Mareschal, le directeur des études, avait hésité, disait le père Haugoult, à le mettre chez les Grands. La faiblesse de Louis en latin l’avait fait rejeter en quatrième, mais il sauterait sans doute une classe chaque année ; par exception, il devait être de l’académie. Louis aurait un habit décoré du ruban rouge que portaient les académiciens de Vendôme. Aux académiciens étaient octroyés de brillants privilèges ; ils dînaient souvent à la table du Directeur, et tenaient par an deux séances littéraires auxquelles assistaient les collégiens pour entendre leurs œuvres. Un académicien était un petit grand homme. Les académiciens devaient tenir tous les jeudis, pendant les vacances, des séances publiques, et lire aux collégiens des contes en vers ou en prose, des épîtres, des traités, des tragédies, des comédies ; compositions interdites à l’intelligence des classes secondaires. Louis serait un futur génie, disait le père Haugoult. Les élèves voulurent être son faisant. Dans le langage collégial, ce mot être faisants constituait un idiotisme difficile à traduire. Il exprimait un partage fraternel des biens et des maux de la vie enfantine, une promiscuité d’intérêts fertile en brouilles et en raccommodements, un pacte d’alliance offensive et défensive. Le narrateur ne put dormir avant l’arrivée de Louis. Il en parla à son voisin de dortoir Barchou de Penhoën, futur officier, puis écrivain à hautes vues philosophiques. Jaloux de soutenir son rôle, Barchou nia les facultés de Lambert ; tandis qu’ayant nouvellement lu les Enfants célèbres, le narrateur l’accabla de preuves en lui citant le petit Montcalm, Pic de La Mirandole, Pascal, enfin tous les cerveaux précoces. Le narrateur avait un précepteur, le bibliothécaire du collège car son père rêvait de le voir entrer à l’Ecole Polytechnique. Mais il n’étudiait pas les mathématiques et continuait ses lectures et ses poèmes. Il devint l’écolier le moins agissant, le plus paresseux, le plus contemplatif de la Division des Petits, et partant le plus souvent puni. Il allait donc rencontrer un compagnon de rêverie et de méditation avec Louis Lambert. Le père Haugoult plaça Louis à côté du narrateur le lendemain dans la salle de classe.
Lambert, ou calme ou abasourdi, ne répondit à aucune des questions de ses camarades. L’un d’eux dit alors que Lambert sortait sans doute de l’école de Pythagore. Un rire général éclata. Le Nouveau fut surnommé Pythagore pour toute sa vie de collège. Cependant le regard perçant de Lambert, le dédain peint sur sa figure pour les enfantillages de ses camarades en désaccord avec la nature de son esprit, l’attitude aisée dans laquelle il restait, sa force apparente en harmonie avec son âge, imprimèrent un certain respect aux plus mauvais sujets du collège. Louis était un enfant maigre et fluet, haut de quatre pieds et demi ; sa figure halée, ses mains brunies par le soleil paraissaient accuser une vigueur musculaire que néanmoins il n’avait pas à l’état normal. Deux mois après son entrée au collège, quand le séjour de la classe lui eut fait perdre sa coloration presque végétale, les collégiens le virent devenir pâle et blanc comme une femme. Sa tête était d’une grosseur remarquable. Ses cheveux, d’un beau noir et bouclés par masses, prêtaient une grâce indicible à son front, dont les dimensions avaient quelque chose d’extraordinaire. Mais il était difficile de songer à sa figure, d’ailleurs fort irrégulière, en voyant ses yeux, dont le regard possédait une magnifique variété d’expression et qui paraissaient doublés d’une âme. Tantôt clair et pénétrant à étonner, tantôt d’une douceur céleste, ce regard devenait terne, sans couleur pour ainsi dire, dans les moments où il se livrait à ses contemplations. Habituellement il était incapable de supporter la fatigue des moindres jeux, et semblait être débile, presque infirme. Mais, pendant les premiers jours de son noviciat, un des matadors du collège s’étant moqué de cette maladive délicatesse qui le rendait impropre aux violents exercices en vogue dans le collège, Lambert prit de ses deux mains et par le bout une des tables qui contenait douze grands pupitres encastrés sur deux rangs et en dos d’âne, il s’appuya contre la chaire du Régent ; puis il retint la table par ses pieds en les plaçant sur la traverse d’en bas, et dit : – Mettez-vous dix et essayez de la faire bouger ! il fut impossible de lui arracher la table. Lambert possédait le don d’appeler à lui, dans certains moments, des pouvoirs extraordinaires, et de rassembler ses forces sur un point donné pour les projeter.
Les enfants habitués, aussi bien que les hommes, à juger de tout d’après leurs premières impressions, n’étudièrent Louis que pendant les premiers jours de son arrivée ; il démentit alors entièrement les prédictions de madame de Staël, en ne réalisant aucun des prodiges que les collégiens attendaient de lui. Après un trimestre d’épreuves, Louis passa pour un écolier très ordinaire. Seul le narrateur fut admis à pénétrer dans cette âme sublime. La conformité de leurs goûts et de leurs pensées les rendit amis et Faisants. Leur fraternité devint si grande que leurs camarades accolèrent leurs deux noms ; l’un ne se prononçait pas sans l’autre ; et, pour appeler l’un de nous, ils criaient : Le Poète-et-Pythagore ! Ainsi il demeura pendant deux années l’ami de collège du pauvre Louis Lambert ; et sa vie se trouva, pendant cette époque, assez intimement unie à la sienne pour qu’il lui soit possible d’écrire son histoire intellectuelle. Il ignora la poésie et les richesses cachées dans le cœur et sous le front de son camarade : il fallut qu’il arrive à trente ans, pour qu’il comprenne la portée des phénomènes desquels il fut alors l’inhabile témoin. Le temps seul lui fit donc pénétrer le sens des événements et des faits qui abondaient en cette vie inconnue. Pendant les premiers mois de son séjour à Vendôme, Louis devint la proie d’une maladie dont les symptômes furent imperceptibles à l’œil de ses surveillants, et qui gêna nécessairement l’exercice de ses hautes facultés. Habitué à penser sous le soleil, il lui fut bien difficile de se plier à la règle du collège, de marcher dans le rang, de vivre entre les quatre murs d’une salle où quatre-vingts jeunes gens étaient silencieux. Ses sens possédaient une perfection qui leur donnait une exquise délicatesse, et tout souffrit chez lui de cette vie en commun. Les exhalaisons par lesquelles l’air était corrompu, mêlées à la senteur d’une classe toujours sale et encombrée des débris de déjeuners ou de goûters, affectèrent son odorat. Nettoyé une seule fois par jour, avant le réveil des collégiens, le local demeurait toujours malpropre. Puis, malgré le nombre des fenêtres et la hauteur de la porte, l’air y était incessamment vicié par les émanations du lavoir, par la peignerie, par la baraque, par les mille industries de chaque écolier. La tête toujours appuyée sur sa main gauche et le bras accoudé sur son pupitre, Louis passait les heures d’étude à regarder dans la cour le feuillage des arbres ou les nuages du ciel ; il semblait étudier ses leçons ; mais voyant sa plume immobile ou sa page restée blanche, le Régent lui criait : Vous ne faites rien, Lambert ! Ce : Vous ne faites rien, était un coup d’épingle qui blessait Louis au cœur. Puis il ne connut pas le loisir des récréations, il eut des pensum à écrire. Le pensum, punition dont le genre varie selon les coutumes de chaque collège, consistait à Vendôme en un certain nombre de lignes copiées pendant les heures de récréation. Lambert et le narrateur furent, si accablés de pensum, qu’ils n’eurent pas six jours de liberté durant leurs deux années d’amitié. Leur mémoire était si belle qu’ils n’apprenaient jamais leurs leçons. Il leur suffisait d’entendre réciter à leurs camarades les morceaux de français, de latin ou de grammaire, pour les répéter à leur tour ; mais si par malheur le maître s’avisait d’intervertir les rangs et de les interroger les premiers, souvent Louis et son ami ignoraient en quoi consistait la leçon : le pensum arrivait alors malgré leurs plus habiles excuses. Enfin, ils attendaient toujours au dernier moment pour faire leurs devoirs. Avaient-ils un livre à finir, étaient-ils plongés dans une rêverie, le devoir était oublié : nouvelle source de pensum !
Louis avait la manie de jouer avec ses souliers et les détruisait en peu de temps. Son teint de femme, la peau de ses oreilles, ses lèvres se gerçaient au moindre froid. Ses mains si molles, si blanches, devenaient rouges et turgides. Il s’enrhumait constamment. Louis fut donc enveloppé de souffrances jusqu’à ce qu’il eût accoutumé sa vie aux mœurs vendômoises. Il lui fallut prendre soin de sa baraque, de son pupitre, de ses habits, de ses souliers ; ne se laisser voler ni son encre, ni ses livres, ni ses cahiers, ni ses plumes. L’amour-propre offensé parlait chez le maître par sa férule. Parmi les souffrances physiques auxquelles les élèves étaient soumis, la plus vive était certes celle que leur causait cette palette de cuir, épaisse d’environ deux doigts, appliquée sur leurs faibles mains de toute la force, de toute la colère du Régent. Pour recevoir cette correction classique, le coupable se mettait à genoux au milieu de la salle. Il fallait se lever de son banc, aller s’agenouiller près de la chaire, et subir les regards curieux, souvent moqueurs de ses camarades. Selon les caractères, les uns criaient en pleurant à chaudes larmes, avant ou après la férule ; les autres en acceptaient la douleur d’un air stoïque ; mais, en l’attendant, les plus forts pouvaient à peine réprimer la convulsion de leur visage. Louis Lambert fut accablé de férules, et les dut à l’exercice d’une faculté de sa nature dont l’existence lui fut pendant longtemps inconnue. Lorsqu’il était violemment tiré d’une méditation par le Vous ne faites rien ! du Régent, il lui arriva souvent, à son insu d’abord, de lancer à cet homme un regard empreint de mépris sauvage, chargé de pensée comme une bouteille de Leyde est chargée d’électricité. Cette œillade causait sans doute une commotion au maître, qui, blessé par cette silencieuse épigramme, voulut désapprendre à l’écolier ce regard fulgurant. Louis Lambert souffrit donc par tous les points où la douleur a prise sur l’âme et sur la chair. Attaché sur un banc à la glèbe de son pupitre, frappé par la férule, frappé par la maladie, affecté dans tous ses sens, pressé par une ceinture de maux, tout le contraignit d’abandonner son enveloppe aux mille tyrannies du collège. Semblable aux martyrs qui souriaient au milieu des supplices, il se réfugia dans les cieux que lui entrouvrait sa pensée. Peut-être cette vie tout intérieure aida-t-elle à lui faire entrevoir les mystères auxquels il eut tant de foi. L’indépendance de Louis et de son ami, leurs occupations illicites, leur fainéantise apparente, l’engourdissement dans lequel ils restaient, leurs punitions constantes, leur répugnance pour leurs devoirs et leurs pensums, leurs valurent la réputation incontestée d’être des enfants lâches et incorrigibles. Leurs maîtres les méprisèrent, et ils tombèrent également dans le plus affreux discrédit auprès de leurs camarades. Étrangers aux jouissances de nos camarades, ils restaient seuls, mélancoliquement assis sous quelque arbre de la cour. Le Poète-et-Pythagore furent donc une exception, une vie en dehors de la vie commune. L’amour-propre si délicat des écoliers leur fit pressentir en Louis et son ami des esprits situés plus haut ou plus bas que ne l’étaient les leurs. De là, chez les uns, haine de leur muette aristocratie ; chez les autres, mépris de leur inutilité. Cette situation excentrique les mit en état de guerre avec les enfants de leur Division. Presque toujours oubliés, ils demeuraient là tranquilles, heureux à demi, semblables à deux végétations, à deux ornements qui eussent manqué à l’harmonie de la salle. Mais parfois les plus taquins de leurs camarades les insultaient pour manifester abusivement leur force, et ils répondaient par un mépris qui souvent fit rouer de coups le Poète-et-Pythagore. La nostalgie de Lambert dura plusieurs mois. Après être resté longtemps à contempler le feuillage d’un des tilleuls de la cour, Louis ne disait qu’un mot à son ami, mais ce mot annonçait une immense rêverie. Plein de mépris pour les études presque inutiles auxquelles ils étaient condamnés, Louis marchait dans sa route aérienne, complètement détaché des choses qui les entouraient. Obéissant au besoin d’imitation qui domine les enfants, le narrateur tâchait de conformer son existence à celle de Louis. Ils s’habituèrent comme deux amants, à penser ensemble, à se communiquer leurs rêveries. Louis développa sa philosophie. Il pensait que toute science humaine reposait sur la déduction, qui est une vision lente par laquelle on descend de la cause à l’effet, par laquelle on remonte de l’effet à la cause ; ou, dans une plus large expression, toute poésie comme toute œuvre d’art procède d’une rapide vision des choses. Il était spiritualiste. Le narrateur considérait l’intelligence comme un produit tout physique. Les études de Louis sur la substance de la pensée lui faisaient accepter avec une sorte d’orgueil la vie de privations à laquelle les condamnaient et leur paresse et leur dédain pour leurs devoirs. La vie des deux amis était donc toute végétative en apparence, mais ils existaient par le cœur et par le cerveau. Les sentiments, les pensées étaient les seuls événements de leur vie scolaire. Lambert exerça sur l’imagination du narrateur une influence de laquelle il se ressentit encore bien plus tard.
La passion de Louis pour les mystères et la crédulité naturelle au jeune âge les entraînaient souvent à parler du Ciel et de l’Enfer. Louis tâchait alors, en expliquant au narrateur Swedenborg, de lui faire partager ses croyances relatives aux anges. Il y aurait en nous deux créatures distinctes. Selon Swedenborg, l’ange serait l’individu chez lequel l’être intérieur réussit à triompher de l’être extérieur. Un homme veut-il obéir à sa vocation d’ange, dès que la pensée lui démontre sa double existence, il doit tendre à nourrir la frêle et exquise nature de l’ange qui est en lui. Si, faute d’avoir une vue translucide de sa destinée, il fait prédominer l’action corporelle au lieu de corroborer sa vie intellectuelle, toutes ses forces passent dans le jeu de ses sens extérieurs, et l’ange périt lentement par cette matérialisation des deux natures. Dans le cas contraire, s’il substante son intérieur des essences qui lui sont propres, l’âme l’emporte sur la matière et tâche de s’en séparer. Quand leur séparation arrive sous cette forme que nous appelons la Mort, l’ange, assez puissant pour se dégager de son enveloppe, demeure et commence sa vraie vie. Les individualités infinies qui différencient les hommes ne peuvent s’expliquer que par cette double existence. Louis pensait que la distance se trouvant entre un homme dont l’intelligence inerte le condamne à une apparente stupidité, et celui que l’exercice de sa vue intérieure a doué d’une force quelconque, devait nous faire supposer qu’il pouvait exister entre les gens de génie et d’autres êtres la même distance qui sépare les Aveugles des Voyants. La doctrine de Swedenborg serait donc l’ouvrage d’un esprit lucide qui aurait enregistré les innombrables phénomènes par lesquels les anges se révèlent au milieu des hommes. Louis expliquait tout par son système sur les anges. Pour lui, l’amour pur, l’amour comme on le rêve au jeune âge, était la collision de deux natures angéliques. Aussi rien n’égalait-il l’ardeur avec laquelle il désirait rencontrer un ange-femme.
Il n’existait aucune distinction entre les choses qui venaient de Louis et celles qui venaient du narrateur. Ils contrefaisaient mutuellement leurs deux écritures, afin que l’un pût faire, à lui seul, les devoirs de tous les deux. Mais, pris l’un et l’autre pour deux idiots, le professeur analysait toujours leurs devoirs sous l’empire d’un préjugé fatal, et les réservait même pour en amuser leurs camarades. Madame de Staël causait, en partie, le malheur de Lambert. À tout propos maîtres et disciples lui jetaient ce nom à la tête, soit comme une ironie, soit comme un reproche. Louis et son ami s’arrangeaient pour se retrouver enfermés ensemble dans la « prison » du collège. Là, plus libres que partout ailleurs, ils pouvaient parler pendant des journées entières, dans le silence des dortoirs où chaque élève possédait une niche de six pieds carrés, dont les cloisons étaient garnies de barreaux par le haut, dont la porte à claire-voie se fermait tous les soirs, et s’ouvrait tous les matins sous les yeux du Père chargé d’assister à leur lever et à leur coucher. Cependant, la lecture leur étant interdite, les heures de prison appartenaient ordinairement à des discussions métaphysiques ou au récit de quelques accidents curieux relatifs aux phénomènes de la pensée. Selon la jurisprudence des collèges, le dimanche et le jeudi étaient les jours de congé ; mais les offices, auxquels les élèves assistaient très exactement, employaient si bien le dimanche, que les élèves considéraient le jeudi comme leur seul jour de fête. La messe une fois entendue, ils avaient assez de loisir pour rester longtemps en promenade dans les campagnes situées aux environs de Vendôme. Le manoir de Rochambeau était l’objet de la plus célèbre de leurs excursions, peut-être à cause de son éloignement. En 1812, vers la fin du printemps, Louis et son ami durent y aller pour la première fois. Le désir de voir le fameux château de Rochambeau dont le propriétaire donnait quelquefois du laitage aux élèves, les rendit tous sages. Louis Lambert dit au narrateur : – Mais j’ai vu cela cette nuit en rêve ! Il reconnut et le bouquet d’arbres sous lequel ils étaient, et la disposition des feuillages, la couleur des eaux, les tourelles du château, les accidents, les lointains, enfin tous les détails du site qu’il apercevait pour la première fois. Si Lambert pressentait d’ailleurs par la toute-puissance de sa pensée l’importance des faits, il était loin de deviner d’abord leur entière portée ; aussi commença-t-il par être étonné de celui-ci. Le narrateur lui demanda s’il n’était pas venu à Rochambeau pendant son enfance, la question le frappa ; mais, après avoir consulté ses souvenirs, il répondit négativement. Il sut en déduire tout un système, en s’emparant, comme fit Cuvier dans un autre ordre de choses, d’un fragment de pensée pour reconstruire toute une création. Louis croyait être à Rochambeau pendant qu’il dormait dans son alcôve, ce fait constituait donc une séparation complète entre son corps et son être intérieur. Si son esprit et son corps avaient pu se quitter pendant le sommeil, pourquoi ne les ferait-il pas également divorcer ainsi pendant la veille. Il en déduisit que si, pendant la nuit, les yeux fermés, il avait vu en lui-même des objets colorés, si il avait entendu des bruits dans le plus absolu silence, et sans les conditions exigées pour que le son se forme, si dans la plus parfaite immobilité il avait franchi des espaces, alors l’homme aurait des facultés internes, indépendantes des lois physiques extérieures. La nature matérielle serait pénétrable par l’esprit. Louis croyait qu’il serait célèbre avec sa découverte – Mais son ami aussi. Ils seraient tous deux les chimistes de la volonté. Louis partagea avec le narrateur les trésors de sa pensée, le compta pour quelque chose dans ses découvertes, et le laissa en propre ses infirmes réflexions. Il commença le lendemain même un ouvrage qu’il intitula Traité de la Volonté ; ses réflexions en modifièrent souvent le plan et la méthode ; mais l’événement de cette journée solennelle en fut certes le germe. Après six mois d’une application soutenue, les travaux de Lambert excitèrent la curiosité de ses camarades et furent l’objet de quelques plaisanteries cruelles qui devaient avoir une funeste issue. L’un des persécuteurs de Louis et de son ami, qui voulut absolument voir leurs manuscrits, ameuta quelques-uns des tyrans, et vint s’emparer violemment d’une cassette où était déposé ce trésor que Lambert et son ami défendirent avec un courage inouï. La boîte était fermée, il fut impossible aux agresseurs de l’ouvrir ; mais ils essayèrent de la briser dans le combat. Attiré par le bruit de la bataille, le père Haugoult intervint brusquement, et s’enquit de la dispute. Pour s’excuser, les assaillants révélèrent l’existence des manuscrits. Le terrible Haugoult ordonna à Louis et à son ami de lui remettre la cassette. Lambert lui en livra la clef, le Régent prit les papiers, les feuilleta ; puis il dit en les confisquant : – Voilà donc les bêtises pour lesquelles vous négligez vos devoirs ! Louis pleura et se sentit trahi. Suivant le Droit Écolier, les élèves pouvaient le battre mais devaient garder le silence sur les fautes de leur camarade. Aussi eurent-ils pendant un moment quelque honte de leur lâcheté. Le père Haugoult vendit probablement à un épicier de Vendôme le Traité de la Volonté, sans connaître l’importance des trésors scientifiques dont les germes avortés se dissipèrent en d’ignorantes mains. Six mois après, le narrateur quitta le collège. Dans cet ouvrage d’enfant, Lambert déposa des idées d’homme. Dix ans plus tard, en rencontrant quelques savants sérieusement occupés des phénomènes qui les avaient frappés, et que Lambert analysa si miraculeusement, le narrateur comprit l’importance de ses travaux, oubliés déjà comme un enfantillage. Il passa donc plusieurs mois à se rappeler les principales découvertes de son pauvre camarade. Après avoir rassemblé ses souvenirs, il comprit que, dès 1812, Lambert avait établi, deviné, discuté dans son Traité, plusieurs faits importants dont, disait-il, les preuves arriveraient tôt ou tard. À des idées nouvelles, des mots nouveaux ou des acceptions de mots anciens élargies, étendues, mieux définies ; Lambert avait donc choisi, pour exprimer les bases de son système, quelques mots vulgaires qui déjà répondaient vaguement à sa pensée. Le mot de VOLONTÉ servait à nommer le milieu où la pensée fait ses évolutions. La VOLITION, mot dû aux réflexions de Locke, exprimait l’acte par lequel l’homme use de la Volonté. Le mot de PENSÉE, pour lui le produit quintessentiel de la Volonté, désignait aussi le milieu où naissaient les IDÉEES auxquelles elle sert de substance. L’IDÉE, nom commun à toutes les créations du cerveau, constituait l’acte par lequel l’homme use de la Pensée. Ainsi la Volonté, la Pensée étaient les deux moyens générateurs ; la Volition, l’Idée étaient les deux produits. La Volition lui semblait être l’idée arrivée de son état abstrait à un état concret. Selon Lambert, la Pensée et les Idées étaient le mouvement et les actes de notre organisme intérieur, comme les Volitions et la Volonté constituaient ceux de la vie extérieure. Il avait fait passer la Volonté avant la Pensée.
Tout amour, partant toute souffrance, la mère de Lambert mourut jeune après avoir jeté ses facultés dans l’amour maternel. Lambert, enfant de six ans, couché dans un grand berceau, près du lit maternel, mais n’y dormant pas toujours, vit quelques étincelles électriques jaillissant de la chevelure de sa mère, au moment où elle se peignait. L’homme de quinze ans s’empara pour la science de ce fait avec lequel l’enfant avait joué. Il se demanda si le principe constituant de l’électricité n’entrait pas comme base dans le fluide particulier d’où s’élançaient nos Idées et nos Volitions. Il se demanda si la circulation sanguine et son appareil ne répondaient pas à la transsubstantiation de notre Volonté, comme la circulation du fluide nerveux répondait à celle de la Pensée. Ces principes établis, il voulait classer les phénomènes de la vie humaine en deux séries d’effets distincts, et réclamait pour chacune d’elles une analyse spéciale. En effet, après avoir observé, dans presque toutes les créations, deux mouvements séparés, il les pressentait, les admettait même pour notre nature, et nommait cet antagonisme vital : L ’A CTION et LA RÉACTION. Ainsi, l’ensemble de nos Volitions et de nos Idées constituait l’Action, et l’ensemble de nos actes extérieurs, la Réaction. Lorsque, plus tard, le narrateur lut les observations faites par Bichat sur le dualisme de nos sens extérieurs, il fut comme étourdi par ses souvenirs, en reconnaissant une coïncidence frappante entre les idées de ce célèbre physiologiste et celles de Lambert. Certains hommes ayant entrevu quelques phénomènes du jeu naturel de l’être actionnel, furent, comme Swedenborg, emportés au-delà du monde vrai par une âme ardente, amoureuse de poésie, ivre du principe divin. Tous se plurent donc, dans leur ignorance des causes, dans leur admiration du fait, à diviniser cet appareil intime, à bâtir un mystique univers. De là, les anges ! délicieuses illusions auxquelles ne voulait pas renoncer Lambert, qui les caressait encore au moment où le glaive de son Analyse en tranchait les éblouissantes ailes. Des erreurs savantes et des procès ecclésiastiques succombèrent tant de martyrs de leurs propres facultés, d’où résultèrent des preuves éclatantes du pouvoir prodigieux dont dispose l’être actionnel qui, suivant Lambert, peut s’isoler complètement de l’être réactionnel, en briser l’enveloppe, faire tomber les murailles devant sa toute-puissante vue, phénomène nommé, chez les Hindous, la Tokeiade au dire des missionnaires ; puis, par une autre faculté, saisir dans le cerveau, malgré ses plus épaisses circonvolutions, les idées qui s’y sont formées ou qui s’y forment, et tout le passé de la conscience. Suivant pas à pas les effets de la Pensée et de la Volonté dans tous leurs modes ; après en avoir établi les lois, Lambert avait rendu compte d’une foule de phénomènes qui jusqu’à lui passaient à juste titre pour incompréhensibles. Ainsi les sorciers, les possédés, les gens à seconde vue et les démoniaques de toute espèce, ces victimes du Moyen-Âge étaient l’objet d’explications si naturelles, que souvent leur simplicité parut au narrateur être le cachet de la vérité. Les dons merveilleux que l’Église romaine, jalouse de mystères, punissait par le bûcher, étaient selon Louis le résultat de certaines affinités entre les principes constituants de la Matière et ceux de la Pensée, qui procèdent de la même source. L’homme armé de la baguette de coudrier obéissait, en trouvant les eaux vives, à quelque sympathie ou à quelque antipathie à lui-même inconnue.
La découverte de Mesmer, si importante et si mal appréciée encore, se trouvait tout entière dans un seul développement du Traité de Lambert, quoique Louis ne connût pas les œuvres du célèbre docteur suisse. Une logique et simple déduction de ses principes lui avait fait reconnaître que la Volonté pouvait, par un mouvement tout contractile de l’être intérieur, s’amasser ; puis, par un autre mouvement, être projetée au dehors, et même être confiée à des objets matériels. Ainsi la force entière d’un homme devait avoir la propriété de réagir sur les autres, et de les pénétrer d’une essence étrangère à la leur, s’ils ne se défendaient contre cette agression. Pour Lambert la Volonté, la Pensée étaient des forces vives, ces deux puissances étaient en quelque sorte et visibles et tangibles. Pour lui, la Pensée était lente ou prompte, lourde ou agile, claire ou obscure ; il lui attribuait toutes les qualités des êtres agissants. Louis avait cherché des preuves à ses principes dans l’histoire des grands hommes dont l’existence, mise à jour par les biographes, fournit des particularités curieuses sur les actes de leur entendement. Sa mémoire lui ayant permis de se rappeler les faits qui pouvaient servir de développement à ses assertions, il les avait annexés à chacun des chapitres auxquels ils servaient de démonstration, en sorte que plusieurs de ses maximes en acquéraient une certitude presque mathématique. Louis avait mis à contribution les mystères de l’antiquité, les actes des martyrs où sont les plus beaux titres de gloire pour la Volonté humaine, les démonologues du Moyen Âge, les procès criminels, les recherches médicales, en discernant partout le fait vrai, le phénomène probable avec une admirable sagacité. Entre toutes les preuves qui enrichissaient l’œuvre de Lambert, se trouvait une histoire arrivée dans sa famille, et qu’il avait racontée au narrateur avant d’entreprendre son traité. Son père et sa mère eurent à soutenir un procès dont la perte devait entacher leur probité, seul bien qu’ils possédassent au monde. La délibération eut lieu par une nuit d’automne, devant un feu de tourbe, dans la chambre du tanneur et de sa femme. À ce conseil furent appelés deux ou trois parents et le bisaïeul maternel de Louis, vieux laboureur tout cassé, mais d’une figure vénérable et majestueuse. Il était une espèce d’esprit oraculaire que l’on consultait dans les grandes occasions. Il pronostiquait la pluie, le beau temps, et indiquait à ses petits-enfants le moment où ils devaient faucher les prés ou rentrer les moissons. Il demeurait des journées entières immobile sur sa chaise. Cet état d’extase lui était familier depuis la mort de sa femme, pour laquelle il avait eu la plus vive et la plus constante des affections. Le débat eut lieu devant lui, sans qu’il parût y prêter une grande attention. Il annonça qu’il devait consulter sa femme avant de donner son avis. Il se leva, prit son bâton, et sortit, au grand étonnement des assistants qui le crurent tombé en enfance. Il revint en disant avoir vu sa femme près du ruisseau. Elle lui avait dit que les parents de Louis trouveraient chez un notaire de Blois des quittances qui leur feraient gagner leur procès. En effet, les quittances contestées se retrouvèrent, et le procès n’eut pas lieu. Cette aventure arrivée sous le toit paternel, aux yeux de Louis, alors âgé de neuf ans, contribua beaucoup à le faire croire aux visions miraculeuses de Swedenborg, qui donna pendant sa vie plusieurs preuves de la puissance de vision acquise à son être intérieur. Dès l’âge de quinze ans, émis cette maxime psychologique : « Les événements qui attestent l’action de l’Humanité, et qui sont le produit de son intelligence, ont des causes dans lesquelles ils sont préconçus, comme nos actions sont accomplies dans notre pensée avant de se reproduire au dehors ; les pressentiments ou les prophéties sont l’aperçu de ces causes ». Il était facile de saisir en quoi péchait son traité de la Volonté. Quoique doué déjà des qualités qui distinguent les hommes supérieurs, il était encore enfant. Quoique riche et habile aux abstractions, son cerveau se ressentait encore des délicieuses croyances qui flottent autour de toutes les jeunesses. Sa conception touchait donc aux fruits mûrs de son génie par quelques points, et par une foule d’autres elle se rapprochait de la petitesse des germes. Son œuvre portait les marques de la lutte que se livraient dans cette belle âme ces deux grands principes, le Spiritualisme, le Matérialisme, autour desquels ont tourné tant de beaux génies, sans qu’aucun d’eux ait osé les fondre en un seul.
Six mois après la confiscation du traité sur la Volonté, le narrateur quitta le collège. Leur séparation fut brusque. Sa mère, alarmée d’une fièvre qui depuis quelque temps ne le quittait pas, et à laquelle son inaction corporelle donnait les symptômes du coma, l’enleva du collège en quatre ou cinq heures. À l’annonce de son départ, Lambert devint d’une tristesse effrayante. Ils se cachèrent pour pleurer. Louis pensait qu’il mourrait avant son ami et lui dit qu’il lui apparaîtrait s’il le pouvait. Cet adieu mélancolique ne devait pas être le dernier. La mère du narrateur obtint la permission de le faire dîner avec eux à l’auberge. À son tour, le soir, le narrateur le ramena au seuil fatal du collège. Jamais amant et maîtresse ne versèrent en se séparant plus de larmes que Louis et son ami n’en répandirent. Louis savait que plus personne ne le comprendrait. Quoique naturellement religieux ; Louis n’admettait pas les minutieuses pratiques de l’Église romaine ; ses idées sympathisaient plus particulièrement avec celles de sainte Thérèse et de Fénelon, avec celles de plusieurs Pères et de quelques saints. Il était impassible durant les offices. Sa prière procédait par des élancements, par des élévations d’âme qui n’avaient aucun mode régulier. Il ne voulait pas plus prier que penser à heure fixe. Souvent, à la chapelle, il pouvait aussi bien songer à Dieu que méditer sur quelque idée philosophique. Jésus-Christ était pour lui le plus beau type de son système. Les mystères de l’Évangile, les guérisons magnétiques du Christ et le don des langues lui confirmaient sa doctrine. Il trouvait les plus fortes preuves de sa Théorie dans presque tous les martyres subis pendant le premier siècle de l’Église, qu’il appelait la grande ère de la pensée. – « Les phénomènes arrivés dans la plupart des supplices si héroïquement soufferts par les chrétiens pour l’établissement de leurs croyances ne prouvent-ils pas, disait-il, que les forces matérielles ne prévaudront jamais contre la force des idées ou contre la Volonté de l’homme ? Il considérait la Bible comme une portion de l’histoire traditionnelle des peuples antédiluviens, que s’était partagée l’humanité nouvelle. Pour lui, la mythologie des Grecs tenait à la fois de la Bible hébraïque et des Livres sacrés de l’Inde, que cette nation amoureuse de grâce avait traduits à sa manière. Pour lui cette triple littérature impliquait donc toutes les pensées de l’homme. Il ne se faisait pas un livre, selon lui, dont le sujet ne s’y pût trouver en germe. Sa bonté ne lui permettait pas de sympathiser avec les idées politiques ; mais son système conduisait à l’obéissance passive dont l’exemple fut donné par Jésus-Christ. À l’homme de Nerf, l’Action ou la force ; à l’homme de Cerveau, le Génie ; à l’homme de Cœur, la foi. Louis pensait aussi que s’associait à la Foi, les Nuées du Sanctuaire ; à l’Ange seul, la Clarté. Donc, suivant ses propres définitions, Lambert fut tout cœur et tout cerveau. Pour le narrateur, la vie de l’intelligence de Louis s’était scindée en trois phases. Une première phase cérébrale jusqu’à ses treize ans, une phase méditative et à partir de 1815, ayant perdu ses parents, Louis se réfugia chez son oncle. Dévoré bientôt par le désir d’achever des études qu’il dut trouver incomplètes, il vint à Paris pour revoir madame de Staël, et pour puiser la science à ses plus hautes sources. Le vieux prêtre, ayant un grand faible pour son neveu, laissa Louis libre de manger son héritage pendant un séjour de trois années à Paris, quoiqu’il y vécût dans la plus profonde misère. Lambert revint à Blois vers le commencement de l’année 1820, chassé de Paris par les souffrances qu’y trouvent les gens sans fortune. Louis se trouvait un jour au Théâtre-Français placé sur une banquette des secondes galeries, près d’un de ces piliers entre lesquels étaient alors les troisièmes loges. En se levant pendant le premier entracte, il vit une jeune femme qui venait d’arriver dans la loge voisine. La vue de cette femme, jeune et belle, bien mise, décolletée peut-être, et accompagnée d’un amant pour lequel sa figure s’animait de toutes les grâces de l’amour, produisit sur l’âme et sur les sens de Lambert un effet si cruel qu’il fut obligé de sortir de la salle. Contraint de vivre sans cesse en
lui-même et ne partageant avec personne ses exquises jouissances, peut-être voulait-il résoudre l’œuvre de sa destinée par l’extase, et rester sous une forme presque végétale, comme un anachorète des premiers temps de l’Église, en abdiquant ainsi l’empire du monde intellectuel. La lettre de Louis était en rapport avec l’aventure arrivée au théâtre. Le Fait et l’Écrit s’illuminaient réciproquement, l’âme et le corps s’étaient mis au même ton. Cette tempête de doutes et d’affirmations, de nuages et d’éclairs qui souvent laisse échapper la foudre, et qui finit par une aspiration affamée vers la lumière céleste, jetait assez de clarté sur la troisième époque de son éducation morale pour la faire comprendre en entier. Louis écrivit à son oncle avoir compris que le point de départ en tout était l’argent. Il fallait de l’argent, même pour se passer d’argent. Louis préférait la pensée à l’action, une idée à une affaire, la contemplation au mouvement. Il manquait essentiellement de la constante attention nécessaire à qui voulait faire fortune. Il estimait qu’il fallait matériellement peu à celui qui vivait pour accomplir de grandes choses dans l’ordre moral. La misère ne l’effrayait pas. Si l’on n’emprisonnait, si l’on ne flétrissait, si l’on ne méprisait point les mendiants, Louis aurait mendié pour pouvoir résoudre à son aise les problèmes qui l’occupaient. Louis avait vu que dans ce monde tout devait avoir un résultat immédiat, réel ; l’on s’y moquait des essais d’abord infructueux qui pouvaient mener aux plus grandes découvertes, et l’on n’y estimait pas cette étude constante et profonde qui voulait une longue concentration des forces. L’étude avait conduit Louis à Paris. Il y avait trouvé des hommes vraiment instruits, étonnants pour la plupart ; mais l’absence d’unité dans les travaux scientifiques annulait presque tous les efforts. Ni l’enseignement, ni la science n’avaient de chef selon lui. La science humaine marchait donc sans guide, sans système et flottait au hasard, sans s’être tracé de route. Il ne voyait aucune fixité dans la politique dont l’agitation constante n’avait procuré nul progrès. Les gouvernements passaient comme les hommes, sans se transmettre aucun enseignement, et nul système n’engendrait un système plus parfait. Il fustigeait le code de Napoléon, œuvre la plus draconienne qu’il connaissait. La divisibilité territoriale poussée à l’infini, dont le principe y était consacré par le partage égal des biens, devait engendrer l’abâtardissement de la nation, la mort des arts et celle des sciences. Pour Lambert, la politique était donc une science sans principes arrêtés, sans fixité possible ; elle était le génie du moment, l’application constante de la force, suivant la nécessité du jour. Louis affirmait que la philanthropie était une magnifique erreur, et le progrès un non-sens. Il avait gagné la confirmation de cette vérité, que la vie était en nous et non au dehors ; que s’élever au-dessus des hommes pour leur commander était le rôle agrandi d’un régent de classe ; et que les hommes assez forts pour monter jusqu’à la ligne où ils pouvaient jouir du coup d’œil des mondes, ne devaient pas regarder à leurs pieds. La pensée de Lambert était de déterminer les rapports réels qui pouvaient exister entre l’homme et Dieu. Il avait quelque répugnance à rendre Dieu solidaire des lâchetés humaines, de nos désenchantements, de nos dégoûts, de notre décadence. Louis annonçait à son oncle que tant qu’un beau génie n’aurait pas rendu compte de l’inégalité patente des intelligences, le sens général de l’humanité, le mot Dieu serait sans cesse mis en accusation, et la société reposerait sur des sables mouvants Le secret des différentes zones morales dans lesquelles transitait l’homme se trouverait dans l’analyse de l’Animalité tout entière. Il était impossible de toucher à la politique sans s’occuper de morale, et la morale tenait à toutes les questions scientifiques. Il semblait à Lambert que les hommes étaient à la veille d’une grande bataille humaine ; les forces étaient là ; seulement Louis ne voyait pas de général. Il était sombre et se prédisait une mort obscure à Blois. Il s’était replongé dans la lecture de Swedenborg. Swedenborg serait peut-être le Bouddha du Nord. Quelque obscurs et diffus que soient ses livres, il s’y trouvait les éléments d’une conception sociale grandiose. Sa théocratie était sublime, et sa religion était la seule que pouvait admettre un esprit supérieur. Lui seul faisait toucher à Dieu.
Quand Louis fut de retour à Blois, son oncle s’empressa de lui procurer des distractions. Mais ce pauvre prêtre se trouvait dans cette ville dévote comme un véritable lépreux. Personne ne se souciait de recevoir un révolutionnaire, un assermenté. Sa société consistait donc en quelques personnes de l’opinion dite alors libérale, patriote ou constitutionnelle, chez lesquelles il se rendait pour faire sa partie de whist ou de boston. Dans la première maison où le présenta son oncle, Louis vit une jeune personne que sa position forçait à rester dans cette société réprouvée par les gens du grand monde, quoique sa fortune fût assez considérable pour faire supposer que plus tard elle pourrait contracter une alliance dans la haute aristocratie du pays. Mademoiselle Pauline de Villenoix se trouvait seule héritière des richesses amassées par son grand-père, un juif nommé Salomon, qui, contrairement aux usages de sa nation, avait épousé dans sa vieillesse une femme de la religion catholique. Salomon acheta, suivant l’expression du temps, une savonnette à vilain, et fit ériger en baronnie la terre de Villenoix, dont le nom devint le sien. Il était mort sans avoir été marié, mais en laissant une fille naturelle à laquelle il avait légué la plus grande partie de sa fortune, et notamment sa terre de Villenoix. Un de ses oncles, monsieur Joseph Salomon, fut nommé par monsieur de Villenoix tuteur de l’orpheline. Mais l’origine de mademoiselle de Villenoix et les préjugés que l’on conservait en province contre les juifs ne lui permettaient pas, malgré sa fortune et celle de son tuteur, d’être reçue dans cette société tout exclusive qui s’appelle, à tort ou à raison, la noblesse. Les traits de Pauline offraient dans sa plus grande pureté le caractère de la beauté juive. Elle restait habituellement silencieuse et recueillie ; mais ses gestes, ses mouvements témoignaient d’une grâce cachée, de même que ses paroles attestaient l’esprit doux et caressant de la femme. Aussitôt que Lambert aperçut mademoiselle de Villenoix, il devina l’ange sous cette forme. Les riches facultés de son âme, sa pente vers l’extase, tout en lui se résolut alors par un amour sans bornes, par le premier amour du jeune homme, passion déjà si vigoureuse chez les autres, mais que la vivace ardeur de ses sens, la nature de ses idées et son genre de vie durent porter à une puissance incalculable. Cette passion fut un abîme où le malheureux jeta tout, abîme où la pensée s’effraie de descendre, puisque la sienne ; si flexible et si forte, s’y perdit.
Le hasard mit le narrateur en relation avec l’oncle de Lambert. Il trouva plusieurs lettres de son ami trop illisibles pour avoir été remises à mademoiselle de Villenoix. La première de ces lettres, qui était évidemment ce qu’on nomme un brouillon, attestait par sa forme et par son ampleur ces hésitations, ces troubles du cœur, ces craintes sans nombre éveillées par l’envie de plaire, ces changements d’expression et ces incertitudes entre toutes les pensées qui assaillent un jeune homme écrivant sa première lettre d’amour. Il lui écrivait avoir passé des heures délicieuses occupé à la voir en s’abandonnant aux rêveries les plus douces de sa vie. Il espérait que Pauline ne couronnerait donc pas cette longue et passagère félicité par quelque moquerie de jeune fille. Il lui demanda de se contenter de ne pas lui répondre si elle ne l’aimait pas. Elle ne le découragea pas alors il se livra à elle. Il évoqua le malheur de sa vie morale qui agissait sur son existence physique. La nature de son esprit s’y livrait sans défense aux joies du bonheur comme aux affreuses clartés de la réflexion qui les détruisaient en les analysant. Il lui expliquait être doué de la triste faculté de voir avec une même lucidité les obstacles et les succès ; suivant sa croyance du moment, il était heureux ou malheureux. Il lui écrivait qu’elle serait toute sa famille, comme elle était déjà sa seule richesse, et le monde entier pour lui. Il reprit espoir et pour elle, il convoitait les palmes de la gloire et tous les triomphes du talent. Dans sa troisième lettre, Louis montrait sa peur d’avoir perdu Pauline et lui demandait s’il l’avait déçue. Dans la lettre suivante Louis se demandait qu’avait été le temps de son existence où il ne connaissais pas Pauline. Il pensait que cela aurait été le néant, s’il n’avait pas été si malheureux. Puis, il consacra sa cinquième lettre à exprimer le désir d’un amour exclusif dans lequel aucune créature ayant face humaine n’entrerait dans le sanctuaire où Pauline serait à lui.
En 1823, le narrateur alla de Paris en Touraine par la diligence. À Mer, le conducteur prit un voyageur pour Blois. C’était l’oncle de Louis. Le narrateur lui demanda des nouvelles de son ami. Il lui dit mon nom, mais en l’entendant la figure du bonhomme se rembrunit. Il apprit au narrateur que son pauvre neveu devait épouser la plus riche héritière de Blois, mais la veille de son mariage il était devenu fou. Le narrateur apprit à l’oncle de Louis le secret de leurs études, la nature des occupations de son neveu ; puis le vieillard lui raconta les événements survenus dans la vie de Lambert depuis qu’il l’avait quitté. Lambert avait donné quelques marques de folie avant son mariage. Le fait le plus grave était survenu quelques jours avant le mariage des deux amants. Louis avait eu quelques accès de catalepsie bien caractérisés. Il était resté pendant cinquante-neuf heures immobile, les yeux fixes, sans manger ni parler. L’exaltation à laquelle dut le faire arriver l’attente du plus grand plaisir physique, encore agrandie chez lui par la chasteté du corps et par la puissance de l’âme, avait bien pu déterminer cette crise. Le narrateur se souvint tout à coup d’une conversation qu’il avait eue avec Louis après la lecture d’un livre de médecine. Louis avait estimé qu’une méditation profonde, une belle extase étaient peut-être des catalepsies en herbe. En réfléchissant aux effets du fanatisme, Lambert fut alors conduit à penser que les collections d’idées auxquelles nous donnons le nom de sentiments pouvaient bien être le jet matériel de quelque fluide que produisent les hommes plus ou moins abondamment, suivant la manière dont leurs organes en absorbent les substances génératrices dans les milieux où ils vivent. Louis et le narrateur se fatiguèrent beaucoup à faire quelques expériences assez analogues à celles dues aux convulsionnaires du XVIIIè siècle. Mais, malgré ces folles tentatives, ils n’eurent aucun accès de catalepsie. Lorsque son accès fut passé, Louis tomba dans une terreur profonde, dans une mélancolie que rien ne put dissiper. Il se crut impuissant. Son oncle se mit à le surveiller avec l’attention d’une mère pour son enfant, et le surprit heureusement au moment où il allait pratiquer sur lui-même l’opération à laquelle Origène crut devoir son talent. L’oncle Lefebvre l’emmena promptement à Paris pour le confier aux soins de M. Esquirol. Pendant le voyage, Louis resta plongé dans une somnolence presque continuelle, et ne reconnut plus son oncle. À Paris, les médecins le regardèrent comme incurable, et conseillèrent unanimement de le laisser dans la plus profonde solitude, en évitant de troubler le silence nécessaire à sa guérison improbable, et de le mettre dans une salle fraîche où le jour serait constamment adouci. Mademoiselle de Villenoix, à qui Lefebvre avait caché l’état de Louis, mais dont le mariage passait pour être rompu, vint à Paris, et apprit la décision des médecins. Aussitôt elle désira voir Louis qui la reconnut à peine ; puis elle voulut, d’après la coutume des belles âmes, se consacrer à lui donner les soins nécessaires à sa guérison. « Elle y aurait été obligée, disait-elle, s’il eût été son mari ; devait-elle faire moins pour son amant ? » Aussi elle avait emmené Louis à Villenoix, où ils demeuraient depuis deux ans. Le narrateur s’arrêta donc à Blois pour aller voir Louis. Lefebvre ne lui permit pas de descendre ailleurs que dans sa maison, où il lui montra la chambre de son neveu, les livres et tous les objets qui lui avaient appartenu. Lefebvre était plongé dans un deuil affreux à cause de cette perte irréparable. Le narrateur fut tenté d’attribuer la cause de la folie de Louis à sa passion. peut-être que son ami avait vu dans les plaisirs de son mariage un obstacle à la perfection de ses sens intérieurs et à son vol à travers les Mondes Spirituels. Ce raisonnement logique ne consola pas Lefebvre de la perte de son neveu. Le lendemain, le narrateur partit pour Villenoix. Lefebvre lui conseilla, en présence de mademoiselle de Villenoix, de ne pas avoir l’air de s’apercevoir que Louis était fou. Sur le chemin, le narrateur se demanda si, à la longue, Pauline avait contracté la folie de son amant, ou était-elle entrée si avant dans son âme, qu’elle avait pu en comprendre toutes les pensées, même les plus confuses. Mademoiselle de Villenoix, n’ayant connu de l’amour que ses premières émotions, offrit au narrateur le type du dévouement dans sa plus large expression. Il fut introduit par une domestique dans une pièce sombre. Mademoiselle de Villenoix et Louis lui firent l’effet de deux masses noires qui tranchaient sur le fond de cette atmosphère ténébreuse. Pauline dit à Louis qu’il se trouvait devant son ami de collège. Lambert ne répondit pas. Lambert se tenait debout, les deux coudes appuyés sur la saillie formée par la boiserie, en sorte que son buste paraissait fléchir sous le poids de sa tête inclinée. Ses cheveux, aussi longs que ceux d’une femme, tombaient sur ses épaules, et entouraient sa figure de manière à lui donner de la ressemblance avec les bustes qui représentent les grands hommes du siècle de Louis XIV. Auprès de lui se trouvait un sommier de mousse posé sur une planche. Pauline expliqua au narrateur qu’il arrivait très rarement à Louis de se coucher, quoique chaque fois il dormait pendant plusieurs jours. Louis se tenait debout, jour et nuit, les yeux fixes, sans jamais baisser et relever les paupières. Le narrateur ouvrit légèrement la persienne, et pus voir alors l’expression de la physionomie de son ami. Hélas ! déjà ridé, déjà blanchi, enfin déjà plus de lumière dans ses yeux, devenus vitreux comme ceux d’un aveugle. Tous ses traits semblaient tirés par une convulsion vers le haut de sa tête. C’était un débris arraché à la tombe. Tout à coup Louis cessa de frotter ses jambes l’une contre l’autre, et dit d’une voix lente : – Les anges sont blancs ! cela fit pleurer le narrateur. Il se mit à douter que son ami avait perdu la raison. Il ne s’étonna plus que mademoiselle de Villenoix crût Louis parfaitement sain d’entendement. Pauline restait toujours là, assise devant un métier à tapisserie, et chaque fois qu’elle tirait son aiguille elle regardait Lambert en exprimant un sentiment triste et doux. Le narrateur éprouva le besoin de sortir pour parler à Pauline. Elle était persuadée que tout était parfaitement coordonné chez son amant. S’il n’avait pas reconnu physiquement le narrateur, Pauline affirmait qu’il l’avait vu. Il avait réussi à se dégager de son corps, et apercevait ses proches sous une autre forme, Pauline ne savait laquelle. Quand Louis parlait, il exprimait des choses merveilleuses. Contente d’entendre battre son cœur, tout le bonheur de Pauline était d’être auprès de lui. Depuis trois ans, à deux reprises, elle l’avait possédé pendant quelques jours : en Suisse où elle l’avait conduit, et au fond de la Bretagne dans une île où elle l’avait mené prendre des bains de mer. Elle avait été deux fois bienheureuse. Elle pouvait vivre par ses souvenirs. Dans le temps où il se mit à parler, Pauline avait recueilli ses premières phrases, mais elle avait cessé de le faire ; elle n’y entendait rien alors. Le narrateur lui demanda de lui laisser lire ses notes. Louis y évoquait une Substance éthérée qui constituait ce que l’on appelait vulgairement la Matière. Cette SUBSTANCE était transportée par le cerveau d’où elle sortait transformée en Volonté. La Volonté était un fluide, attribut de tout être doué de mouvement. En l’homme, la Volonté devenait une force qui lui était propre, et qui surpassait en intensité celle de toutes les espèces. Par sa constante alimentation, la Volonté tenait à la SUBSTANCE qu’elle retrouvait dans toutes les transmutations en les pénétrant par la Pensée, qui était un produit particulier de la Volonté humaine, combinée avec les modifications de la SUBSTANCE. Du plus ou moins de perfection de l’appareil humain, venaient les innombrables formes qu’affectait la Pensée. La Volonté s’exerçait par des organes vulgairement nommés les cinq sens qui n’en étaient qu’un seul, la faculté de voir. Louis avait déclaré que les quatre expressions de la matière par rapport à l’homme, le son, la couleur, le parfum et la forme, avaient une même origine ; car le jour n’était pas loin où l’on reconnaîtrait la filiation des principes de la lumière dans ceux de l’air. La pensée qui tenait à la lumière s’exprimait par la parole qui tenait au son. Pour lui, tout provenait donc de la SUBSTANCE. La parole engendrait incessamment la Substance. La colère, comme toutes nos expressions passionnées, était un courant de la force humaine qui agissant électriquement. Le fanatisme et tous tes sentiments étaient des Forces Vives. Ces forces, chez certains êtres, devenaient des fleuves de Volonté qui réunissaient et entraînaient tout. Si l’espace existait, certaines facultés donnaient le pouvoir de le franchir avec une telle vitesse que leurs effets équivalaient à son abolition. Lambert pensait que les faits n’étaient rien, ils n’existaient pas, il ne subsistait de nous que des Idées. Pour lui, Le monde des Idées se divisait en trois sphères : celle de l’Instinct, celle des Abstractions, celle de la Spécialité. Les Instinctifs naissaient, travaillaient et mouraient sans s’élever au second degré de l’intelligence humaine, l’Abstraction. À l’abstraction commençait la Société. Le don de Spécialité pouvait seul expliquer Dieu. De l’abstraction naissaient les lois, les arts, les intérêts, les idées sociales. L’abstraction était la gloire et le fléau du monde : la gloire, elle avait créé les sociétés ; le fléau, elle dispensait l’homme d’entrer dans la Spécialité. La Spécialité consistait à voir les choses du monde matériel aussi bien que celles du monde spirituel dans leurs ramifications originelles et conséquentielles. Les plus beaux génies humains étaient ceux qui étaient partis des ténèbres de l’Abstraction pour arriver aux lumières de la Spécialité. Jésus était Spécialiste, il voyait le fait dans ses racines et dans ses productions, dans le passé qui l’avait engendré, dans le présent où il se manifestait, dans l’avenir où il se développait. Entre la sphère du Spécialisme et celle de l’Abstractivité se trouvaient les hommes de génie. Le Spécialiste était nécessairement la plus parfaite expression de l’HOMME agissant, voyant et sentant par son INTÉRIEUR. L’Abstractif pensait. L’Instinctif agissait. Le Spécialisme ouvrait à l’homme sa véritable carrière, l’infini commençait à poindre en lui, là il entrevoyait sa destinée. Il existait trois mondes : le NATUREL, le SPIRITUEL, le DIVIN. L’Humanité transitait dans le Monde Naturel, qui n’était fixe ni dans son essence ni dans ses facultés. Le Monde Spirituel était fixe dans son essence et mobile dans ses facultés. Le Monde Divin était fixe dans ses facultés et dans son essence. L’Instinctif voulait des faits, l’Abstractif s’occupait des idées, le Spécialiste voyait la fin, il aspirait à Dieu qu’il pressentait ou contemplait.
Après être allé revoir encore une fois Lambert, le narrateur quitta Pauline et revint en proie à des idées si contraires à la vie sociale, qu’il renonça, malgré sa promesse, à retourner à Villenoix. Peut-être aurait-il pu transformer en un livre complet les débris de pensées de Louis, compréhensibles seulement pour certains esprits habitués à se pencher sur le bord des abîmes, dans l’espérance d’en apercevoir le fond. Lambert mourut à l’âge de vingt-huit ans, le 25 septembre 1824, entre les bras de son amie. Elle le fit ensevelir dans une des îles du parc de Villenoix. Son tombeau consistait en une simple croix de pierre, sans nom, sans date.
