L’essai convaincant de deux graffeurs pour mieux regarder les murs de nos villes.
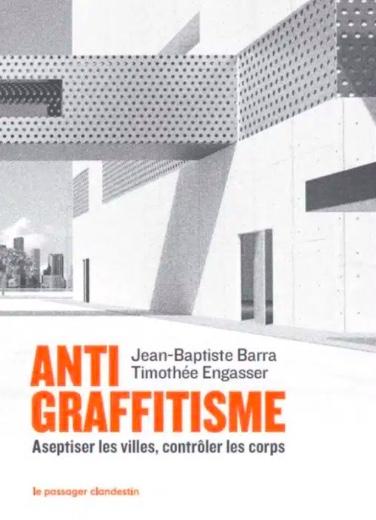
Propriété, propreté, sécurité. Cela pourrait être la devise de nos villes à l’ère du capitalisme néolibéral, au vu des analyses de Jean-Baptiste Barra et Timothée Engasser qui, dans leur essai Antigraffitisme et depuis leur position de graffeurs, s’intéressent à la répression croissante et disproportionnée du graffiti.
Un graffiti qu’ils pensent comme une pratique collective, libre et sans marchandisation, et qui résiste tant à la qualification d’art, jugée réductrice, qu’à celle pour le moins stigmatisante de vandalisme. Un graffiti qui n’a pas le droit de cité quand, dans le même temps, le street-art y est promu et institutionnalisé.
Avec précision, les auteurs reviennent sur les fondements idéologiques d’une telle répression, qui mêlent morale et hygiénisme et opposent une société « saine » à une société « malade ». Dans un tel contexte, effacer les graffitis reviendrait à soigner ou réparer la ville, contaminée par des comportements « déviants » dont il faudrait protéger les individus « respectables ». Aussi, en vertu de la théorie de la vitre cassée développée aux Etats Unis dans les années 80 pour lutter contre la délinquance, il ne faudrait faire preuve d’aucune passivité face aux murs tagués qui, comme les carreaux cassés, annonceraient le développement d’une criminalité plus importante… Autant de discours dont les relents racistes et classistes ne semblent jamais loin.
On comprend ainsi pourquoi, sur le plan juridique, le graffiti est devenu un délit spécial au sein du Code pénal, sanctionné par une amende d’un montant plus important que pour tout autre type de dégradations dites légères. Et comment, au niveau politique, l’utilisation du graffiti par des mouvements contestataires sert parfois de prétexte efficace à l’Etat pour les stigmatiser et les décrédibiliser. A ce titre, l’essai revient avec pertinence sur l’épisode politico-médiatique ayant monté en épingle la « vandalisation » de l’Arc de Triomphe par les Gilets Jaunes.
Les auteurs consacrent aussi un chapitre au street-art institutionnel et nous offrent ainsi une occasion de repenser cette forme artistique que l’on consomme quotidiennement à coups d’expositions, de festivals et de fresques toujours plus monumentales. Voué à l’embellissement de nos espaces urbains, il se fait, un peu malgré lui, l’outil complice de la lutte contre le graffiti et des transformations urbaines au profit des classes privilégiées.
En déployant une analyse politique rare des pratiques d’effacement du graffiti, cet essai apparaît finalement comme l’éloge d’une discipline résolument libertaire et subversive face à l’uniformisation et l’aseptisation croissantes des villes de ce monde. Salutaire.

