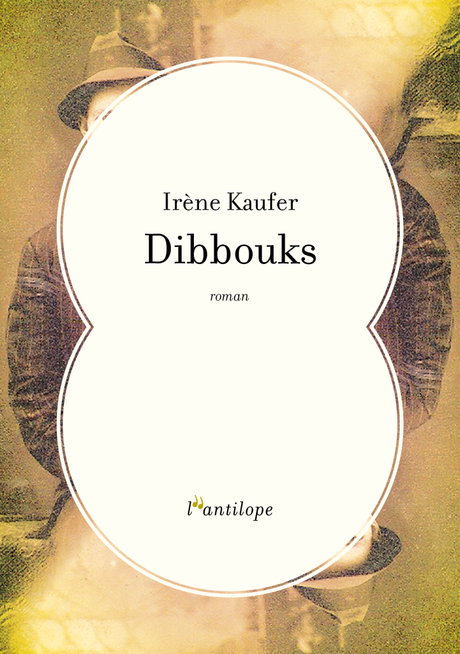
Quatrième de couverture :
Dans la croyance populaire juive, le dibbouk est l’âme d’un mort qui vient s’incarner dans le corps d’un vivant. Ici, la narratrice est obsédée par une quête familiale. Son père, rescapé de la Shoah, a laissé un témoignage dans lequel il raconte comment, lors de sa déportation, il a été séparé de sa fille.
Qu’est-elle devenue ? Elle a disparu à jamais.
Mais la narratrice, elle, se laisse peu à peu envahir par le dibbouk de cette sœur. Elle n’a de cesse, dès lors, de se lancer à la recherche de Mariette.
Ce premier roman restera hélas unique car Irène Kaufer, fidèle lectrice féministe et cliente de la librairie TuliTu à Bruxelles – ma super librairie du Québec et du monde – s’en est allée rejoindre les étoiles il y a quelques mois.
Il s’agit bien d’un roman (l »éditeur, spécialisé dans « les textes littéraires rendant compte de la richesse et des paradoxes de l’existence juive sur les cinq continents », le précise sur son site). Pourtant il a une base largement autobiographique et sur cette base, il m’a bien menée en bateau (ce n’est pas péjoratif, je suis très naïve). En effet, Irène Kaufer se base sur le témoignage de ses parents, Erna Briefel et Stefan Kaufer, filmé pour la Fondation Spielberg. Le père a eu – si je puis dire – une première vie en Pologne puis en Tchécoslovaquie où il est réquisitionné pour des camps de travail par les nazis et est séparé de sa première femme et de sa toute petite fille, dont il apprendra plus tard qu’elle ont été assassinées avec toutes les personnes non réquisitionnées. Il est retourné en Pologne après la guerre, il s’est remarié et la petite Irène est née à Cracovie. La famille arrivera en Belgique en 1958.
Avec cette histoire de dibbouk, Irène Kaufer imagine que la petite fille de Prague a survécu et vit désormais au Canada. C’est son père qui l’y a amenée et y a vécu avec elle après la guerre. L’autrice imagine également une seconde vie pour sa mère, Erna. Et c’est là qu’Irène Kaufer est vraiment très forte parce qu’on se prend à croire (je me suis prise à croire) que ces doubles vies sont possibles, vraisemblables, alors qu’en réalité, non. Ce sont des échos très sensibles, poignants, de la quête de ses origines par l’autrice, une façon de redonner sens à des vies détruites, écrasées, dont il ne reste que des bribes comme un bracelet (j’ai bien sûr pensé au roman de Gaëlle Nohant, Le bureau d’éclaircissement des destins).
Malgré son sujet grave, émouvant, ce roman ne manque pas d’humour, on peut y goûter cet humour juif à la fois « naïf » et absurde, et la construction du livre est parfaitement maîtrisée (la conclusion ne manque pas de piquant non plus).
« -(…) Est-ce qu’au moins vous savez ce qu’est le Kippour ? fit-elle, et j’ai perçu comme une exaspération dans sa voix.
J’ai encore tenté de m’en tirer par la plaisanterie.
-C’est une sorte de concentré de Ramadan, non ? On jeûne un jour au lieu d’un mois entier ?
-Vous ne devriez pas rire avec ça, me dit-elle en plissant les yeux. Kippour, c’est sérieux, c’est le jour où Dieu inscrit dans son grand livre qui va vivre et qui va mourir dans l’année.
-Entre 1939 et 1945, il a dû s’épuiser en travaux d’écriture, dites donc… » ( p.21)
« Lorsque cette humanité aura disparu de la surface de la terre, emportée par sa cruauté ou son imprévoyance, il restera toujours des formulaires, des montagnes et des océans de formulaires, témoignages d’une ancienne civilisation, conservés pour l’édification des générations nouvelles. Des papiers et des papiers et des papiers, responsables de la déforestation, et peut-être même en partie du suicide collectif qui, après bien des péripéties, aura débouché sur une espèce différente, faite de corps à nourrir, à soigner, à prendre dans ses bras, plutôt que de formulaires à tamponner après avoir enregistré l’empreinte du pouce. » (p. 55-56)
Un extrait dans lequel je me suis reconnue : « L’hôtel est petit et modeste, je l’ai choisi au hasard, peut-être à cause du nom de métro adjacent, Bonaventure, un nom qui promettait sans imposer, ou peut-être à cause de la proximité de la gare, synonyme d’une fuite rapide si la bonne aventure tournait mal. J’ai toujours ressenti ce besoin d’assurer mes arrières, ou mes côtés ; au cinéma, au concert, je m’assieds en bout de rangée, j’accompagne les manifestations en les longeant sur le trottoir, au risque de ne jamais être prise en compte comme participante ; il me faut une porte, une sortie de secours, une rue par laquelle m’échapper en cas de nécessité. Et la nécessité est permanente. » (p. 57)
Irène KAUFER, Dibbouks, L’Antilope, 2021
Le Mois belge 2023 – Rendez-vous féminin
