Un drame urbain
Cette réédition du dernier roman de l’argentin Roberto Arlt est l’occasion de redécouvrir son talent pour décrire la ville comme un espace aliénant où grouillent les vies mornes.
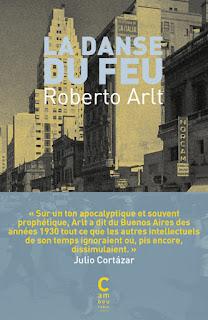
Quatrième et dernier roman de son auteur, publié en 1932, La danse du feu conclut un cycle entamé en 1926 avec Le jouet enragé et poursuivit dans le diptyque Les sept fous/Les lance-flammes, dans lesquels des personnages idéalistes, pusillanimes et angoissés subissent l’aliénation d’une grande métropole urbaine que Roberto Arlt, en Argentine, aura pour ainsi dire inventé littérairement. Buenos Aires, bien entendu, ne l’avait pas attendu pour devenir tentaculaire, à mesure qu’elle se remplissait d’immigrés venus tenter leur chance depuis les quatre coins de l’Europe ou d’ailleurs et que les immeubles prétentieux s’y disputaient aux bidonvilles. Mais c’est lui qui, le premier, certainement, aura su la décrire dans toute sa démesure et faire entrer de plain-pied dans la fiction ce paysage fait de « deux villes superposées : celle des gratte-ciels, au fond, et celle des maisons basses qui étend au-dessous sa ligne horizontale fracturée ».
On a souvent dit de la littérature de Arlt – ce « survivant-né », comme le qualifiait Bolaño – qu’elle était le curieux fruit d’une culture approximative, faite de lectures hâtives et désordonnées de mauvaises traductions, et d’une capacité prodigieuse de saisir avec acuité la réalité populaire de la grande ville (une acuité dont les écrivains bourgeois d’alors n’auraient su faire preuve). C’est particulièrement frappant dans le cas de cette Danse du feu qui, s’il n’est pas le meilleur roman de Arlt, n’en reste pas moins un drôle d’objet : une sorte de feuilleton sentimental comme il s’en écrivait et publiait des pelletées à l’époque, mais pour ainsi dire baigné dans l’acide d’un regard cruel qui n’a qu’une envie, celle de réduire en miettes les conventions sociales corsetées et hypocrites de son temps.
De l’idéalisme au cynisme il n’y a parfois qu’un pas, et c’est bien entre ces deux pôles qu’oscille en permanence Estanislao Balder, ultime avatar arltien du citadin anonyme et frustré ; un parmi d’autres dans une ville qui en fourmille. Un type coincé dans une vie insatisfaisante et dont les aspirations incertaines, peut-être inexistantes au-delà du simple désir d’aspirer à quelque chose, sont condamnées au néant. Le roman s’ouvre sur une scène où Balder, « à la recherche du drame », « son costume bien repassé et son nœud de cravate fixé au centre mathématique du col », s’apprête à déclarer à la mère de la jeune Irene qu’il s’est épris de sa fille, lui un homme marié !
Ainsi commence le vaudeville existentiel d’un homme à la vie terne, lequel, comme tant d’autres de ses connaissances dont il ne cesse de critiquer les comportements, attrapés qu’ils sont entre leurs femmes et leurs maîtresses – autant de pauvres conventions qu’ils acceptent trop placidement à son goût –, est pris au piège « de la somme de contradictions mises en jeu, dans le mécanisme psychologique de l’être humain, par la grise monotonie de la ville ». Une ville qu’Arlt décrit brillamment, que ce soit les alentours de la gare de Retiro – ses édifices, ses publicités omniprésentes, son bruit et son agitation incessante –, ou le trajet en train qui le conduit jusqu’à la ville de Tigre où habite sa fiancée, en traversant des kilomètres de banlieue chaotique.
Balder est un homme qui pense trop et patauge dans sa « volonté tarée », dans l’éternel aller-retour des « excès les plus opposés ». « Sa permanente anxiété sollicitait une compagnie féminine qu’il repoussait presque aussitôt qu’il l’avait obtenue », nous dit de lui l’auteur : « là où il pensait trouver un palais, il découvrait une cabane ». Dans des dialogues imaginaires fébriles, en tous points dignes d’un insomniaque, il craint « l’appel du chemin ténébreux », qui pourrait bien être celui où le voyageur impénitent – voyageur, il va sans dire, mental – se voit contraint d’abandonner tout espoir. « Néanmoins », confie-t-il, « j’aimais cette vague de cendre qui pleuvait sur moi jusqu’à me submerger. J’aspirais à me noyer dans l’absolue négation de tout idéal, à m’engloutir dans le matérialisme de ces femmes qui se figuraient avoir de la religion parce qu’elles laissaient deux veilleuses allumées jour et nuit devant la Vierge de Luján ».
La danse du feu est une sorte de drame sec et parfois baroque dans son écriture qui cherche à décrire dans tous ses méandres le puzzle des aspirations incertaines d’un homme jeune et déjà revenu de tout – alors même qu’il semble ne pas avoir décollé – qui croit pouvoir chiffrer dans la relation bancale qu’il tisse avec une jeune femme idéalisée une réalisation impossible. L’amertume et la déception résignée semblent être les seules récompenses qui l’attendent.
Roberto Arlt – La danse du feu [Traduit de l’espagnol (Argentine) par Lucien Mercier – Cambourakis, 2021, 312 pages, 12 euros]


