L’artiste et sa solitude
Avec son élégance habituelle, l’anglais Gabriel Josipovici tente une nouvelle fois de mettre le doigt sur ce qui fait la grâce si particulière de l’artiste, cette figure à la fois mélancolique et lumineuse.
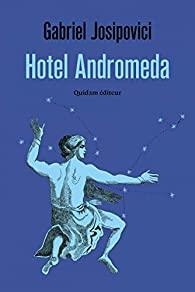
Josipovici aime les créateurs excentriques, ceux qui, loin des modes et parfois même du monde, réalisent patiemment une œuvre auto-suffisante mais pas nécessairement autiste pour autant ; une œuvre, plutôt, qui invente ses propres règles comme une façon de faire face à une vie pas toujours facile. Une manière, pour ainsi dire, de trouver une place. Il y a peut-être, dans cette vision de l’artiste, quelque chose de romantique chez Josipovici, mais il y a surtout, de sa part, une foi dans les puissances de l’art et dans la force « lumineuse » – quand bien même en proie à des affects et des blessures pas toujours claires – de l’acte même de la création.
Hôtel Andromeda, dès son titre, renvoie à l’artiste américain Joseph Cornell, lequel, dans sa maison du Queens, à New York, où il vivait avec une mère envahissante et un frère handicapé dont il devait assumer malgré lui la charge, réalisait dans son coin des boîtes-collages à la forte inspiration onirique à partir d’éléments collectés dans les brocantes et sur les plages. Une œuvre très personnelle qui lui valut l’admiration de nombreuses célébrités. Il est de ces artistes dont l’univers si particulier ne saurait être séparé des conditions tout aussi particulières de sa création, et c’est bien ce croisement entre l’art et les conditions de vie – déterminantes – qui intéresse Josipovici (tout comme dans Infini – l’histoire d’un moment il s’était penché sur un autre excentrique de haute volée, le compositeur italien Giacinto Scelsi).
Et puisque la création artistique, aussi idiosyncratique soit-elle, ne saurait être coupée du réel, Josipovici la met en parallèle avec le drame du monde, incarné ici par « l’arrivé de l’homme de Grozny », dans la vie paisible – morne, dirait-elle – d’Helena, qui planche depuis son petit appartement londonien sur un livre consacré à Cornell. Photographe de retour de Tchétchénie où il a vu des horreurs sans fin, l’homme débarque dans la vie d’Helena sur une recommandation de la sœur de cette dernière, qui travaille là-bas dans un orphelinat.
Ces divers éléments s’organisent en brefs chapitres fortement dialogués, autant de moments quotidiens où l’héroïne semble lutter avec le sujet de son livre, qu’elle tente d’aborder par approximations successives, et lutter encore avec son amour propre, comme si l’absence de communication avec sa sœur, laquelle regarde pour ainsi dire le monde en face et tente même d’y intervenir, agissait en révélateur de sa propre petitesse, elle qui ne fait qu’écrire des livres que peu de gens lisent sur des artistes auxquels peu de gens s’intéressent.
« Même si tout le monde est un peu bizarre et même si les prédécesseurs et contemporains de Cornell dans le domaine du recyclage des détritus – Picasso, Duchamp, Schwitters – n’étaient pas des modèles de respectabilité bourgeoise, Cornell était autre chose. Contrairement à eux, il n’avait aucune idée de la manière de vivre dans le monde. » Cornell est un inadapté en proie à des désirs troubles qui recrée dans ses collages en trois dimensions un univers à la fois intime et cosmique, et l’Helena qu’invente Josipovici pour nous parler de lui est, elle aussi, à sa façon sans doute plus banale, une personne « un peu bizarre ».
C’est au fond la question de la solitude qui ne cesse de revenir dans ce livre, celle de Cornell sur une photo prise à la fin de sa vie, alors que les deux personnes qu’il avait tant aimées et tant haïes, sa mère et son frère, sont morts ; celle, aussi, d’Helena, qui ne cesse d’aller rendre visite à sa voisine âgée du dernier étage et à l’écrivain qui vit au sous-sol pour leur faire part de ses difficultés à cerner son objet d’étude et, peut-être, à se cerner elle-même. Josipovici, par touches délicates, met en scène cette fragilité.
Gabriel Josipovici – Hôtel Andromeda [Traduit de l’anglais par Vanessa Guignery – Quidam, 2021, 176 pages, 19 euros]
