Visite guidée
L’argentin Diego Vecchio réinvente sous la forme d’une fable subtile et ironique l’histoire des musées et sonde notre constant besoin de conserver sous vitrine les traces du passé.
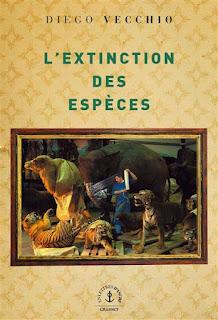
Cela commence par une histoire d’héritage, ou plutôt par « la naissance d’un fils illégitime », l’un des cent qu’aura essaimé en Angleterre « sir Hugh Percy Smithson, premier duc de Northumbrie ». Le fils en question, James Smithson, lègue sa fortune à sa mort en 1829 pour que soit fondé à Washington « un établissement portant son nom, dédié au progrès et à la diffusion du savoir auprès de tous les hommes ».
Jusqu’ici, tout est vrai ou presque. Ensuite, ça se complique. La fiction distord le réel pour mieux nous en offrir un portrait précis, « surréel » au sens le plus littéral. Sur un ton docte et pince sans rire, qui n’est pas sans rappeler Borges, bien sûr, mais aussi Juan Rodolfo Wilcock, Diego Vecchio nous raconte par le menu l’histoire de la muséification galopante du monde, une épopée qui ne pouvait commencer qu’au XIXème siècle, celui par antonomase de la science dans tout ce qu’elle a de plus sérieux et de plus délirant, et qui ne pouvait commencer que dans un pays neuf et persuadé de sa grandeur, pour ne pas dire sa mission : les États-Unis. Ainsi, « que l’héritage de James Lewis Smithson fût arrivé au moment où il était arrivé était une preuve supplémentaire de l’existence d’une Loi qui régissait l’univers avec une préférence marquée pour l’Amérique ».
Ça commence aussi par le commencement, les dinosaures. Zacharias Spears est nommé à la tête d’un « château smithsonien » flambant neuf dont l’architecture prétentieuse vient donner un peu d’élan à une ville de Washington qui « était une localité à peine plus vaste qu’un village », mais qui « aspirait à devenir une grande capitale ». Spears, fort de sa découverte d’une technique idoine pour la conservation des animaux empaillés, n’a plus qu’à remplir les lieux. Après avoir racheté plusieurs collections chaotiques de cabinets de curiosité, il allait mettre un peu d’ordre dans tout ce bazar et créer le premier véritable Musée d’histoire naturelle : « Quand les visiteurs auraient traversé le hall de l’entrée Nord, les aiguilles d’une horloge hypothétique commenceraient à tourner à l’envers à une vitesse vertigineuse, indiquant un temps rétrograde où le jour présentserait l’hier, l’hier l’avant-hier, un temps antérieur à la naissance des nations modernes, à l’effondrement des empires et à la fondation des religions les plus anciennes, à l’invention de l’horloge, un temps précédent le temps, où une seconde équivalait à plusieurs millions d’années, quand la Terre n’était qu’un bébé astre à peine sorti de l’utérus du soleil ».
Les dinosaures, donc : très vite, la machinerie se met en branle, d’autres musées ouvrent un peu partout dans un pays encore en construction, et c’est la course à qui rassemblera le plus d’ossements fossiles trouvés dans les couches stratigraphiques des monts et des vaux. Les enchères grimpent, on s’arrache à prix d’or le moindre fémur de stégosaure et on se tire dans les pattes pour mettre la main sur un squelette complet de ptérodactyle. Le public suit, en masse, puis se lasse. Voici que le cours en bourse des dinosaures est en chute libre et qu’une nouvelle passion naît, plus américaine : celle des restes des peuples « natifs », tous ces indiens qu’on massacre et parque allègrement et qui ont l’audace de vivre à l’âge de pierre en plein XIXèmesiècle lancé à toute vapeur vers la civilisation. On lâche à travers le pays des missions d’exploration, en quête du moindre couteau taillé dans un os, du moindre enfant momifié, on crée ou recrée le grand récit du passé. Les musées se font déjà spectacle et c’est la surenchère généralisée.
On en arrive forcément à la question du premier « homonculidé », lequel, évidement, ne croyez pas les bêtises qu’on vous raconte ailleurs, est américain. Qu’importe si on n’a qu’une mâchoire – édentée, pour comble de malheur – à montrer, cela n’empêchera de monter « le plus grand musée du monde, à faire pâlir l’Europe miteuse ».
Qui dit conservation dit technique de conservation. Ainsi, une secrétaire parcourt la vieille Europe – miteuse, décidément – en quête de tableaux de maître à restaurer. Plus que contre L’extinction des espèces – titre ironique du livre –, c’est contre l’extinction du passé qu’on prétend lutter. Et le passé, muséifié, bien rangé et classé dans de belles salles ventilées où s’ennuient les gardiens, est la fiction suprême, ce que Vecchio a bien compris. Pourquoi, dès lors, ne pas en profiter pour imaginer, par exemple, un récit de la création du monde où cette bestiole elle aussi bien américaine, l’écureuil, occuperait une place centrale ? Pourquoi ne pas réinventer les langues, les coutumes et les cosmogonies des diverses « sociétés primitives » qui peuplèrent l’Amérique et sont maintenant à l’agonie ?
L’écriture de Vecchio, dans son apparente simplicité, celle des contes, qui joue de la répétition et du décalage subtil, se fait alors terrain de jeu infini. L’anthropologie et l’ethnologie deviennent de grandes machines qui s’emballent et réinventent la sexualité, les genres, les hiérarchies. Comme dans ses précédents livres, Microbeset Ours, l’auteur aime faire légèrement dévier les codes, l’air de rien, glissant le vers de son humour dans le fruit du savoir. L’extinction des espèces en est sans doute l’incarnation la plus réjouissante et la plus ambitieuse.
Diego Vecchio – L’extinction des espèces [Traduit de l’espagnol (Argentine) par Isabelle Gugnon – Grasset, 2021, 224 pages, 20 euros]
