Depuis quelques jours, le quotidien algérien LIBERTÉ ouvre ses feuilles aux gens de lettes, qu’ils soient libraires, éditeurs, auteurs, critiques… Nous reproduisons ci-dessous ces interventions.

Par Hana Menasria, le 23-09-2021
SELMA HELLAL, COFONDATRICE DES ÉDITIONS BARZAKH
“La littérature nourrit l’imaginaire et façonne un individu libre”
“Alors que les espaces de liberté se réduisent comme peau de chagrin, ici en Algérie, et que notre aptitude à penser, à rêver, semble comme neutralisée, sous l’effet de l’épuisement, du désenchantement, de la peur aussi. La littérature nourrit l’imaginaire et, ce faisant, façonne un individu libre.”
Liberté : Vous êtes la cofondatrice des éditions Barzakh, qui viennent de célébrer leur 20e anniversaire. Pourquoi avoir choisi l’édition ?
Selma Hellal : Était-ce une vocation ? Pour Sofiane Hadjadj, mon compagnon et partenaire dans l’aventure, assurément. Quant à moi, le métier est venu à moi comme je suis venue à lui par une série de concours de circonstances – dont celle, décisive, de ma rencontre avec Sofiane. En guise de boutade, je serais tentée de détourner la fameuse formule de Samuel Beckett, qui, à la question “Pourquoi écrivez-vous ?” répondait : “Bon qu’à ça.” Nous pourrions également faire nôtres ces mots de l’éditeur Jean-Jacques Pauvert, extraits de ses mémoires(1) : “Les livres, c’est un monde à part. Un monde de fête. Un monde secret. Chacun, je suppose, a le sien, comme moi.”
Est-il commode de vivre de ce métier en Algérie ?
Non, surtout quand on est un éditeur indépendant qui, de surcroît, ne peut compter ni sur des mécanismes rodés et récurrents de soutien à l’édition pensés par une politique publique du livre, ni sur la manne du livre scolaire et parascolaire. D’ailleurs, il n’est pas étonnant que, souvent, dans l’histoire de l’édition, les éditeurs indépendants viennent d’un milieu relativement aisé. Il n’est que de citer deux éditeurs français : François Maspero (il paraît qu’il se plaisait à se décrire comme “un bourgeois qui trahit la bourgeoisie”) ou Jérôme Lindon des éditions de Minuit.
Ils n’ont pu mener à bien leur aventure, au début du moins, que parce qu’ils avaient un capital économique et social leur permettant de faire face à l’adversité consubstantielle à l’exercice de la profession.
Nos trajectoires et catalogues ne sont en rien comparables, d’autant que nous ne nous sommes pas construits aux mêmes époques et dans le même pays, mais c’est bel bien un métier dont il est difficile de vivre, plus que jamais en Algérie. Il reste que Sofiane et moi sommes conscients de la chance que nous avons, celle d’avoir pu faire d’une passion un métier. C’est un luxe.
Les libraires ont du mal à “survivre”. Cette situation est-elle due à l’absence d’un lectorat ou à d’autres raisons ?
Il faudrait des études, des recherches, des sondages pour donner une réponse étayée et documentée. (Je salue ici l’initiative de Hadj Miliani, décédé il y a quelques jours, qui, secondé par un collectif, menait depuis des années, avec endurance, une enquête d’envergure sur le secteur de l’édition et le lectorat en Algérie.) Le lectorat existe sans aucun doute, en tout cas il est plus nombreux que celui qui fréquente la librairie : c’est un lectorat “dormant”, pour ainsi dire, qui se révèle, se donne à voir, lors du Sila, des conférences à l’université (où les amphis sont souvent pleins), des trop rares rencontres organisées dans les maisons de la culture, des salons du livre locaux.
Mais la librairie (comme tant d’autres maillons de la chaîne du livre) est en danger : elle aurait besoin d’être soutenue, de bénéficier d’allègements fiscaux, elle aurait besoin que son personnel soit formé, que son essaimage à l’échelle du pays soit encouragé par des mécanismes d’aide systématiques et finement réfléchis. Est-il concevable que le plus grand pays d’Afrique en termes de superficie, peuplé de 44 millions d’habitants, n’ait que 15 à 20 librairies dignes de ce nom sur tout son territoire ? Nous sommes loin de la librairie considérée, sous d’autres cieux, comme un “commerce de première nécessité”.
Selon vous, quel est l’intérêt de la littérature dans la société ?
C’est une réponse bateau, mais je ne crains pas de la marteler encore et encore, aujourd’hui plus que jamais, alors que les espaces de liberté se réduisent comme peau de chagrin, ici en Algérie, et que notre aptitude à penser, à rêver, semble comme neutralisée, sous l’effet de l’épuisement, du désenchantement, de la peur aussi. La littérature nourrit l’imaginaire et, ce faisant, façonne un individu libre.
Elle crée un espace inaliénable, inviolable, où un “je” peut rêver, se confronter à l’altérité, à une infinité de mondes possibles, et donc cultiver sa liberté de pensée, son autonomie, sa capacité à réfléchir, à interroger – et donc remettre en question – les contraintes et les cadres que sa société, le système politique dans lesquels il vit lui imposent. N’est-ce pas d’une puissance inouïe ? Je me rappelle certains vendredis de mars-avril 2019, alors que nous vivions ces jours d’allégresse et d’effroi mêlés, j’étais, devant le déploiement des forces de sécurité, les fourgons anti-émeutes, les hélicoptères, les policiers en civil avec leur talkie-walkie, ceux en tenue – avec leurs casques, matraques, protège-tibia et protège-bras, tels des tatous androïdes –, hantée par le texte de Qui se souvient de la mer ? de Mohammed Dib. J’avais, de façon troublante, la sensation d’être un personnage de ce roman halluciné et extraordinairement subversif. Je convoque cette anecdote personnelle pour illustrer de manière très concrète, peut-être triviale, l’influence de la littérature sur l’intimité d’une conscience individuelle (avant même d’appréhender son impact sur la “société” en général), à l’origine d’une expérience intime où poétique et politique coïncident de manière vertigineuse. C’est la grâce de la littérature.
À votre avis, les auteurs algériens sont-ils assez impliqués dans les questions politiques, culturelles ou économiques du pays ?
Nous militons, Sofiane et moi, pour une littérature affranchie de toute idéologie et de tout message à délivrer. Nous aimons les eaux troubles de la complexité, les récits polyphoniques et diffractés, où tentent de se dire, de se mettre en mots, avec un souci de la langue et du style, plusieurs vérités et non une Vérité.
Selon nous, ces bruissements, ces grésillements ne peuvent se capter et se transcrire (comme on dit d’un sismographe qu’il transcrit les secousses et les grondements de la Terre) que si l’écrivain, dégagé de toute assignation, se concentre sur son œuvre d’écriture et exclusivement elle.
Ce qui, pour autant, ne l’empêche pas de se sentir intimement atteint par l’état du monde et de son pays, intimement re-lié aux autres et à l’humanité et de faire œuvre de citoyen et/ou de militant – oui, comment ne pas à être affecté par le caractère proprement indéchiffrable de ce que nous expérimentons aujourd’hui en Algérie, et de si difficile, de si douloureux à cerner et nommer ? C’est encore Mohammed Dib que je convoque, dont la trajectoire est à cet égard exemplaire : de l’engagement assumé de la Trilogie Algérie (1952-1957, période de la colonisation et de la guerre d’Indépendance) au “désengagement” radical (exemple de La Trilogie nordique, fin des années 1980, début des années 1990), avec des interventions intermittentes de textes à la forme singulière, éclats, constellations, plus ou moins aux prises avec des questions contemporaines (exemple, entre autres, de La Nuit sauvage, 1995).
Je le cite encore : “Je m’embarquais pour un voyage qui, sans me faire quitter ma terre encore, allait me conduire en terre inconnue et, dans cette terre, de découverte en découverte, et que plus je pousserais de l’avant, et plus j’aborderais de nouvelles contrées, plus je ferais, en même temps mais sans m’en douter, route vers moi-même.”(3) C’est ce qu’il nomme “Les voies de l’écriture”, lesquelles frayent bel et bien ailleurs loin des “questions politiques, culturelles ou économiques du pays” citées dans votre question.
Entretien réalisé par : Hana MENASRIA
1- Jean-Jacques Pauvert, La Traversée du livre, Viviane Hamy, 2004.
2- Tlemcen ou les lieux de l’écriture, Barzakh, 2020 (1re édition : La Revue Noire, 1994).
3- Idem.

Par Boualem SANSAL, le 23-09-2021
La littérature est aussi une grande école de l’évasion carcérale. La liberté est un poème, elle se vit en plein air.”
À une jeune journaliste française qui lui demandait s’il était aussi célèbre en Algérie qu’il l’était dans le vaste monde, Kateb Yacine, qui ne ratait jamais l’occasion de tout mélanger pour clarifier les choses, lui aurait répondu : “Oui c’est sûr je suis très connu au bled, mais les uns pensent que je suis un boxeur et les autres pensent que je suis un footballeur.”
Les moins de vingt ans ne le savent pas, parce que personne ne le leur a dit, mais en ces années coloniales d’avant 62, la boxe et le football étaient les seules voies pour les jeunes Algériens dégourdis et ambitieux de se faire une petite place dans la vie.
Les jours sont passés, la boxe a perdu son lustre d’antan et le foot s’est professionnalisé à ce point qu’il est devenu l’affaire exclusive des commerçants très puissants et d’officiels de haut rang qui veulent se donner un petit air chaâbi pour mieux tromper le peuple, qui n’étaient vraiment pas le genre d’oiseaux que le poète Kateb rêvait de fréquenter. À cette même question, s’il était vivant parmi nous, je crois qu’il répondrait : “C’est sûr, tout le monde me connaît au pays mais peu savent qui je suis, pour la plupart je suis seulement un nom et un prénom. Ne me connaissent que les anciens, aujourd’hui garés des révolutions, mais ne le disent à personne de peur que le gouvernement les jette en prison pour atteinte au drapeau national ou leur enlève leur pension de retraite.”
Le fait est que le grand Kateb connu et célébré jusqu’en Chine et au-delà (ce que j’ai pu vérifier en allant dans tous ces pays) n’a même pas une impasse de quelques mètres à son nom dans un pays qui mesure 2,4 millions de kilomètres carrés, sur laquelle “ils” auraient pu écrire à même le mur cette simple mention : “Kateb Yacine, 1929-1989”, alors que la France, l’ennemi d’hier qu’il appelait “la gueule du loup”, a donné son nom à un beau jardin de Paris, dans le 13e arr. signalé par une plaque où on peut fièrement lire ceci (avec cette question en tête : pourquoi il n’est aucunement fait mention de sa nationalité ?) :
Jardin Kateb-Yacine
Ça, c’est la France, un monument de culture, un pays entièrement créé par la littérature, elle est son sang, son âme, son esprit et sa couronne royale. Chez elle, le livre est plus sacré que le Coran chez nous. La différence est que le livre raconte l’homme et que le Coran raconte Dieu et son Prophète. Un Kateb si bien nommé, qui écrivait si merveilleusement la langue de Voltaire, qui la faisait chanter comme personne, et dont sa vie même de barde errant et de bagarreur impénitent était une œuvre littéraire haletante, ne pouvait qu’être reconnu comme roi légitime et avoir droit à son jardin, fleuri toute l’année tant ses fans sont nombreux dans l’Hexagone. Et dire qu’il disait aux Français, les prenant de haut : “Chez vous, je suis dans la gueule du loup, et si j’écris en français c’est pour vous dire que je ne suis pas Français”, voilà ! Ils ne l’en aimèrent que davantage. C’est que dans ce pays, on adore aussi les rebelles, les durs à cuire ; quand en plus ils ont du panache, c’est le délire, on leur donne père et mère, et la bonne en prime.
Ce n’est pas tout, Slimane Azem a de même été honoré dans le 14e arr. à Paris (avec là cette question : pourquoi faire mention de son origine kabyle et pas de sa nationalité algérienne ?)
Place Slimane-Azem
Comme a été honoré Matoub Lounès le Rebelle, en donnant son nom à une rue du 19e arr. de Paris (avec là aussi une question, pourquoi signale-t-on qu’il a été assassiné, aucune plaque toponymique en France n’indique la cause du décès des personnalités honorées) :
Rue Lounès-Matoub
Un jour, une journaliste m’a posé la même question : “En France et surtout en Allemagne et en Chine, vous êtes connu et reconnu, l’êtes-vous aussi dans votre pays, l’Algérie ? Avez-vous reçu beaucoup de médailles, de rubans et de prix ?” N’ayant pas le talent de Kateb pour tout embrouiller afin d’être bien compris, j’ai répondu tout bêtement : “M’en parlez pas, ma pauvre dame, en Algérie, mon pays et le pays de mes frères et de mes parents, je ne suis même pas reconnu comme Algérien d’occasion, j’y vis en clandestin. Comme mes filles n’y avaient clairement aucun avenir, à cause de mon nom, je les ai discrètement exfiltrées à l’étranger où elles mènent une vie tranquille et heureuse grâce à ma bonne réputation chez les Allemands qui leur ouvrent bien des portes.
Dans cette Algérie qui torture son peuple et ses artistes, on ne donnerait pas mon nom à un galet ramassé dans l’oued, alors que, rendez-vous compte, mon nom, Sansal, veut dire pierre ponce en berbère de chez moi, les montagnes de l’Ouarsenis qui sont pour nous, les gens des djédars et des aguellids, ce que le Djurdjura est pour nos cousins de Kabylie, une tour de garde naturelle, l’ennemi on le voit venir de loin. Il faut aussi le savoir, la pierre ponce est la seule roche sur terre qui flotte sur l’eau, c’est vous dire si c’est original.
En Allemagne, et de mon vivant, mon nom a été officiellement gravé dans le marbre à l’intérieur de la fameuse Paulskirche au centre de Francfort (église protestante où en 1848 a siégé la première assemblée parlementaire élue en Allemagne qui ouvrira la voie à la formation en 1849 d’un État national allemand unitaire et fédéral).
Il est gravé parmi les noms des 70 personnalités mondiales (littéraires, hommes politiques, artistes, philosophes) qui se sont vu décerner dans cette église le Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, le Prix de la Paix, depuis sa création en 1950 à nos jours. La grande Assia Djebar, elle aussi ignorée et vilipendée au pays, s’y trouve en bonne place (elle a eu ce prix en 2000). Elle est honorée partout, en France et en Belgique où elle était membre de leurs Académies ; aux USA où elle vivait et enseignait, elle était tout simplement une diva.
En Algérie, elle n’était rien, à peine membre du PT de Louisa Hanoune. C’est une fierté pour n’importe quel pays de voir deux de ses écrivains honorés parmi de telles sommités : Albert Schweitzer, Léopold Sédar Senghor, Yehudi Menuhin, Octavio Paz, Vaclav Havel, Mario Vargas Llossa, Jorge Semprun, Amos Oz, Ohran Pamuk, Claudio Magris, Chinua Achebe, Liao Yiwu, Svetlana Alexievitch, Margaret Atwood… mais dans l’Algérie démocratique et populaire à cent dix pour cent c’est une honte qu’il faut cacher. Qu’en sera-t-il dans l’Algérie nouvelle post-Hirak, serons-nous noyés ou brûlés ?
Dans une conférence donnée en France, en 2012, j’ai eu la maladresse de dire que la littérature ne servait à rien. Les trois cents personnes présentes à la conférence ont toutes bondi au plafond. J’ai failli être lynché, le public a même commencé à évacuer la salle comme après un séisme. Il a fallu tout le talent du modérateur pour calmer la foule déchaînée. Il m’a dit sur un ton bourru : “Mais enfin expliquez-vous, pourquoi dites-vous cela ?” Le sourire est revenu sur les visages lorsque j’ai expliqué que je ne parlais pas de la France, ni de l’Europe, ni de l’Asie, ni de l’Afrique, ni du Groenland, ni de la planète Mars, mais seulement de mon pauvre pays l’Algérie qui va de ruine en ruine, l’Algérie de la SM et du DRS, du FLN et du RND, du MSP et du FIS, de Messaâdia à Ould Abbès, d’Abassi et Benhadj, de Bouteflika et des frères Dalton, du général des logis et ses adjudants, du ministère des Affaires religieuses et ses Frères Monuments comme les appelait Kateb, qui sans respect pour les autres religions ont transformé leurs temples en mosquées talibanes, des commissaires politiques, les incroyables mouhadedhs (oui, oui ils ont existé !) qui ont transformé les belles salles de cinéma et les magnifiques librairies héritées de la colonisation en centres d’endoctrinement de la jeunesse ou en boutiques déglinguées où on vend des objets en plastique, de la zlabia et de la karantita, voire rien, quand viennent les jours de pénurie et de famine. Ils se sont mis à pleurer quand j’ai ajouté que les combattants de la culture avaient été décimés, que les écrivains avaient été chassés du pays, j’ai cité Kateb, Mammeri, Dib, Farès, Assia Djebar, Mimouni, puis j’ai raconté comment les professionnels des arts et des lettres avaient été sommés de se recycler dans la propagande officielle où il y a beaucoup à gagner, je leur ai donné la liste des journalistes, des intellectuels et des écrivains qui avaient été assassinés, ceux qui étaient en sursis et ceux qui avaient réussi à passer la frontière comme jadis nos maquisards passaient au péril de leur vie les lignes Morice et Challe. Ils n’en croyaient pas leurs oreilles, ils étaient sidérés, horrifiés, dégoûtés, révoltés.
Beaucoup croyaient que l’Algérie avait fait la guerre à la France coloniale pour l’indépendance, la liberté, la justice, la dignité, la culture, la prospérité, la sécurité, la littérature pour tous, le bonheur quoi et qu’elle devrait normalement ressembler à la Californie et pas au Bangladesh après la mousson. C’est du moins, ont-ils précisé, ce qu’ils avaient cru avoir entendu dire. Je leur ai dit que cela était vrai hier et avant-hier depuis l’Émir Abdelkader en 1830, jusqu’au 19 mars 1962 mais que depuis le frère Ben Bella jusqu’au frère Zeroual, cela ne l’était plus. Les choses s’étant ensuite dégradées à ce point qu’il n’est plus possible d’imaginer une nouvelle indépendance à moins de quarante millions de morts et de disparus, ce qui serait si fou qu’il vaudrait mieux prendre son mal en patience et attendre que le fruit pourrisse et tombe de lui-même .
À ceux qui me demandaient pourquoi le peuple n’en appelait-il pas à l’ONU, à la CIJ, à l’OTAN, à l’OUA, à l’UE, j’ai expliqué que les Algériens étaient comme ça, ils n’aiment pas avouer leurs faiblesses devant les étrangers et les appeler au secours.
Un jour, j’ai rencontré un homme de théâtre parisien réputé qui avait bien connu Kateb. Il m’a dit : “Quand Victor Hugo est mort, la France lui a fait des funérailles nationales grandioses et chaque année on commémore sa naissance comme un cadeau du Ciel. J’étais un porteur de valise, j’ai milité pour l’Algérie, mais j’ai cessé de croire en ce pays quand j’ai vu comment il a traité ses héros, allant jusqu’à les assassiner, tels Abane, Khider, Krim, Boudiaf. Quand j’ai vu comment est mort Kateb, dans la misère et l’indifférence, j’étais horrifié. Kateb n’était pas un héros, il était plus que cela, il est de ceux qui fabriquent les héros de demain, sont déjà dans le Hirak et dans les prisons, car ce sont les grands écrivains qui font rêver les peuples et font naître parmi eux les héros qui les mèneront à la victoire. Un pays qui tue ses héros et ses artistes ne peut pas survivre longtemps, il encourage la médiocrité et la lâcheté, la corruption et la trahison, et en cela il œuvre à sa propre fin.”
Vous me demandiez “une réflexion sur le rôle et l’utilité de la littérature dans la société”. Eh bien la voilà en une phrase : “Son rôle et son utilité c’est de fabriquer les héros de demain, c’est sa seule raison d’être.” Si ça se trouve, nos héros Boudiaf, Aït Ahmed, Ben M’hidi, Abane Ramdane, qui étaient de parfaits francophones, avaient lu Victor Hugo, Zola, Balzac, Voltaire… Quand on lit leur proclamation du 1er Novembre 1954, on comprend tout, ils sortaient de l’école littéraire qui forme les héros. Quand on écoute les proclamateurs actuels, on comprend tout, le cancer et ses métastases, la pandémie et ses variants. On comprend qu’il faut vite exfiltrer ses enfants pour les sauver et les mettre à bonne école. De ce point de vue, la littérature est aussi une grande école de l’évasion carcérale. La liberté est un poème, elle se vit en plein air.

Par Akli TADJER, le 23-09-2021
C’est par le livre que les consciences s’éveillent. Pour ma part, je leur dois tout. Ils m’ont toujours accompagné. Ils sont comme des petits amis bien plus savants que moi. Ils m’ont permis de découvrir d’autres cultures, d’autres horizons, d’autres coutumes, d’autres peuples, d’autres religions. Ils m’ont apporté les rires, les chagrins, les tourments, les larmes et mes premiers émois. Certains livres m’ont dérangé, enragé, ébranlé mes convictions, et il m’est arrivé d’admettre que je n’avais pas toujours raison. Lire m’a aussi appris, et c’est peut-être l’essentiel, qu’il ne faut pas avoir peur de se remettre en cause. La lecture met à bas nos préjugés, préjugés sous hérités de nos aînés, de notre culture, de notre histoire. Je plains ceux qui ne lisent plus parce qu’ils ont la certitude de détenir la vérité. Ne plus lire, ne plus s’instruire, c’est ne plus rien attendre de demain puisqu’ils savent tout sur tout. C’est pourtant le doute de chaque jour qui vous fait réfléchir, imaginer, avancer. Lorsque j’ouvre un roman, je sais que je vais partir à la conquête d’un univers insoupçonné, que des personnages vont me raconter leurs peines et leurs espoirs. Car on ne conçoit pas le monde selon que l’on vive à Alger ou à Tokyo. Mais par-dessus tout, un roman, c’est la vie sans les temps morts, voilà le miracle de la littérature. Ce sont tous ces livres que j’achetais d’occasion par paquet de dix qui m’ont donné le gout des mots, de leurs nuances, de leurs subtilités. Ces mots qui mis bout à bout forment des phrases puis racontent des histoires. Et c’est grâce à tous ces voyages que j’ai, moi aussi, voulu voyager dans le monde des lettres. La littérature n’est pas seulement le fait de nous enchanter en racontant une histoire, elle peut être une arme efficace pour transmettre des idées, dénoncer l’injustice faite aux femmes, moquer la bêtise humaine, lutter contre le fanatisme pour faire évoluer les mentalités. S’agissant de l’évolution de la société, je pense en particulier au plaidoyer de Victor Hugo pour l’abolition la peine de mort dans : “Le dernier jour d’un condamné.” Voilà un texte puissant qui m’a marqué pour toujours.
On le voit bien, c’est par le plaisir du texte que le lecteur peut prendre conscience des problèmes de la société dans laquelle il vit et de la manière possible de les résoudre. C’est aussi par la lecture et la lutte contre l’illettrisme que l’on combat la ségrégation culturelle. Ainsi, je ne décline jamais d’invitation à me rendre dans des lycées de quartiers déclassés, c’est ce que je considère être la fonction sociale de l’écrivain. À mes confrères qui refusent ou rechignent d’aller vers ces Autres qui ont besoin d’aide et d’attention, je leur dis : vous pouvez avoir du succès, la notoriété, l’argent, si vous n’avez pas le cœur de rencontrer ces jeunes-là laissés au bord du chemin, vous ne valez rien.
Pour conclure, étant issu d’un peuple qui a subi les outrages de la colonisation et depuis son indépendance les affres d’une liberté toujours remise pour une autre fois, je sais qu’écrire c’est mettre son talent au service de ceux qui ne peuvent s’exprimer en leur donnant une voix.
________________

Par Habib TENGOUR, le 23-09-2021
Pourquoi la littérature ? Pour vous, pour la société, pour les humains ? Pour qui ou quoi un écrivain écrit-il ?
Questions que l’on pose toujours aux écrivains ! Questions auxquelles les écrivains n’ont pas toujours une réponse satisfaisante. Au fond, la réponse de Beckett, dans son laconisme, résume bien ce qui motive un écrivain à écrire, il n’est bon qu’à cela. Et c’est tant mieux. L’écriture est une nécessité à laquelle l’écrivain ne saurait se soustraire. N’est écrivain que celui qui se soumet à cette nécessité. C’est là un truisme. Souvent, quand l’écrivain sort de son domaine pour s’investir ailleurs (on l’y incite souvent et lui-même parfois le désire, titillé par de mauvais démons), le résultat est catastrophique, quand bien même il est encensé pour cet engagement. Cela ne veut pas dire que je défends l’écrivain retiré dans sa tour d’ivoire. L’art pour l’art n’a pas plus de sens que l’art reflet du social. Finalité sans fin, l’art se suffit à lui-même, exigeant de l’artiste une servitude volontaire. Je pourrais m’arrêter là, mais je ne voudrais pas frustrer le lecteur de votre journal. Et, puisque les questions sont posées, il faut bien y répondre franchement. Il s’agit bien sûr de ma réponse ; je ne saurais dire ce qu’il en est pour les autres écrivains, pour la société ou pour les humains. Une réponse personnelle qui ne se prétend pas à une vérité indéniable.
Pourquoi la littérature ? C’est que l’homme ne vit pas seulement de pain…
La littérature, pas dans le sens péjoratif d’artifice (et tout le reste est littérature), est à la fois nourriture terrestre et céleste. Loin d’être un supplément d’âme, la littérature, quand je parle de littérature j’entends par là la poésie (elle se trouve aussi dans le roman, dans le théâtre, dans l’essai…), est l’âme même du monde. C’est un peu grandiloquent, c’est comme cela, je le pense toutefois. La poésie est pour moi ce qui fonde l’être, ce qui l’assure dans son existence et l’ouvre à l’inconnu, non pas en le lui dévoilant, mais en le lui faisant pressentir tout en demeurant inconnu.
Elle lui permet de goûter à la beauté et d’en être ébloui et métamorphosé. Grâce à la poésie, l’homme communie avec le reste des humains, découvre toutes les ressources de son humanité et accède peut-être aux mystères de la divinité. Ce n’est pas un hasard si les mystiques de toutes les religions, et particulièrement dans le taçawwuf, ont exprimé leur extase dans des poèmes qui nous bouleversent encore aujourd’hui. Nous avons besoin de la littérature pour vivre en harmonie avec le monde et nous retrouver en communion avec les autres. La littérature est le trait d’union qui nous permet de nous orienter.
Maintenant pour qui et pour quoi écrire ?
Cela dépend bien sûr de ce que l’on écrit et du moment de l’écriture. Tout écrivain a en tête un lecteur idéal, celui que Baudelaire admoneste : Hypocrite lecteur – mon semblable –, mon frère !
En ce qui me concerne, certains de mes textes sont destinés à des personnes précises, mais la plupart s’adressent au lecteur inconnu amateur de poésie en espérant que ce frère soit animé d’intention pure. J’ai commencé à écrire pendant l’année 1962. J’étais au lycée, en troisième. Au programme de français, le romantisme. J’avais débuté par des saynètes satiriques sur mes camarades de classe. Un jeu ! Au printemps, avec la lecture de Lamartine, de Musset et du roman de Goëthe Les Souffrances du jeune Werther, je me suis mis à écrire des poèmes d’amour destinés à des copines de classe. Le jeu devenait plus sérieux, mais j’étais encore loin d’être pris au piège. C’est Victor Hugo qui m’inculqua le virus de l’écriture. La lecture de Victor Hugo en cette année-là – c’était le centième anniversaire de la publication des Misérables – me stupéfia complètement. J’ai dévoré tous les livres trouvés dans la bibliothèque municipale de Massy et celle du XIXe arrondissement de Paris ; j’ai acheté chez des bouquinistes Les Orientales, Les Odes et Ballades, Notre Dame de Paris, La Légende des siècles, Les Contemplations… Mustapha Kaïd m’avait offert Les Châtiments avec La Mère de Gorki et Le Matin des villageois de Tchao Chou Li pour ma réussite au BEPC. Je lisais beaucoup en même temps que j’écrivais. Ainsi allait se referma le piège des Temps Modernes sur mes frêles racines (Kateb Yacine). Comme Victor Hugo, je voulais tout faire, du théâtre, du roman, de la poésie. Être l’écrivain témoin de son temps, porté par son peuple et porteur d’une parole inouïe, expression d’un moi et d’une conscience collective. L’indépendance me donnait des ailes. Le rêve de produire un chant qui magnifie les souffrances endurées durant la colonisation. Ambition naïve ! Inconscience de jeunesse ! Peut-être fallait-il cette inconscience pour oser s’affronter à l’écriture… Avec l’été 1962 et les luttes fratricides pour la prise du pouvoir dans le pays, je lisais Guerre et Paix de Tolstoï, je perdis mes illusions dans une Algérie libre et démocratique. Pourtant, je continuais à espérer dans un avenir plein de promesses…
Paradoxalement, c’est en lisant Les Orientales d’Hugo que je retrouvais les mu’allaqât entendues dans mon enfance. Avec Le Voyage en Orient de Nerval, Les Paradis artificiels de Baudelaire, d’autres images me remontaient en mémoire…
Deux années plus tard, en 1964, la lecture de Gens de Dublin de Joyce allait me désorienter complètement et me faire réviser ma conception de l’écriture. Abandonner une ambition démesurée pour s’engager dans une autre tout aussi périlleuse. Pour qui et pour quoi écrire devenaient des questions oiseuses, inutiles ; seul comptait le fait d’écrire et d’explorer méthodiquement et sans complaisance toutes les arcanes de l’écriture. La langue d’écriture n’était plus un problème malgré les injonctions du pouvoir politique à n’écrire que dans “la langue nationale”. Je comprenais peu à peu qu’un écrivain n’écrit jamais dans sa langue maternelle ou nationale mais dans une langue étrangère qu’il traduit dans son étude pour en faire sa propre langue, trouver sa formule. La langue nationale est langue de l’information, de la paperasse administrative, du discours politique, alors que la langue littéraire est toujours langue étrangère apprivoisée par un auteur pour la rendre audible au public qui veut bien l’entendre.
Que de faux problèmes et de déboires subis par ma génération à cause de cette question linguistique ! Je comprenais aussi combien la traduction des littératures “étrangères” est indispensable pour partager ensemble les œuvres de tout temps et de partout dans le monde, car la littérature appartient à ses lecteurs. La traduction permet aussi à chaque auteur de remettre ses pendules à l’heure.
Pour se confronter au travail d’écriture, ne pas hésiter à prendre exemple sur des devanciers prestigieux, à s’attacher aux grands auteurs classiques de la littérature universelle, sans oublier les nôtres, Kateb, Dib, Feraoun, Mammeri, Sénac, Amrouche et tant d’autres qui nous ont ouvert la voie de l’écriture. Il y a aussi les contemporains avec qui on partage l’air du temps. En vérité, on n’écrit jamais seul bien que tout seul devant sa feuille blanche. Ne pas en tenir compte, c’est se fourvoyer…
Écrivant depuis tant d’années, j’ai fini par accepter ce que me répétait tout le temps Abdallah Benanteur : l’artiste est au service de son art, il n’a pas à s’en servir pour son propre compte. Il n’a rien à demander ni à se préoccuper de la réception de son travail, seulement à faire du mieux qu’il peut. À s’y atteler modestement, chaque jour, sans relâche.
Servir humblement l’écriture au lieu de l’utiliser à d’autres fins me semble aujourd’hui la seule façon de mener à bien une œuvre littéraire de qualité. Toute injonction extérieure à la nécessité intérieure d’écrire ne peut que dévoyer le résultat. En tout cas, cette posture me permet de mener tranquillement mon travail.
_____________________

Par Sidali Kouider FILALI, le 23-09-2021
Lettres ou ne pas lettres, là est la question !
Question subsidiaire. La littérature est-elle essentielle, vitale ? Peut-on vivre sans littérature ? Certainement ! Mais à défaut de convenir de sa prépondérance, il serait plus judicieux d’y répondre autrement. Car, c’est souvent l’absence qui nous renseigne sur l’importance des choses perdues. Que vaut un monde sans littérature ? Un monde où l’on ne saurait rien des complaintes philosophiques d’un aveugle du 11e siècle dans un village perdu du Levant musulman, ou sans le cri de cœur libérateur d’une Blanche pour raconter la douloureuse histoire de l’esclavage dans l’Amérique du 19e siècle, entendue par des millions. Un monde fade dépourvu de la subtilité grecque et de sa logique, de la poésie arabe et de son prestige, dénué de l’envoûtant érotisme persan et de la sagesse chinoise et son raffinement. Un monde sans le détail bluffant d’un récit de misère et d’amour d’un Sud-Américain ou celui qui transmet sans rien perdre, l’arôme ineffable d’un café égyptien des années 1940 ! Une vie qu’on aurait vécue sans s’abreuver des lumières européennes du 18e siècle, sans s’émerveiller en révérence devant les derniers mots d’un courageux poète condamné à mort devant l’arbitraire, ou sans frôler la prétention insolente d’un villageois, apprenti bourgeois dans la quête de la réussite parisienne. Un monde où l’on ne prendrait pas les sentiers escarpés d’un écolier kabyle en pleine guerre, où on ne saurait rien de la mollesse quotidienne d’un adolescent américain dans les champs de pommiers du Missouri, ou le discours abjurant la servitude d’un jeune convaincu contre l’oppression, ou encore, sans ces geignements meurtris de deux amoureux séparés pour que demeure éternelle leur histoire. Un monde terne sans mélodie, sans la magie du verbe, sans les récits d’évasions et les innombrables illusions, sans l’évocation des grands amours et leur puissance et des petites peines et leur réminiscence. Un monde où l’on se suffirait de son seul regard pour peser le monde quand on peut le voir à travers d’autres langues, d’autres yeux et d’innombrables regards. Se suffire de son rêve quand d’autres rêves plus beaux existent, se confronter seul à sa peine quand on peut la noyer dans celle des autres.
La littérature est la mémoire du monde, son passé, mais aussi son présent et son avenir. Elle porte entre ses pages jaunies, ses manuscrits perdus et ses récits infinis, toutes ses émotions, ses réflexions, ses expériences, ses peurs et ses attentes.
Elle relate ses craintes et ses espérances, ses folies et ses résistances. Elle a ce pouvoir inégalé de transmettre à des générations le récit de la beauté, la douleur des échecs, la nostalgie des moments doux, les luttes vaillantes ou les improbables infortunes.
Elle nous étrenne avec un passé riche d’expériences, nous aide à répondre à un présent souvent incompris et nous ouvre grand le chemin de cet avenir radieux auquel on aspire. La littérature offre l’immortalité, elle a ce pouvoir de nous donner d’autres vies là où une seule ne suffit pas. Avec ses angoisses et ses sourires, ses expériences et ses échecs, sa perspicacité et ses leçons, ses questions et ses dérives, ses ratages et ses désillusions.
Ouvrir un livre, c’est tuer une raison d’échec ; lire un livre, c’est, sans se déplacer, vivre une autre destinée, ailleurs, autre part. On peut refaire le monde dans un livre, l’expliquer, le pleurer, le rêver et le construire ! Des voyages d’enfants aux engagements mémorables, et des amours immortels aux chutes cruelles.
Littérature communicative, inventive ou pour le plaisir des belles lettres. On l’aime sensible, touchante, mais on la retrouve parfois violente, contraignante, surprenante et rebelle. On y raconte le monde, ses affres et ses misères, mais aussi ses raisons d’espérer, de se battre et d’y croire. Elle nous offre, tel un miroir tourné vers l’âme humaine, ses moments d’éclats, de faiblesse, de tourmente ou de haine. Elle est son apparence, son vécu, son subconscient et son détail.
C’est le journal intime de toutes les histoires. On peut, oui, vivre sans littérature, comme un homme peut survivre sans mémoire ! Sans le souvenir des beaux sourires, de son enfance, celui des aïeux, de sa terre et de l’incomparable affection de sa mère.
Vivre sans rêves, sans avenir et sans histoire. Ne plus reconnaître les odeurs, les ruelles qui nous ont vu naître, les combats humains qui nous ont forgés, les résistances, les sacrifices et les moments de liesse.
Ne plus comprendre les regards, ne plus se souvenir de soi, ne plus se comprendre, se sentir exister et finir par s’oublier et ne plus être. Une existence biologique dénuée de tout ce qui a formé et forgé l’humain depuis la nuit des temps, de tout son vécu, sa raison d’être. On peut, oui, vivre sans littérature, sans nom et sans histoire. Mais on ne sera plus des humains, juste une meute de semi-cadavres, comme ce fut, un jour, le premier soir sur terre.
_______________________

Par Adlène MEDDI, le 23-09-2021
La littérature, pour moi, est un double en un : la lecture et le texte, l’auteur et le lecteur, le contexte écrit et le moment de la lecture, l’œuvre et le temps. Surtout, la littérature n’est ni une mission, ni un message, ni un “engagement” dans le sens folklorique ou journalistique.
La littérature permet de transcender le réel, le dépasser tout en l’incarnant sous d’autres angles : je peux regarder Alger en étant (en lisant) Borges (ou son narrateur qui est un autre Borges) parlant de Buenos Aires ; ou boire mon rosé avec Malek Haddad en espérant la gazelle.
La littérature, comme les fameux Livres saints, propose une approche esthétique radicale de l’Histoire et des humains ; une manière de nous rattacher entre nous et nous lier à nos obscures origines : en cela, la littérature est une forme de généalogie rebelle, une histoire parallèle à la grande Histoire avec un grand “H”.
Le roman, la poésie, la nouvelle n’ont pas “d’intérêt” dans la société. Ils en font partie comme le syndicat, le crime ou l’urbanisme. C’est une sève qui nourrit la société en imaginaires et en possibles, une manière d’être dans la société sans y être vraiment grâce à ce moment de partage avec l’auteur qu’il soit algérien ou d’ailleurs, ou Algérien d’ailleurs.
La littérature, pour moi, est un double en un : la lecture et le texte, l’auteur et le lecteur, le contexte écrit et le moment de la lecture, l’œuvre et le temps.
Car en écrivant ou en lisant (ou/et les deux à la fois) on se connecte à l’Autre, à l’autre temps, passé ou futur, à l’instant et à l’inexistant, banalisant ces téléportations si extraordinaires au fond, nous permettant d’être en humanité, en nous, chez les autres, dans les autres et, surtout avec les autres.
La littérature n’est pas un loisir culturel, ni un loisir tout court, c’est comme le sang ou l’État, ce que l’on ne voit pas à la surface de l’émulation sociale mais qui est tellement là, au fond de nous. Elle est essentielle et non ressentie, une pesanteur de l’esprit et des vies de tous les jours : quelque chose en nous. Dedans. Et tellement vers l’Autre.
La littérature c’est aussi l’acte dans le silence de la solitude de l’écrivain et de celui du lecteur. “Penser, c’est oublier des différences, c’est généraliser, c’est abstraire”, disait Borges. Écrire est une manière de s’annuler pour être l’Autre et mourir dans le magma des multitudes d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Une solidarité sans ONG ou publicité, gratuite et profonde envers les humains qu’on dépeint et envers le lecteur qui regarde, déjà, par-dessus notre épaule durant l’acte et le silence de l’écriture.
La littérature est une mort : moment orgasmique de l’organe de l’esprit, qui nous propulse comme entité entière et consciente dans le néant de la page blanche qui devient univers, humains, histoires, sentiments, couleurs du ciel ou vagues d’océan, scène de ménage pathétique ou bombardements nourris aux confins du Laos.
Mourir en ce moment solitaire, emmitouflé dans le silence et le fracas à la fois de la page qui se noircit et des destins couchés sur le papier ou l’écran de l’ordinateur.
Surtout, la littérature n’est ni une mission, ni un message, ni un “engagement” dans le sens folklorique ou journalistique. “Les écrivains n’ont jamais modifié le sens de l’Histoire, l’Histoire qui est assez grande dame pour savoir se diriger toute seule. Les écrivains, les romanciers et les poètes, les artistes en général ne sont que des témoins, des témoins et des épiphénomènes”, écrivait Malek Haddad. Et encore ! Témoins, s’ils le veulent. Loin des injonctions conjoncturelles et des procès du moment. Un écrivain écrit car son métabolisme le lui impose, ni “l’étape” (al-marhala, dans l’acceptation des créatifs arabes des années 1960-1980), ni Dieu, ni “l’opposition”, l’Église, les copains, les amants ou monsieur le chef de daïra !
Donc la littérature est, selon moi, aussi la liberté. En tant qu’auteur ou que lecteur – ou de quelqu’un qui en parle ou suit l’actualité foisonnante de l’écrit, nationale ou mondiale – elle me permet de m’affranchir du moment, du sol, de moi-même pour oser la forme et l’esthétique, le sens inné poétique, la transparence et les “ombres” (dhilal el-kalimat) de la langue pour dénuder émotions, tabous et autres dangereuses implications – comme l’amour.
La liberté de se défaire de soi tout en étant soi : j’imagine dans une scène, dans 1994, le massacre des Ouffia sur les bords d’oued El-Harrach en 1832 et je n’y suis pas tout en y étant. Je vois le sang sur les galets (qui par leur aspect rugueux donne le nom d’El-Harrach – ah’rech), et j’entends les cris des assaillants et des derniers résistants sur les flancs glissants de l’oued et je suis là, avec vous, nous, là, au XXIe siècle, tout en constatant le massacre et l’extermination que seuls les mots, la langue peut rendre alors que l’écrit prolonge et fixe en un seul mouvement le massacre et les derniers soupirs de ces aïeux suppliciés. En cela, la littérature nous fait mériter, arracher en douceur — la douceur de l’acte d’écrire ou de lire — notre statut d’héritiers des Écritures, de Babylone à La Mecque. L’acte double, écrire et lire (et en parler, d’où l’importance des rencontres littéraires ou des échanges plus intimes) reste la technologie la plus avancée – mieux que les satellites ou les réseaux a-sociaux) pour faire communauté humaine : les présents et les absents, les lecteurs et les auteurs. Ceux qui convergent, par l’ADN et le Verbe, vers l’origine même (légendaire ou pas) d’un mot, kôn, soit : nous avons été créé (légende ou pas) d’un mot. D’une écriture. D’un verbe à conjuguer aux variants de l’univers, des humains. De nous.
___________

Par Zeyneb LAOUEDJ, le 23-09-2021
Ce n’est pas anodin de dire que la littérature est la face intime des sociétés productrices de valeurs symboliques, ou en pleine gestation. On y voit clair, à travers cette littérature, les grandes turbulences et les rêves inassouvis tout le long de l’histoire humaine. Tous les symboles et les peintures et gravures rupestres du Tassili n’Ajjer ne sont que l’image silencieuse d’une vie en plein désert. On est bien sûr loin, même trop loin, d’un juste reflet jdanovien.
La littérature demeure cette porte grande ouverte sur l’univers qui n’a pas de frontières visibles où ruissellent les richesses cumulées depuis des siècles. Elle est par excellence cette encyclopédie des peuples qui renferme poésie, arts, sagesse, coutumes… C’est le socle sur lequel se maintient et se consolide la mémoire de l’humanité.
À travers ce prisme, la littérature est devenue le ferment même de la mémoire collective qui a toujours joué, et jouera davantage, un rôle fondamental dans la reconstruction de l’essence de l’être dans toute sa dimension humaine. Elle est vectrice de valeurs humaines et moyen de transmission des cultures et des traditions qui sont l’écho du mouvement des sociétés, à travers les temps.
Dans son sens le plus large, la littérature englobe, tous genres confondus, poésie, théâtre, roman, nouvelle, chants et cultures populaires dans toute leur diversité linguistique et leur richesse qui ne dément jamais. Écouter un poème, une mélodie, un chant de bonheur ou une élégie funèbre, une musique mystique, s’éblouir devant une citation de sagesse qui vient des fins fonds de l’histoire, suivre les traces d’une légende racontée par une grand-mère et aller plus loin qu’une histoire ; aimer l’Homme et consolider les liens sociaux, renforcer et maintenir les cultures ancestrales. Apprendre dès le jeune âge à lire les pages d’une nouvelle ou d’un roman, apprécier une œuvre d’art, c’est saisir les nuances de toute une société qui s’exprime à travers les mots les couleurs et les symboles qui nous font baigner dans l’émerveillement de la création et éveillent notre imaginaire et ravivent pour l’éternité nos mémoires.
Je reste convaincue que la littérature n’est pas formalisme ou reflet mécanique de ce qui se trame dans la société ; elle est le miroir de la société dans tout ce qu’elle a de profond. Ainsi, elle n’est pas seulement un objet de plaisir qu’on savoure, mais c’est aussi un outil qui définit une époque, les vrais acteurs de la société, leurs pensées et les influences politico-culturelles. Aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé depuis l’âge classique de la littérature.
L’ère du postmodernisme des représentations littéraires, où les œuvres littéraires associent un mélange de ton critique et artificiel, nous offre beaucoup de possibilités pour que ce rapport littérature-société soit encore plus solide et plus fort. Les éléments littéraires et artistiques sceptiques telles la métaphore, l’ambiguïté, la satire, la parodie et autres font aujourd’hui de cette relation socio-littéraire un vrai champ d’investigation dans lequel se mêlent histoire et vie de la société.
Personne ne peut nier le rôle qu’ont joué fondamentalement les grands classiques universels littéraires et artistiques, les grands mythes, les épopées de Gilgamesh et d’Homère, les Mille et une Nuits et autres, dans la genèse de la conscience humaine des peuples pour une vie meilleure, refusant du coup tout diktat faisant de la liberté et les droits fondamentaux un otage afin de sévir librement.
Se soulever contre les colonialismes, les racismes, l’apartheid et toutes les injustices que risque de subir l’Homme c’est l’apanage de l’art.
Plusieurs générations de par le monde ont bouleversé les sociétés humaines en secouant les fausses constantes vers un changement radical qui met en avant l’Homme, sa liberté et sa dignité, mais qui met en branle les systèmes archaïques.
La littérature dans les programmes scolaires, sur des bases bien étudiées, bien choisies, bien réfléchies, en relation permanente avec les choix d’une société moderne, permet de créer les ponts et les passerelles avec la société, mais aussi d’autres peuples et créer des rapprochements des cultures et des histoires.
Faire de la littérature un élément de défense de la modernité, d’ouverture et d’effacement des préjugés. Plus encore, développer l’art du langage, apprendre à vivre dans un monde vaste et partagé et à se reconstruire constamment. La littérature est l’idéal de la société humaine.
Les grands écrivains que l’humanité a générés sont là pour nous rappeler la destinée de l’acte littéraire, difficile mais toujours aboutissant: Apulée, Cervantès, Ibn Tufeil, Tolstoï, Dostoïevski, Zola, Hikmet, Stendhal, Almos Oz, A. Foued-Najm, Kateb Yacine, Naguib Mahfouz…
_________________

Par Yahia BELASKRI, le 23-09-2021
En cette période difficile où tout est incertitude, la littérature est le moyen de vivre ensemble, dans la dignité, la reconnaissance de l’Autre, le différent, le proche comme le lointain.
Qu’est-ce que la littérature ? Que peut-elle ? Quelle serait son utilité ? Questions récurrentes à chaque époque. Aujourd’hui, au moment où les idéologies se sont effondrées et que les sciences sociales produisent des discours qui peinent à expliquer le monde, tous les questionnements lui sont adressés.
Peut-être faudrait-il formuler la question autrement : que sait la littérature ? La littérature ne dit pas le vrai et ne dit pas le faux ; elle est sur un chemin de crête car elle dit quelque chose mais quelque chose qui ne peut pas se dire autrement. C’est l’indicible, ce qui ne se voit pas, ne s’entend pas, ne se dit pas. Quand le poète Hamid Skif écrit “Mon pays vide et absent/Qui m’a laissé sur le pas de la porte/Mon pays d’ivoire luisant/dans la pénombre de rêves orphelins/de souvenirs ardents/Je te vis en chaque seconde/Et enrage de ne plus te tenir dans mes bras”, il fait retentir un chant de douleur, celle de l’exil, indicible. De la même manière, lorsque Kateb Yacine écrivait “Bonjour ma vie/Et vous mes désespoirs/Me revoici aux fossés/Où naquit ma misère ! (…) Et je sais que ce soir/Monteront des chants infernaux”, c’est bien la douleur indicible de son peuple dont il est question.
Et le poète-vigie (Jean Sénac) qui notait, bien avant les experts : “J’ai vu ce pays se défaire/avant même de s’être fait.” Les textes de Mohammed Dib, de Mouloud Feraoun, d’Assia Djebar, et d’autres écrivaines et écrivains, poètes, révèlent la condition humaine et le mystère de la vie, plus que ne pourraient le faire des précis d’histoire ou des travaux d’anthropologie. Sinon, comment comprendre que les psychanalystes regardent de plus en plus vers la littérature et que les historiens, les philosophes y consacrent colloques et études ?
Bien entendu, “il n’y a pas de livre qui ait empêché un enfant de mourir”, comme l’affirmait justement Jean-Paul Sartre, mais elle dévoile l’indicible et “c’est même parce qu’il y a de l’indicible qu’il y a littérature. C’est parce qu’il y a de l’indicible qu’il y a humanité, accueil possible de l’autre”, nous dit Michel Le Bris, fondateur du festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo. Ainsi, même le concept n’est plus opérable ici puisqu’il y a irruption de l’altérité, ce que l’émir Abdelkader avait compris au milieu du XIXe siècle quand il écrivait : “Qui suis-je si je ne suis pas toi/Qui es-tu si tu n’étais pas moi.” Et Proust concluait que la littérature est “la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue”.
La vraie vie, sacrée, mais pas seulement puisqu’elle est d’opposition. Elle s’oppose au pouvoir, c’est sa condition, puisqu’elle est “instrument de justice et de tolérance” et qu’“elle conteste la soumission au pouvoir” (Antoine Compagnon).
Comme elle a le pouvoir de nous faire échapper “aux forces d’aliénation ou d’oppression”, rappelle Sartre. À l’instar des arts, elle peut faire barrage à l’ignominie. Elle est d’opposition car elle prône “la défense des libertés (qui) passe assurément par l’exaltation de la liberté”, rappelle l’écrivain et poète franco-tunisien Hubert Haddad, et cela, nous le savons, le pouvoir n’en veut pas.
À l’heure du capitalisme triomphant prônant un libéralisme sauvage qui laisse sur le bas-côté des millions d’êtres, dans un monde où la haine et le rejet sont les valeurs les plus partagées, au moment où depuis plus de quinze mois nous vivons une séquence particulière due à un infime virus qui nous a séparés de nos proches, il ne s’agit plus d’espérer, dit le poète Jean-Pierre Otte, “il faut y aller vaille que vaille”, c’est-à-dire maintenir “la mèche allumée en vue d’une explosion poétique”, affirme l’écrivain Jean-Marie Blas de Roblès, et politique évidemment.
La littérature assume cette fonction.
Ce n’est pas un hasard si les peuples se reconnaissent en leurs écrivains et poètes. Lorsque Kateb Yacine a été inhumé le 1er novembre 1989, au cimetière d’El-Alia, à Alger, c’est une foule immense qui l’a accompagné. Ce fut le cas pour Georges Séféris, le poète grec, celui qui écrivait : “Ce pays, ton pays – sang et ombre/Qui sombre comme le vaisseau pour lequel l’heure du naufrage a sonné”, décédé en septembre 1971 ; plus de cent mille Athéniens ont convoyé sa dépouille en chantant son poème Reniement, mis en musique par Mikis Théodorakis. Victor Hugo salué par deux millions de Français le 1er juin 1885 lorsque son corps est transporté au cimetière dans un corbillard de pauvres.
La littérature est essentielle car “sans poèmes (…) les communautés resteraient sans âme”, nous dit Michel Le Bris.
En cette période difficile où tout est incertitude, la littérature est le moyen de vivre ensemble, dans la dignité, la reconnaissance de l’Autre, le différent, le proche comme le lointain, pas seulement l’étranger, un possible ennemi, ou celui derrière une porte anonyme, enfermé comme tous les autres dans sa solitude.
C’est à ce titre que l’on peut faire une communauté humaine. Avec la littérature, jamais sans la littérature.
______________________

Par Rabia DJELTI, le 25-09-2021 12:00
La littérature est l’hymne de la liberté
En essayant de répondre à cette question philosophique pertinente : à quoi sert la littérature ?! Question qui rôde et commence à traverser les esprits, les cultures et les langues, en ce temps occupé par les forces technologiques, bousculant les vies et les habitudes des habitants de ce globe, j’ai constaté que c’est une question qui rime avec la célèbre chanson d’Edith Piaf, À quoi ça sert l’amour, dans laquelle elle défendait l’amour face à son Théo Sarapo.
Et parce que j’ai toujours cru que la littérature est une pomme tombée du grand arbre de l’amour, saveur mélange de miel et d’amertume, je pense que dans le beau poème de Michel Emer, vibrant et dansant sur les cordes vocales et magiques d’Edith Piaf, se trouve un hymne à la littérature, cette capricieuse “Fille d’amour”.
À quoi ça sert l’amour ? : (“On raconte toujours des histoires insensées. L’amour ne s’explique pas ! C’est une chose comme ça. Qui vient on ne sait d’où. Et vous prend tout à coup. L’amour ça sert à quoi ? À nous donner d’la joie avec des larmes aux yeux ? C’est triste et merveilleux…!”)
Oui. C’est ça la littérature, la descendante de l’amour, et pour cette raison qu’elle est devenue la mémoire humaine contre la brutalité, la trace contre l’oubli, le tatouage de l’âme, la mémoire et la chanson du cœur.
Et parce qu’elle est tel un être rebelle. Elle est tantôt bien prise en charge, tantôt sur les bûches ; à travers l’histoire, des littérateurs ainsi que des amoureux ont été brûlés, et des livres aussi, ont été jetés en spectacle au milieu des flammes… beaucoup de livres. La littérature tel un être rebelle n’aime pas la stagnation, elle est là pour mettre le désordre dans l’ordre établi. Elle est la patrie de la liberté. L’hymne des femmes et des hommes libres.
Chez nous, en Algérie, comme dans les pays nord-africains et les pays arabes, les belles lettres font peur aux décideurs, aux despotes, car ils savent qu’une société éprise par l’amour des belles lettres, tantôt séductrices tantôt salvatrices, est capable d’assurer son futur sans pour autant nier son passé, ni tomber dans la sacralisation stérile.
Bien que nous ayons des belles plumes, des grands écrivains, connus et reconnus dans le monde, traduits et lus dans les quatre coins de la planète, ils demeurent maudits et marginalisés chez eux. “Nul n’est prophète en son pays”, dit le proverbe. “Le chanteur du quartier ne plaît pas aux résidants”, dit l’adage. Nous ne sommes pas un pays où la littérature peut trouver sa clémence pour un épanouissement artistique et économique. On tire sur les écrivains et on célèbre les écrivaillons. On sous-estime les éditeurs. On marginalise les librairies et on respecte les fast-Foods. Je n’ai rien contre les fast-food !
Sur le plan socioéconomique, la littérature a besoin d’un environnement particulier qui détient ses règles et ses exigences : la liberté d’expression, la liberté d’opinion, la liberté individuelle, la liberté collective, la liberté de l’espace des dires et des débats, La liberté d’échanges, la liberté culturelle et la concurrence loyale, et ne pas confondre entre “littérature” et “religion”
Il faut souligner que la littérature est un espace pour “plaire” pour “distraire”, sans tomber dans le piège du gratuit, du banal. Rien n’est dit ni écrit gratuitement. Dans la littérature, on ne rit pas pour rire, mais pour penser, pour réfléchir ; car le rire littéraire est penseur, philosophe, et le désir dans la belle littérature est anti-consommation. La littérature est un échange qui s’élance dans un voyage individuel, solitaire mais avec une vision collective, l’écrivain utilise sa créativité et son imaginaire pour explorer les autres, et pour décortiquer la société, car la littérature est une complicité entre un faiseur de mots, l’écrivain, et un buveur de mots, le lecteur. Il n’y a pas l’un sans l’autre.
Bon. Et quel est donc le rapport écriture/femme dans tout ce vacarme !?
À vrai dire, dans notre pays, être femme et écrivaine est une bombe à retardement, d’ailleurs Kateb Yacine l’a bien écrit : une femme qui écrit vaut son pesant de poudre. Et personne ne peut nier la présence intensive et qualitative de la femme écrivaine dans la création littéraire la plus distinguée.
Étrange. La littérature ne vieillit jamais, elle accompagne l’humanité dans son existence renouvelée depuis son aube, les beaux romans, les beaux poèmes ne prennent jamais de rides.
Dans mon nouveau roman Gilgamesh et la ballerine (Gilgamesh wa arraqissa), publié aux éditions Ikhtilef en Algérie et aux éditions Difaf à Beyrouth, j’ai entamé un dialogue avec l’un des plus vieux textes de l’humanité (18e siècle av. J.-C), à savoir “le mythe de Gilgamesh”. J’ai donné à Gilgamesh la chance de trouver la plante de l’immortalité et de l’avaler, ce qu’il a raté dans la légende, je l’ai invité pour une visite dans notre ère socio-politique. J’ai créé un Gilgamesh algérien face à des questions déjà posées par Gilgamesh de la Mésopotamie : l’éternité, la mort, l’amitié, la guerre, le pouvoir, la haine, la justice, la femme, la jalousie, l’amour…
– À quoi ça sert l’amour ! – Je ne sais pas.
La réponse germe encore dans la belle voix d’Edith.
À quoi sert la littérature ?! – Je sais qu’elle est capable de refaire le monde en le repensant d’une autre manière, je sais qu’elle possède une force sublime dans la douceur magique, et qu’elle est la résistance sans concession ni traîtrise.
______________________

Par Lynda CHOUITEN, le 25-09-2021 12:00
Est-ce à dire que la littérature doit impérativement épouser une cause, se faire porte-parole d’une communauté opprimée, pour justifier son existence ? Je ne suis pas de cet avis. Quand bien même elle se défendrait contre toute forme d’engagement, elle aurait quand même toute sa raison d’être.
La littérature est partout : elle est dans les contes qu’on raconte le soir aux petits chérubins pour les aider à s’endormir ; dans les feuilletons de l’été qu’on parcourt négligemment sur une plage ou qu’on suit à la télé – car, c’est bien connu, au commencement était le Verbe, qui aujourd’hui encore, doit précéder l’écran – dans le dernier succès d’Hollywood, dans les poèmes chantés par nos valeureuses vieilles lors des veillées funèbres ou, au contraire, lors des cérémonies de mariages, dans les vieux proverbes dont nous aimons à agrémenter nos propos, dans les petites expressions commodes dont nous ignorons parfois l’origine : on compare telle jolie fille à Blanche-Neige, tel goinfre à Gargantua, tel homme orgueilleux à Artaban. La littérature est partout, même là où nous en oublions l’existence, c’est pourquoi je m’étonnerai toujours de voir des gens s’interroger encore sur son utilité. Ne serait-il pas plus épineux d’essayer de trouver une seule fonction qu’elle ne remplisse pas ? Bien sûr, la littérature est distraction, elle est voyage et évasion. Quand j’ai commencé à dévorer les livres, voilà bientôt quatre décennies, c’était pour oublier le quotidien terne et trouver refuge dans des contrées plus vertes et – ainsi les imaginais-je – plus joyeuses, où les enfants, y compris les filles, jouaient du violon ou du piano, glissaient sur des patins ou pêchaient dans des lacs et des rivières. Je rêvais et, même si je ne le savais pas encore à cette époque-là, c’est par le rêve que commence toute révolution, tout changement. Car bien sûr, la littérature sert aussi à cela : à changer les choses. En dénonçant les maux de nos sociétés – ou de notre nature si imparfaite – et en nous amenant à réfléchir. En 1852, le célèbre roman d’Harriet Beecher Stowe, La Case de l’Oncle Tom, a bouleversé les Américains et le regard qu’ils portaient sur les Noirs et, en mettant en exergue les horreurs de l’esclavage, a préparé la voie à la Guerre de Sécession durant laquelle la loi abolissant cette pratique devait être promulguée. Plus près de nous, ce sont les écrivains issus des colonies (françaises et britanniques) qui ont cherché à gommer les clichés associés aux non-Blancs et à décrier le colonialisme. Qu’il s’agisse d’un Chinua Achebe répondant subtilement au racisme d’un Joseph Conrad, d’un Kateb Yacine qui “écri[t] en français pour dire aux Français qu’il n’est pas Français”, ou de tant d’autres, la littérature postcoloniale a donné une voix à ceux qui peinaient à se faire entendre en raison de leur couleur de peau. Bien sûr, ce n’est là qu’un exemple ; la littérature fait réfléchir sur la condition féminine, sur l’enfance, sur la lutte des classes – bref, sur la condition humaine sous tous ces aspects.
Est-ce à dire que la littérature doit impérativement épouser une cause, se faire porte-parole d’une communauté opprimée, pour justifier son existence ? Je ne suis pas de cet avis. Quand bien même elle se défendrait contre toute forme d’engagement, elle aurait quand même toute sa raison d’être. Nombreux sont ceux qui, n’écrivant que pour se libérer d’un fardeau – un traumatisme, peut-être, ou des émotions trop lourdes à porter, tout simplement – libèrent aussi un nombre incalculable de lecteurs, qui se reconnaissent dans les joies et les souffrances décrites par ces auteurs.
Au-delà de cet effet cathartique, c’est à réconcilier les êtres humains, en dépit de leur diversité, que sert ce processus d’identification avec l’auteur, un auteur peut être issu d’une toute autre ethnicité, d’une toute autre location géographique que son lecteur. Car au final, sous tous les cieux, les hommes et les femmes naissent, meurent, s’aiment, se haïssent, se jalousent, se disputent, s’attendrissent et se réconcilient. Quand une œuvre nous touche par-delà les frontières nationales, culturelles, ou autres, c’est à notre commune humanité qu’elle nous renvoie, nous invitant à transcender nos conflits et nos différences.
Enfin, et surtout, la littérature est une invitation au Beau. Par le biais du contact sensuel avec les mots ; par le biais des tournures et des métaphores élégantes dont elle se sert ; par le biais des mondes inhabituels qu’elle crée et du regard neuf qu’elle jette sur le nôtre. Or, la beauté, comme l’écrivait le philosophe américain Ralph Waldo Emerson, “justifie elle-même son existence”. Les œuvres que nous lisons – et que nous écrivons – nous apaisent, nous soulagent, nous ouvrent les yeux et l’esprit, mais quand bien même elles ne feraient rien de cela, nous continuerions à en raffoler parce qu’elles nous enchantent et que nous avons besoin d’enchantement. Nous avons besoin d’enchantement parce que l’être humain ne sera jamais – du moins j’ose l’espérer – un simple appareil digestif ou une machine à produire et à calculer.
Alors, je repose la question aux plus sceptiques : “Y a-t-il une seule utilité que la littérature n’ait pas ?”
_______________
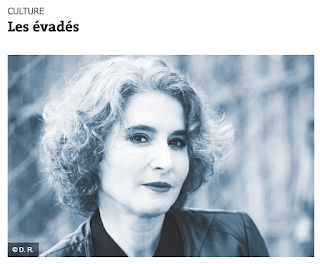
Par Malika CHITOUR, le 25-09-2021
Elle est encore venue ce matin. Comme à son habitude, la petite passe à 7h30, s’arrête un instant face à la vitrine de la librairie, regarde les nouveautés, s’en va rapidement et revient, une baguette et un sac de viennoiseries à la main. Cette fois, elle prend son temps. Elle regarde méticuleusement chaque livre, lit chaque titre. Quelquefois, elle rentre pour demander le prix d’un ouvrage, et repart songeuse. La dernière fois c’est Michel Strogoff de Jules Verne qu’elle a demandé. Elle est bien jeune pour lire cette version intégrale. Elle prend le livre et le regarde avec les yeux de l’assoiffé perdu dans le désert, qui découvre une oasis. Elle caresse d’abord la couverture. Tourne la première page lentement, religieusement, son sourire s’élargissant à chaque page nouvelle. Elle me tourne le dos. Je l’observe grâce au miroir convexe qui lui fait face. Elle approche le livre de son visage, ferme les yeux et hume les pages. Son sourire s’élargit. Elle ouvre les yeux d’un coup. Elle se réveille comme trop vite d’un rêve trop beau. Tout lui revient. L’école, le pain… Rapidement, elle me demande le prix. Promet de revenir après l’école. On est à l’heure d’après l’école, et elle est là comme promis. Elle sourit de tous ses yeux, comme d’autres le feraient face à la poupée de leur rêve ou devant des friandises. Sa friandise à elle, c’est le roman qu’elle tient dans ses mains. Elle me sort le prix demandé de sa poche en pièces d’un dinar. J’encaisse. Elle sort le nez dans son livre. Elle reviendra certainement demain et le jour d’après.
Vers onze heures, c’est Samia qui rentre comme à son habitude d’un pas décidé. Une volonté sans faille vrillée au corps. “Ramène-moi des livres, c’est tout ce dont j’ai besoin ici. Beaucoup de livres. Il n’y a que ça qui me fera tenir. Va chez le bouquiniste et troque ce que tu m’as apporté la dernière fois. L’auteur importe peu. Le livre doit être épais, ça me fera plus de lecture. N’oublie pas que c’est par eux que j’effacerais les murs de cette prison. C’est par eux que je volerais plus haut encore que les miradors.” Voilà ce que son mari lui demande trois fois par semaine. À chaque visite qu’elle lui fait. Voilà ce qu’il lui dira encore pendant quelques mois. Malgré des pages déchirées par la censure. Il préfère s’accommoder d’un livre outragé plutôt que d’en être privé. Les pages manquantes, son imagination peut aisément les remplacer. C’est son épouse qui me rapporte ses paroles. Je l’aide comme je peux. Les livres abîmés, je ne peux les reprendre, mais je peux lui en prêter d’autres, autant qu’elle en voudra Yacine est un ami de longue date. Nos études c’est ensemble qu’on les a faites. C’est la fin de la journée. C’est son heure à lui. Lui, c’est le SDF qui vient de temps à autre. Quand il est en manque. Sa drogue, c’est les romans historiques. Il rentre comme une ombre furtive. Se dirige vers le coin “livres d’occasion” calmement il fait son choix. Il commence par la quatrième de couverture, comme toujours. Il le retourne et feuillette les premières pages. Il plisse les yeux, se rappelle qu’il n’a plus vingt ans et sa vision non plus. Il tapote ses poches comme toujours, avant de se rendre compte que ses lunettes sont à leur place de toujours, le dessus de sa tête. Sa monture, c’est ce qu’il a de plus précieux. Même si les branches sont réparées au sparadrap et le verre droit fendu sur le côté. Peu importe, il arrive à lire avec, et c’est bien ça l’essentiel. Après avoir fait son choix, il ressort aussi discrètement qu’à son arrivée. Pieds nus, vêtements élimés mais riche d’un livre nouveau qui le fera prince d’un palais ou bandit au grand cœur. Un livre qui transformera sa paillasse en lit des mille et une nuits. Ce grand monsieur est pour moi la petite fille aux allumettes d’Andersen. Chaque page tournée est une allumette craquée pour échapper à un moment difficile. Il est l’heure pour moi de baisser le rideau. C’est la fin de la journée. Les comptes sont faciles à faire, je ne suis pas plus riche qu’hier et je le serai certainement autant que demain. Mais qu’importe, je suis heureux.
_____________________

Par Lynda-Nawel TEBBANI, le 25-09-2021
La littérature ne sert à rien si elle n’est pas lue ou partagée. La littérature n’est pas une étagère de bibliothèque, mausolée sacré que l’on vénère par le regard embué d’émotions de la possession. La littérature est le passage de témoin d’un savoir-être et d’un savoir-faire d’une génération à une autre.
Est-il possible pour moi de poser cette question : À quoi sert la littérature ? quand celle-ci est l’objet, l’enjeu et le cœur de mon travail, tant académique que créatif depuis plus de vingt ans. Est-il, non seulement possible, mais encore, puis-je y répondre sans me perdre dans cet interstice où je me trouve ? Cet entre-deux, tout à la fois subtil et inconfortable par moments. Cet isthme, limon d’une recherche et désert ivoire de mes écritures questrices.
La littérature est, à l’instar du roman algérien en particulier et comme j’ai eu souvent à le dire, entre fabula et utopie. En cela, entre un imaginaire nécessaire – obligatoire ? – et un inaccessible impossible à atteindre.
Que l’on soit critique ou modeste scripteur, il n’est possible de tomber dans les abysses d’un questionnement : pourquoi ? Je dirais, aussi, qu’il est impossible de trouver cette réponse. Est-ce à dire qu’un bon lecteur est celui qui garde ses questions insolubles ? Que le bon écrivain est celui qui ne répond à aucune énigme et se meut dans l’obscurité de son écriture ?
Nullement.
Je dirais, seulement, que la littérature est un miroir sans fond dans lequel l’on cherche tant à se voir qu’à voir. Par-delà un je(u) qui nous prolonge, nous voulons absolument voir en elle une résolution, une réponse, une abjuration d’une réalité qui pourtant ne se trouve pas en elle. La littérature est un piège pour l’errant – orant qui veut y trouver un chemin quand il ne fait qu’avancer dans un labyrinthe toujours plus grand que sa quête et sans fil d’Ariane pour lui faire regagner la rive d’une sortie apaisée.
On ne sort jamais indemne d’un livre. On se heurte, on se blesse, on se biffe, on se jette aux contours d’une réalité qui moins nous obsède qu’elle nous déplace. Elle déjoue nos attentes, nos préjugés et nos certitudes. La littérature, en soi, ne sert à rien d’autre, que nous rappeler nos béances dans laquelle des figures de styles et aux procédés d’écritures viennent se mouvoir pour nous habiter, et nous hanter, à la fin.
C’est cette possession, duelle, qui en fait la plus prodigieuse des prédatrices. La littérature nous habite comme une ghoula ou un djinn. Et à nous de devenir obsédé par la future apparition : qu’il s’agisse d’un nouveau texte d’un auteur qui nous a coupé le souffle ou d’une nouvelle page blanche que notre plume viendra noircir de nos idées sans nom. La littérature, en soi, ne sert à rien. Que reste-t-il lors de l’épreuve de la grande errance et du déplacement, depuis l’exil au déménagement, de la catastrophe naturelle au décès, quand vient le temps de ranger dans des cartons ces milliers de pages que l’on a religieusement conservées, gardées, collectionnées… établies sur ces centaines d’étagères afin de mieux les regarder. Les voilà, réduites à des cartons et des valises, à des choix sur ceux que l’on doit laisser de côté, pour un temps. Lesquels ? Lequel possède moins d’importance que les autres ? Quel livre aura la gloire d’être assurément conservé dans un sac léger pour mieux le protéger. Et l’on se rend compte avec désarroi qu’à défaut de ne les prendre tous. On n’en prend aucun. À choisir celui-ci, il nous faut prendre l’autre. À prendre tel auteur, il nous faut assurément l’accompagner d’un tel. Mais l’on ne peut en prendre qu’un seul. Alors le sac, linceul d’une bibliothèque à qui l’on fait ses adieux, restera vide de l’objet compact livre mais empli de souvenirs de lecture.
Et alors, réaliser.
La littérature ne sert à rien si elle n’est pas lue ou partagée. La littérature n’est pas une étagère de bibliothèque, mausolée sacré que l’on vénère par le regard embué d’émotions de la possession. La littérature est une passion qui se partage dans la lecture en coryphée et le don de son herméneutique par l’enseignant dévoué. La littérature est le passage de témoin d’un savoir-être et d’un savoir-faire d’une génération à une autre. La littérature est le souvenir d’un rêve à une réalité qui se cherche de nouveaux lendemains.
La littérature est dans le geste et dans sa queste.
La littérature est dans ce miroir que l’on croit dirigé en soi et qui n’est qu’une fine fenêtre entre ce que je vois et ce que je dois.
La littérature n’est pas un discours, ni même un langage. Tout au plus tangue-t-elle entre un rivage escarpé d’un univers idéal et un grand large d’images-chimères qui obsèdent jusqu’aux souvenirs des prochains naufrages.
Dans le barzakh de mon écriture, je ne peux dire ce que je fais de la littérature. Je peux dire ce qu’elle me fait : exister, réfléchir et grimper jusqu’à la canopée des arbres afin de mieux avoir accès à toute cette jungle de pages dont je ne soupçonne pas encore l’écho qu’elles vont me provoquer.
Ecrire, étudier, lire le verbe, c’est rappeler l’humanité qu’il nous reste quand tout autour de nous, nous amène à penser qu’elle a disparu. Prendre une page au hasard d’un geste, être ému. Poser le livre, et humer l’inattendu de la surprise.
Mais, je n’ai pas tout lu.
Je n’ai rien lu.
Car, la littérature est ce qu’il reste à découvrir, à écrire.
Entre une page ivoire d’un carnet raturé et une étagère gondolée.
La littérature sert à nous rappeler qu’il y a toujours de la place pour les souvenirs à venir. Pour le livre à venir…
___________________________

Par Anouar BENMALEK, le 25-09-2021
De la littérature et de l’espoir en Algérie
Le roman n’est pas une entreprise nouvelle. Il remplace les dessins et les peintures que les premiers hommes ont peints avec passion sur les parois des grottes parce qu’ils étaient terrorisés par l’inconnu qui les entourait. Le roman moderne fait-il autre chose au fond ?
Ah, combien il est difficile pour un écrivain de parler de ce qui constitue le sens de sa vie, la littérature et donc les mots, dans un pays, l’Algérie, où ceux-ci ne sont guère utilisés par les détenteurs des pouvoirs successifs depuis 1962 pour ce qu’ils signifient réellement, mais comme des déguisements utilisés pour farder une réalité sordide ou comme des armes langagières visant à emprisonner (au sens propre du terme de plus en plus souvent) les auteurs de pensées critiques ou jugées déviantes du point de vue social, religieux, sexuel ou que sais-je encore… En d’autres termes : où les mots-diamants de la littérature sont pervertis en mots-ordures du contrôle politico-policier d’une société destinée pourtant, comme toute autre société sur notre planète, d’abord à jouir de sa liberté.
Il me suffit de regarder, d’écouter ou de lire les médias les plus importants d’Algérie, tant ceux du pouvoir que de ceux de la multitude des puissances d’argent lui ayant prêté allégeance, pour m’interroger avec une insupportable amertume : quoi, presque soixante ans d’indépendance pour en être encore là ?
Et néanmoins, il faut continuer à se battre, sans relâche, contre le mensonge politique et social érigé en vérité, contre l’intolérance religieuse qualifiée de vertu par des lois scélérates, contre, par exemple, l’outrage permanent imposé aux femmes par des décisions de parlementaires aux ordres soucieux uniquement de leurs privilèges, contre la prédation des richesses du pays qui a vu des empires se construire presque du jour au lendemain, contre le racisme ignoble à l’encontre des immigrants clandestins, nos frères en humanité et en malheur, contre tant d’autres choses encore qui font la dignité et la grandeur d’un peuple et d’un pays.
Cette lutte incessante vers la liberté de l’esprit et de l’imagination, du corps et de la spiritualité, avec peu de victoires et beaucoup de défaites, un écrivain se doit de la poursuivre, modestement et avec acharnement, avec ce qu’il sait faire le mieux : ses livres. Non pour caporaliser la littérature au profit d’un quelconque objectif politique – ce serait, au contraire l’assassinat même de la notion de littérature, mais pour partager les fruits de l’expression de sa libre imagination avec le plus grand nombre de lecteurs détenteurs eux aussi de cette si indispensable liberté de choix, de jugement et de plaisir.
Le travail du romancier, de l’art en général, n’est pas d’être le relais servile d’un combat politique ou humanitaire. Un roman peut être politique, mais ce n’est pas là son but principal. Je crois que le rôle du roman est de créer une nouvelle réalité, un nouvel univers qui, par le biais de la magie de l’intelligence et de l’imagination de cette créature étrange qu’est l’être humain, nous aide à avoir moins peur de l’univers immense et indifférent dans lequel nous sommes condamnés à vivre… et à mourir.
Je viens juste de terminer un nouveau livre, L’amour au temps des scélérats, qui sera en librairie en septembre d’abord chez les Éditions Emmanuelle Collas en France et, si tout va bien, assez rapidement en Algérie. Je ne vais pas raconter ici la genèse compliquée de ce roman, les allées et venues, les errements mêmes, les fausses routes, les impasses, entre le projet initial et la réalisation concrète, les doutes, constants, quant à la nécessité de ce livre, l’impact considérable à mon corps défendant de l’actualité du monde, de la terrible intervention de l’Histoire, en particulier arabe, sur son écriture.
Après Fils du Shéol, j’avais décidé d’écrire enfin sur un sujet qui me tenait à cœur depuis pratiquement mon enfance : les Indiens d’Amérique du Nord. Enfant, rien ne me faisait autant rêver que les films dits western. Je dois ajouter que j’étais le plus souvent instinctivement du côté des Indiens ! Peut-être parce que nous venions de sortir du colonialisme français et que nous avions en nous une réaction instinctive de solidarité entre “indigènes”, comme nous appelaient de manière méprisante les anciens occupants européens de l’Algérie. D’autant que j’avais lu, pendant mon adolescence, une déclaration d’un président américain, Théodore Roosevelt, prix Nobel de la paix, statufié sur le mont Rushmore (montagne pourtant sacrée des Indiens Lakotas, appelée par eux Six grands-pères) : “Je n’irais pas jusqu’à penser que les seuls bons Amérindiens sont les Indiens morts, mais je crois que c’est valable pour les neuf dixièmes et je ne souhaite pas trop me soucier du dixième.”
Alors que je commençais à mettre au point l’architecture provisoire de mon livre sur les Indiens, a surgi Daech, dont les méthodes rappelaient, en moins industrielles, en moins systématiques, en moins “scientifiques”, tout en restant aussi barbares, les méthodes employées par les criminels génocidaires de mon précédent roman.
Daech, mais aussi les guerres multiples, directes ou par procuration, et les centaines de milliers de morts déchirant la géographie politique et humaine des pays de la région, de la Syrie, de l’Irak, du Yémen, etc., après les immenses espoirs de libération et de démocratisation soulevés par ce qu’on a nommé trop vite “Les printemps arabes”…
Que faire alors ? Je ne voulais plus délaisser mon projet indien : je n’ai qu’une vie et le temps qui m’est encore imparti se rétrécit probablement plus rapidement que je ne le suppose ! Mais je ne voulais ni ne pouvais ignorer ce qui bouleversait aussi tragiquement le monde arabe — plus divers d’ailleurs que ce que laisse entendre le seul adjectif “arabe” : berbère, kurde, druze, yézidi, turcoman, etc. ! Après un long temps de réflexion, j’ai décidé de tout “mêler” dans mon nouveau roman : les Indiens d’Amérique, la Syrie, l’Irak, les deux guerres du Golfe, Daech et… un petit peuple, celui des Yézidis, dont le destin contemporain ressemble fortement à celui des Amérindiens du 18e et du 19e siècles…
Pour moi, lorsque nous lisons un roman, une partie de nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, se pose inévitablement la question suivante : qu’aurions-nous fait si nous avions été à la place de la victime, de l’assassin, du témoin ? En somme, le noyau du roman est probablement la transmission d’une expérience individuelle singulière lors de la confrontation avec des conditions nouvelles objectives, dramatiques le plus souvent.
J’ai vu une fois une horrible vidéo où une femme syrienne accusée d’adultère implore le pardon de son père. Entouré de villageois et de militants de Daech, ce dernier refuse le pardon au motif qu’il était hors de question pour lui de désobéir à l’injonction divine de la lapidation en cas d’adultère. Il finit d’ailleurs par lancer lui-même la première pierre de la mise à mort, suivi par le reste des personnes présentes.
Et c’est ainsi que mon roman “indien” est devenu un roman “syrien” et que naquirent plusieurs personnages : Adams, l’Indien Lakota pilote de drones, Zayélé la Yézidie employée dans une entreprise familiale à Damas, sur le point de succomber à l’adultère, ses deux enfants Reben et Aram qui vont avoir affaire au pire de Daech, Fawzi l’Irakien qui va devenir terroriste alors qu’il ne rêvait que d’aimer sa femme, Houda et Yassir, l’apprentie chanteuse et son amant, tous les deux en fuite dans une Syrie devenue folle…
Et puis Tammouz, devenu mon personnage clé, dont la nature est ambiguë (humaine, “diabolique”, un mélange des deux), qui apparaît à deux époques: à Sumer, il y a plusieurs milliers d’années et en Syrie, en ce début calamiteux de 21e siècle.
De manière curieuse, en écrivant sur la Syrie et l’Irak, j’ai eu aussi la certitude d’écrire sur l’Algérie et sur tant d’autres pays semblables : même mépris de la part de l’État des droits individuels de ceux qu’il est censé protéger, même terrible enfermement des individus dans leurs croyances religieuses et sociales, même fanatisme meurtrier (Daech et GIA sont les deux faces d’une même réalité de haine et de meurtre au nom de Dieu), même révolte, trop souvent matée avec une brutalité inouïe, de nombre de citoyens ne supportant plus d’être traités en simples sujets soumis au bon plaisir des tenants du pouvoir politique et militaire…
Dans le projet qui est le sien de “raconter”, le roman n’est pas, au fond, une entreprise nouvelle. Il remplace en quelque sorte les dessins et les peintures que les premiers hommes préhistoriques ont peints avec passion sur les parois des grottes parce qu’ils étaient terrorisés par l’inconnu qui les entourait : les bêtes féroces, la nuit qui aveugle les yeux, la foudre qui incendie la savane, l’océan déchaîné et surtout cette mort atroce qui frappe tour à tour et de manière inexplicable, comme cédant aux caprices de cruelles puissances supérieures.
Peindre cette peur (la raconter donc) était un moyen de l’apprivoiser un peu. Sous ses oripeaux plus sophistiqués, le roman moderne fait-il autre chose au fond ? Même s’il faut ajouter, à présent, aux bêtes féroces de la jungle les bêtes féroces de la politique…
On a compté qu’il y a à peu près cent milliards de personnes qui sont mortes depuis que notre espèce existe. Oui, ces milliards de devanciers sont morts, réduits à présent au mieux à l’état d’atomes, intégrés çà et là à d’autres êtres vivants, à des rochers, à l’eau des océans, à l’air que nous respirons…
Mais avant d’être morts, ces êtres humains ont connu une expérience extraordinaire, inimaginable, rarissime dans ce cosmos peuplé pourtant de milliards de galaxies contenant chacune des milliards de soleils accompagnés de leurs époustouflants ballets de planètes, de comètes et d’astéroïdes : ils ont été vivants. Oui, vivants !
Pesons bien le sens de cette singularité à couper le souffle : vivants… Comment ne pas vouloir la raconter et de toutes les manières possibles, moi un écrivain algérien, moi un homo sapiens ?
C’est ça, à mon avis, le but du roman (et de l’art) en fin de compte : parler du duel permanent entre la mort désespérante et la vie invraisemblable, raconter l’éternelle victoire de la mort et la magnifique défaite de la vie, nous faire supporter avec plus ou moins d’élégance cette infirmité essentielle qui veut que le top départ de notre anéantissement soit donné dès la première seconde de notre venue au monde.
Comment supporter en plus que cette vie déjà si brève subisse en outre l’humiliation de l’asservissement infligée par d’autres homo sapiens ?
Raconter ce destin, c’est ce que je me propose depuis toujours de faire dans mes livres, avec plus ou moins de succès. C’est ce que je m’échine à tenter de nouveau avec L’amour au temps des scélérats.
___________________________

Par Mustapha BENFODIL, le 26-09-2021
Dans mon esprit, la littérature, la création, est d’abord mouvement. Ce n’est pas quelque chose de figé. Ce que la vie m’a appris, j’essaie d’en distiller quelques pépites, quelques enseignements, sans faire de morale ni imposer une lecture univoque. J’avoue que cela me donne de l’énergie et du courage quand mes forces m’abandonnent, quand je perds la foi dans le verbe “écrire” et que je n’éprouve plus le désir de continuer à gribouiller.
Pourquoi j’écris ? C’est le genre de questions qui nous ramènent aux fondamentaux de notre “métier” et qu’on perd de vue, à vrai dire, à mesure qu’on s’enfonce dans les méandres de l’écriture. Si on se plaît à déconstruire l’acte d’écrire, on réalise d’emblée que c’est un acte complexe, un processus mystérieux qui répond le plus souvent à des raisons obscures. Ce n’est pas quelque chose d’aisément intelligible qu’on peut restituer de façon complète et exhaustive. On ne peut pas isoler un seul facteur et dire : c’est ça l’élément déclencheur. C’est ça qui me pousse à écrire. Il y a tout un faisceau d’incitations. Et il y a autant de livres que de raisons de les avoir écrits. Dans mon esprit, la littérature, la création, est d’abord mouvement. Ce n’est pas quelque chose de figé.
Aussi, je dirais que chaque livre, chaque projet, a sa vérité, ses mobiles, ses motivations. Les raisons qui nous ont poussés à écrire ce livre en particulier, sur ce sujet en particulier, sous cette forme particulière, ici et maintenant. Si je dois remonter à mes débuts en littérature, je dirai que l’une des pulsions qui m’animaient, c’était le goût de la fiction, de l’invention, de l’affabulation. J’ai toujours été quelqu’un de fantasque mais de façon discrète. Cela explique pourquoi je me suis davantage investi dans les arts narratifs que dans les genres spéculatifs comme l’essai. Le fait est que j’adorais raconter et “me” raconter des histoires. Je me souviens aussi que dans ma prime jeunesse j’étais quelqu’un de timide, beaucoup plus timide qu’aujourd’hui. Et l’écriture s’est d’emblée imposée à moi comme un confident, un refuge, un exutoire. J’ai perdu mon père à l’âge de 7 ans, et mes grands-parents paternels entre 6 et 8 ans. Je pense que ce contact brutal avec la mort a largement façonné mon tempérament, faisant de moi quelqu’un de solitaire et d’introverti, et donc fatalement porté sur l’introspection, un exercice spirituel dont l’outil, le “médium”, est l’écriture. Cela m’a amené aussi à me poser les grandes questions, et c’est dans l’écriture, par l’écriture, que j’ai essayé de les formuler, sans bien sûr être en mesure de leur apporter une réponse satisfaisante. Et ce n’était pas du tout de l’autothérapie, loin de là. Au mieux, cela représentait une forme de libération. Mais ça, c’est un peu les grandes lignes, les fantasmes de base. Après, quand j’ai fait mon petit bonhomme de chemin dans le monde de la littérature, j’ai appris une chose importante : beaucoup de ce que nous écrivons ne nous appartient pas en toute propriété, et quand l’écriture devient “professionnelle”, quand votre manuscrit confidentiel se transforme en livre, c’est-à-dire un objet économique et social, il y a quantité de paramètres qui orientent votre cheminement. J’aime à répéter sur le ton de la boutade qu’écrire est un verbe “intransitif”, pour répondre notamment sur la notion très vague de “message”. Pour autant, écrire n’est pas quelque chose de purement immanent, vaporeux, hors-sol. Anhistorique. Il se fixe quelque part. Il a un ancrage social. S’inscrit dans une temporalité. Quand bien même il n’est pas conçu comme un acte de communication, Écrire est malgré tout conditionné par un “quoi” et un “comment”. Il est incarné par un livre en particulier.
Alors, bien sûr, je pourrais vous dire : “J’écris pour le plaisir de l’écriture, de la langue” ; “J’écris par besoin existentiel, par nécessité” ; “L’écriture pour moi constitue une urgence vitale, une urgence sociale”. Je pourrais ajouter : “J’écris pour apprivoiser la mort” ; “J’écris pour conjurer mes démons”, “J’écris à défaut d’agir sur le monde”, “J’écris pour témoigner”, “J’écris pour documenter le réel et le sublimer”, “J’écris pour laisser une trace, pour ne pas mourir bêtement”, “J’écris pour donner un sens à ma souffrance”, “J’écris pour inventer d’autres possibles”, “J’écris pour réenchanter le monde”, “J’écris pour donner une maison à mes rêves d’enfant”, etc., etc., etc. Je suis tenté de vous dire : Cross the Right Answer. Cocher la bonne réponse. Mais, au fond, toutes ces réponses se valent, font sens pour moi, et cependant aucune n’a l’exclusivité, même si, dans la pratique, certaines pulsions l’emportent sur d’autres. Juste un mot pour terminer : depuis que je suis papa, mes filles Leïla et Nina ont bouleversé mon rapport à l’écriture. Aujourd’hui, j’écris en pensant d’abord à mes filles. Ainsi, je suis de plus en plus mu par un désir de transmission.
Ce que la vie m’a appris, j’essaie d’en distiller quelques pépites, quelques enseignements, sans faire de morale ni imposer une lecture univoque. J’avoue que cela me donne de l’énergie et du courage quand mes forces m’abandonnent, quand je perds la foi dans le verbe “écrire” et que je n’éprouve plus le désir de continuer à gribouiller.
_________________________

Par Sabéha BENMANSOUR, le 26-09-2021
À quoi sert la littérature ? Question pour le moins surprenante ! Car à peine a-t-on fini de la poser que les réponses affluent, remettant en cause par leur pluralité comme par leur diversité la nécessité comme la légitimité même de la question ainsi formulée. Aussi, sommes-nous tentés de réfléchir en écho non plus à la question, mais aux réponses, nombreuses, qu’elle suscite en les validant à travers le descriptif de situations bien précises, l’objectif étant de transposer le débat sur le terrain des modes de réception pluriels du texte littéraire et de tous les bienfaits que l’on peut en dégager. Si tant est que nous ayions pour cela à situer la littérature dans ce qui fait par essence son originalité propre, ce serait seulement pour dire sur cette base ce qui la particularise en tant que mode de communication, et pour souligner la spécificité des effets qu’elle aurait sur ses lecteurs comme la variété possible des expériences de lecture qu’elle suscite.
Dans cet esprit, Umberto Eco définit la lecture du littéraire comme une “coopération interprétative” du texte, propos que nous choisissons pour donner le ton que nous souhaitons donner à une approche qui privilégie la perspective interactive du lecteur à son texte, interaction liée à la nature même de la littérature. La littérature, nous a-t-on toujours appris, n’est pas le reflet du réel, elle n’en est que sa représentation. Un réel qui la détermine, certes, sans que pour autant la charge référentielle en relation à un espace-temps donné ne prédomine par rapport à la visée symbolique qui est le propre de toute œuvre littéraire. Dans presque tous les cas, interpelé par l’environnement auquel il appartient, l’écrivain le “dessine” à travers une histoire, une fiction qui attire, qui joue sur les résonances affectives du lecteur tout en gardant, pour utiliser un terme proposé par Mohammed Dib, une “crypte” secrète qui appelle à l’interprétation. Il en résulte une sorte de négociation du sens qui a toute chance de créer chez le lecteur une part de créativité qui, loin de s’en éloigner, enrichira au contraire en le réactualisant, l’espace de la représentation, au double profit de celui qui écrit et voit son œuvre continuer à “voyager” et de celui qui lit et qui voit dans l’œuvre en question l’espace de sa propre vision du monde. Seule la littérature, parce qu’elle est un lieu où la langue est constamment recomposée, nous offre le privilège de nous mettre à l’écoute de ce qui fait sens chez le lecteur, de goûter à un plaisir de partage et en partage !… À cet effet, l’expérience réalisée au niveau de l’Association La Grande-Maison, que j’ai le plaisir de présider, pourrait en être l’illustration. Née il y a plus de vingt ans, cette association a eu, dès sa création, une double ambition : celle d’élargir sous différentes formes le lectorat autour d’une œuvre immense, mais méconnue d’un public large en Algérie. Et la seconde, celle d’inciter ce lectorat à voir cette même œuvre comme une symbolique à partir de laquelle, il prendrait “la clé des champs” – pour paraphraser Dib – et penserait ses propres créations, en conjonction avec son vécu. Une lecture en diagonale proposée dans un premier temps à de jeunes lecteurs d’une œuvre, dont la plupart d’entre eux ignoraient jusqu’à l’existence, fut notre première belle expérience. La notion de “coup de cœur” en faveur d’un extrait de texte plutôt qu’un autre a remplacé l’étude purement académique et a installé d’emblée une relation dialogique avec des textes dont l’attrait était de toute évidence en lien avec l’attente du lecteur. C’est ainsi que d’une découverte à l’autre, l’œuvre s’est ouverte à eux, mais les a invités aussi à l’habiter de leur propre réflexion. Dans ce cas précis, à quoi aurait servi la littérature ? Sans doute, dans une première étape à saisir, au-delà du référent spatial ou temporel, la portée profonde d’une parole dans ses récurrences et sa capacité à se renouveler en lien avec le contexte de production, portée qui assure à cette même œuvre son homogénéité comme sa possible pérennité. Mais ajoutons aussi qu’en leur “parlant”, le texte dibien a été pour eux la référence vers laquelle ils reviennent constamment pour penser leurs propres créations, pour les dire dans le langage qui est le leur : écriture, théâtre, peinture, photo,…et dans un espace de réflexion toujours neuf qui, tout en s’appropriant l’œuvre littéraire, s’inscrit dans une actualité qui est la leur et apporte sa pierre à l’édifice de l’art dans toutes ses formes d’expression. L’intérêt de la littérature pour tous ces jeunes lecteurs ? D’abord, l’ouverture à la réflexion, au dialogue avec l’Autre qu’ils découvrent semblable et différent, le dire par des mots toujours neufs de ce que la littérature leur fait sentir et de ce qu’elle les incite à exprimer…
Dib aurait dit dans le même esprit : “Au commencement est le paysage (…) cadre où l’être vient à la vie, puis à la conscience (…) Les yeux grands ouverts, elle continuera. Secret travail d’identification et d’assimilation où conscience et paysage se renvoient leur image, où (…) le dehors s’introvertit en dedans pour devenir objet de l’imaginaire, substrat de la référence.”
(Tlemcen ou les lieux de l’écriture)
____________

Par Amin Zaoui, le 26-09-2021
De la bonne littérature, je parle. Mentir en vrai. L’âge des lumières a été porté, engendré, par les écrivains : les romanciers, les poètes et les philosophes ! Ils sont les lumières et les faiseurs des lumières ! Lucioles et bougies ! Dans toutes les civilisations, la modernité a été toujours annoncée, d’abord, par les poètes.
La littérature, la bonne littérature, est le sens, l’essence même, de toute aventure humaine. Elle est l’âme de la raison. La raison de la folie.
La littérature demeure ce partage humain éternel, inépuisable et généreux. Par le temps, la littérature change sa forme, change ses supports, mais jamais son âme.
La littérature fascine l’être humain, le lecteur, au-delà des temps, au-delà des générations, au-delà des religions, au-delà des couleurs. La littérature n’a pas de sexe. Elle est reine dans une langue maternelle, mais reine aussi dans les autres langues à travers la traduction.
Les langues, toutes les langues, sans les belles lettres ne sont que cimetière, silence ou cri sans sens. La bonne littérature n’a pas de pays, n’a pas de nationalité. Elle est en voyage permanent. Elle a les pieds dans des sandales en vent. Elle n’est pas prisonnière de géographies. Pas de frontières. Comme l’âme, la littérature n’a pas de couleur. Mais elle est multicolore.
Les écrivains, les poètes et les romanciers accumulent expérience sur expérience, texte sur texte, bibliothèque après bibliothèque, sans perdre espoir de changer, un jour, le monde autour d’eux, en eux. La littérature est une persévérance. Une religion, contre la religion !
Il m’arrive, de temps à autre, de me demander : pourquoi j’écris ? J’écris parce que j’ai confiance en la force magique de la littérature. La littéraire est capable de soulever la terre à l’aide d’une poignée de mots simples mais vertigineux. La littérature est capable de déposer la terre, toute la terre, sur la pointe du stylo !
Dans la bouche d’un poète, dans la narration d’un romancier, le mot est une force magique.
La littérature est une illusion non illusoire, convaincante et provocante. Une illusion faite d’une réalité, dans la réalité, qui dépasse le réel matériel.
Depuis la nuit des temps, la langue est le mythe le plus légendaire que l’homme a créé. Et la littérature est forte, éternelle, parce qu’elle creuse dans ce mythe qu’est la langue. Elle est gardienne de ce mythe. Sans la littérature, les langues meurent, disparaissent.
Toute société confondue, moderne soit-elle ou traditionnelle, a besoin de la littérature pour combattre la sècheresse humaine qui menace la vie.
Pourquoi la société a-t-elle besoin de la littérature ? L’homme est nourri de fantasmes, et la littérature est un trésor en la matière.
La belle littérature est capable de mentir vrai. Capable de transformer les mensonges en une autre réalité plus belle que la réalité et plus véritable que la vérité.
Les littérateurs, les poètes, les conteurs et les romanciers sont les pairs des prophètes. Dans tout écrivain, authentique, s’installe un prophète. L’écrivain est un prophète sans révélation divine ! Sa révélation la découvre dans l’Histoire, dans les mythes, dans la langue et dans l’imaginaire individuel et collectif.
L’écrivain se tient debout entre fou et prophète. Entre feu et eau. Entre braises et glaçons. Il est nourri de la folie et de la prophétie. Rappelons-le : tous les prophètes, à travers les temps, ont été accusés d’être des poètes ou des fous. La littérature est l’accusée et l’accusatrice.
Pourquoi j’écris ? J’écris pour moi-même, ce moi qui traverse les autres, miroir des autres ! Le narcissisme de l’écrivain n’est pas maladif mais humain et enfantin.
Dans chaque coup de plume, l’écrivain réveille un lecteur, parle à un lecteur. Après chaque livre, chaque roman, l’écrivain reprend le chemin vers un autre horizon. On recommence : Sisyphe. L’écriture est une aventure ouverte à toutes les surprises.
Le lecteur est un complice. Une troisième main pour le même piano, pour la même mélodie. Un deuxième imaginaire. Il y a le lecteur qui nous accompagne au moment de l’écriture, un autre qui nous attend à la librairie et un autre qui nous boude.
Mais la littérature est aussi une économie florissante. Un travail. Un investissement particulier. Une offre et une demande régentées par une autre éthique sociétale. Une industrie compétitive. Des écrivains à travers le monde se sont transformés en une sorte de bourse nationale et internationale. Ainsi, et en retour, le marché culturel influence l’art de l’écriture, bouleverse les traditions stylistiques, bouscule l’âme.
La littérature n’est qu’un festin de mensonges vrais !
_______________

Par Benaouda LEBDAI, le 26-09-2021
Les littératures africaines postcoloniales se veulent universelles, car ce sont des littératures d’engagement et de dénonciation d’une géographie politique au détriment des peuples. Rebelles, il serait injuste de les réduire à un rôle social et politique car elles enrichissent les langues de l’Autre, le français ou l’anglais, qui deviennent les leurs.
Dans ce contexte d’une mondialisation effrénée, quels sont le sens réel et la portée symbolique des littératures africaines ? Quel en est le défi dans le concert culturel de la mondialisation ? En ce début de XXIe siècle, l’idéologie et le mode de vie dominants reposent sur une américanisation de la planète qui nivelle les cultures par la présence des McDonalds, des jeans, des productions hollywoodiennes et d’une certaine littérature. Quel rôle peuvent jouer les littératures postcoloniales pour contrecarrer une telle influence ? Une question qui mérite d’être posée.
Les littératures africaines sont de plus en plus visibles car elles ont évolué en plus d’un demi-siècle, tant au plan du fond que de la forme. Leurs sources sont à chercher dans la riche histoire culturelle africaine qui fut méprisée par les colonialistes nourris par une idéologie dominatrice. Durant la période spoliée, les Africains sauvegardèrent leurs cultures en puisant dans les racines culturelles ancestrales que les écrivains réintroduisirent dans les textes littéraires. Les énergies littéraires déployées pour rendre compte des tragédies ont propulsé le rôle réparateur de l’écriture.
La dynamique générée par les écrivains a montré que les Africains avaient des “choses à dire” au monde, en mettant en avant la vie intellectuelle, culturelle, sociale et politique de l’Afrique entière, du nord au sud. Les récits des cultures orales des “meddahs”, des griots, des romanciers montrèrent que les peuples ne furent pas que des victimes consentantes car les textes fictionnels décrivirent les luttes vaillantes des chefs autochtones comme Chaka le Zulu ou l’Émir Abdelkader.
Les écrivains dénoncèrent les empires mondialisés et relevèrent de multiples défis en remettant au centre le colonisé marginalisé qui est devenu ‘sujet’. Les souffrances endurées laissèrent des traces transcrites dans les littératures postcoloniales qui décrivirent les divers traumatismes, à l’instar des romans de Sembène Ousmane, de Kateb Yacine, d’Ayi Kwei Armah, de Mohammed Dib ou de Mouloud Feraoun.
Avec les “soleils des indépendances”, les Africains furent nombreux à rêver de jours meilleurs. L’indépendance, synonyme de liberté d’être soi-même et d’être en contrôle de sa vie, de son corps, de son éducation fut accueillie avec enthousiasme, mais les écrivains africains comprirent vite que les pouvoirs “révolutionnaires” ne s’occupaient que des classes bourgeoises et de leurs clans. Le terme “révolution” qui faisait rêver fut vidé de son sens étymologique et la génération postcoloniale a décrit le désenchantement.
Les écrivains “en colère” relevèrent le défi et mirent l’accent sur les conflits d’intérêt et la corruption. Ainsi, les littératures postcoloniales intégrèrent la “mondialisation” en en dénonçant cela au monde, prouvant qu’ils étaient à la fois dans le local et dans le global. Le subalterne postcolonial devint “sujet”. Les littératures africaines abordèrent des problématiques politiques et identitaires, relevant le défi d’être au cœur des débats internationaux, en symbiose avec les débats des instances de l’ONU. Les romans au vitriol comme ceux de Ngugi Wa Thiong’O et de Rachid Mimouni accélérèrent l’évolution des littératures de la postcolonialité, déballant au grand jour les gabegies et les libertés confisquées. La force de cette écriture innovante et provocatrice a reposé sur l’utilisation métaphorique de la scatologique, de la pourriture et de la saleté. Les récits décrivirent des sentiments de dégoût, soulignant l’absurdité de la vie au quotidien. Les écrivains africains relevèrent le défi de dénoncer le “désordre des choses”.
Les littératures postcoloniales mettent en scène l’exil et l’émigration, une conséquence des gestions malheureuses des États postcoloniaux comme l’ont fait avec brio Boualem Sansal ou Tierno Monenembo. La mondialisation est définie comme étant lié aux structures internationales, à l’économie mondiale libérale et à la pratique généralisée de langues dites internationales comme l’anglais ou le français. La rapidité des échanges de l’information via Internet est une des caractéristiques majeures du XXIe siècle. Les littératures postcoloniales s’installent dans une mondialisation caractérisée par ce que Pascale Casanova appelle “La République mondiale des lettres” et qu’Edward Saïd analyse comme étant le “système mondial de la littérature-… un système complet ayant son ordre propre de la littérarité, son tempo, son canon, son internationalisme et ses valeurs marchandes”. Précisément, les littératures postcoloniales défient les systèmes, en plaçant au centre ce qui est la périphérie du système euro-centriste. En effet, ces littératures abordent des thèmes comme l’hybridité, la double culture, l’émigration et la situation des subalternes.
La multiplicité culturelle intégrée est significative pour les romanciers de la diaspora, comme Chimamanda Ngozi Adichie, Abdou Rahman Waberi, Azouz Begag, Alain Mabanckou, Akli Tadjer ou Malika Mokeddem qui rentrent dans la catégorie des “afropolites”, de ceux qui appartiennent au moins à deux mondes, celui du nord et celui du sud, en affirmant pleinement leur universalité.
De nouvelles identités se construisent. Elles sont décrites par des écrivains qui revendiquent leur appartenance à la fois à leur pays d’accueil et à leur pays d’origine.
Les écrivains de la diaspora et les écrivains d’Afrique s’expriment dans les langues françaises ou anglaises et se vivent comme des passeurs d’idées, de sensibilités différentes, jouant le rapprochement entre les peuples, contribuant à une autre forme de mondialisation. Ils relèvent un grand défi, celui d’effacer ou d’estomper les frontières réelles qui se durcissent et se ferment pour les gens du Sud, d’où l’augmentation des harraga, ces brûleurs de frontières comme l’écrit Boualem Sansal.
Le travail de transmission concerne le passage et la circulation des idées qui font que les frontières psychologique se désagrègent. Au-delà de la littérarité, les littératures postcoloniales jouent le rôle d’accélérateur de démocratie et d’ouverture dans le cadre de la mondialisation comme le commente Amin Maalouf : “Nous sommes tous contraints de vivre dans un univers qui ne ressemble guère à notre terroir d’origine ; nous devons tous apprendre d’autres langues, d’autres langages, d’autres codes… Aussi le statut de migrant n’est-il plus seulement celui d’une catégorie de personnes arrachées à leur milieu nourricier, il a acquis valeur d’exemple.” La nouvelle catégorie d’écrivains relève le défi de s’intégrer et d’influencer une nouvelle mondialisation positive et respectueuse. Les expressions africaines postcoloniales ont surpris les critiques par leur force de persuasion y compris par le nombre de femmes écrivaines qui dénoncent les cloisonnements, les injustices envers les femmes, les sociétés machistes. Les femmes postcoloniales défient l’ordre établi par leurs écritures corrosives comme le font avec brio Fatou Diome, Arma Darko, Maïssa Bey ou Lynda Chouiten.
Les romancières postcoloniales abordent des questions fondamentales comme celles de l’enfermement, de la polygamie, de la maltraitance des femmes, de la supériorité supposée de l’homme africain, du rôle des religions sur les sociétés, de l’influence néfaste des fondamentalismes Elles savent que de longs combats restent à mener. Les écrivaines racontent des histoires faites de personnages qui leur tiennent à cœur, en défiant les sociétés traditionnelles qui ont du mal à s’intégrer à une mondialisation de progrès et de modernité.
Les littératures africaines postcoloniales se veulent universelles, car ce sont des littératures d’engagement et de dénonciation d’une géographie politique au détriment des peuples. Rebelles, il serait injuste de les réduire à un rôle social et politique car elles enrichissent les langues de l’Autre, le français ou l’anglais, qui deviennent les leurs. Ces langues sont travaillées, malmenées, les mythes africains, les proverbes, les termes locaux, les interjections locales et les dictons populaires y sont introduits et deviennent connues à travers le monde. Les métaphores et les images s’inspirent de l’oralité, et c’est en cela que les littératures postcoloniales enrichissent la culture universelle. Elles mettent au grand jour ce qui fut longtemps tu.
Les littératures postcoloniales transforment le monde et lui donnent un nouveau souffle, un nouveau mode d’écriture qui s’inscrit dans une mondialisation où l’échange et l’interpénétration deviennent les nouvelles valeurs à défendre. Elles abordent les vrais problèmes existentiels des gens, ce qui fait leur universalité.
Dans le monde global, les écrivains postcoloniaux se font entendre et s’imposent, car ils relèvent des défis communs comme celui de prôner l’intégration et de lutter contre le racisme. Ils écrivent avec conviction et ironie sur leurs relations avec les divers pouvoirs du globe, et créent un contre-pouvoir par l’écriture.
Le discours littéraire et idéologique est ouvert et les systèmes de références proposés sont pluriels. Les écrivains postcoloniaux adhèrent au retour de l’Afrique au-devant de la scène, une Afrique ouverte au monde comme le revendique Achille Mbembe. Les écrivains de toute l’Afrique s’expriment afin que le monde s’humanise.
____________________

Par Yahia ARKAT, le 27-09-2021
Des universitaires maghrébins, français et libanais ont axé leurs interventions sur l’altérité, le féminisme, l’autobiographie ou encore la mort dans l’œuvre monumentale de l’Académicienne, lors d’un colloque international organisé dernièrement en ligne.
Un colloque international sous le titre générique “L’écriture de soi dans l’œuvre d’Assia Djebar : libération ou engagement ?” a été organisé dernièrement sur une plateforme virtuelle par des universitaires maghrébins, français et libanais qui ont tenté par des pistes de réflexion de décortiquer l’œuvre flamboyante et monumentale de l’Académicienne native de Cherchell.
Les travaux du colloque initié par le laboratoire La Rslam de la Faculté des lettres et des sciences humaines d’Agadir ont été introduits par une communication de la professeure tunisienne, Najiba Regaïeg, de la faculté des sciences humaines de l’université de Sousse.
Le speech de Mme Regaïeg “Assia Djebar : une écriture à l’épreuve de la mort” met en exergue la densité d’une œuvre inscrite résolument dans la modernité. L’intervenante part du postulat que l’esthétique djebarienne se décline dans une “écriture en lambeaux”.
La spécialiste de Djebar évoque l’écriture de la mort comme stimulateur de la vie des autres et une écriture de la vie comme “transe narguant la terre algérienne assoiffée du sang de ses enfants”.
Analysant “La femme sans sépulture”, la conférencière découvre une auteure devenue “celle qui ne reconnaît pas la mort”, se muant en énigme, en écrivaine disparue mystérieusement comme Berkane dans “La disparition de la langue française”.
“Se diluant dans la terre Algérie, se réclamant de toutes les langues, vivant en oiseau migrateur se posant presque dans chaque ville, dans chaque coin du monde, Assia Djebar, précisons ici qu’il s’agit de l’écrivaine, invente une autre littérature ou un autre art”, commente Najiba Regaïeg, évoquant un art qui transcende la souffrance, l’exil, l’enfermement, le silence et la mort.
D’autres conférenciers ont disséqué, c’est le cas de le dire, plusieurs aspects de l’œuvre djebarienne.
Les professeurs Samia Mouffouk de l’université de Batna et Fouzia Amrouche de l’université de M’sila se sont intéressées à l’altérité entre écriture féministe et écriture féminine dans Vaste est la prison d’Assia Djebar.
C’est cette œuvre qui a été abordée sous l’angle de “la pluralité du moi et son échophonie” par la professeure Nadia Birouk de l’université d’Agadir.
Sa consœur Aïcha Bourais s’est intéressée, elle, à la quête identitaire au féminin dans l’œuvre de Djebar. “L’autobiographie chez Assia Djebar : entre fierté et malaise”, a été le thème abordé par Nadjiba Selka de l’université d’Oran 2, alors que Hind Mokrane de l’université de Batna s’est attardée sur “La femme sans sépulture”.
L’universitaire tunisienne Safia Jaâfar, chercheuse à l’université de Saint-Étienne, a structuré son intervention autour de “l’intermédialité littéraire et la représentation du corps” dans deux romans emblématiques de Djebar : Vaste est la prison et L’Amour, la fantasia.
Ce dernier a fait également l’objet d’une critique de Dounia Boutirna, doctorante au département d’anglais de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou.
Née en 1936 à Cherchell, Assia Djebar, auteure d’une œuvre prolifique et au parcours littéraire dense, est décédée en février 2015, 10 ans après avoir rejoint le panthéon de l’Académie française.
_____________

