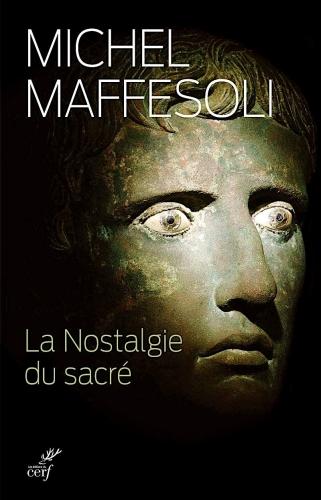
______________________________________
Michel Maffesoli : un catholique non chrétien
Raphaël Juan : Dans votre dernier livre paru, La nostalgie du sacré, vous poursuivez une réflexion, entamée avec La parole du silence, qui revient aux sources du mot religion (du latin religare, relier) et dévoile le ciment social que créée la conscience d’une sacralité commune. Ce sacré d’où provient-il et comment le définiriez-vous ?

De nombreux auteurs, je pense en particulier à Émile Durkheim dans Les formes élémentaires de la vie religieuse ou encore Gilbert Durand dans Sciences de l’homme et tradition, montrent bien comment de diverses manières, mais avec une grande constance, la religion est un élément de fond de la vie sociale. Durkheim allant même jusqu’à parler pour bien souligner ce phénomène de « divin social ». Suivant les époques, celui-ci est plus ou moins mis en valeur. Ainsi, durant toute la modernité, du 17e à la première moitié du 20e siècle, le rouleau com-presseur du rationalisme évacua progressivement cette dimension religieuse, aboutissant à ce que Max Weber a bien analysé en parlant de « désenchantement du monde ». Il semblerait, et c’est en tout cas mon analyse, que contemporainement, en cette postmodernité nais-sante, le sacré, voire même le sacral revienne à l’honneur. Quelle en est la source ? quelle en est l’origine ? il est difficile de donner une définition exacte de ce que l’on nomme le sacré. Mais l’on peut constater, dans la foulée des auteurs que je viens de citer qu’il s’agit d’une structure anthropologique, rendant attentif au fait qu’on ne peut bien saisir le visible qu’en fonction de l’invisible. Ou encore, et cela a été souligné par de nombreux bons esprits, on ne peut comprendre le réel qu’à partir de ce qui est réputé irréel. C’est ce retour d’un imaginaire religieux que j’essaie, dans cet ouvrage comme dans La Parole du silence, d’analyser.
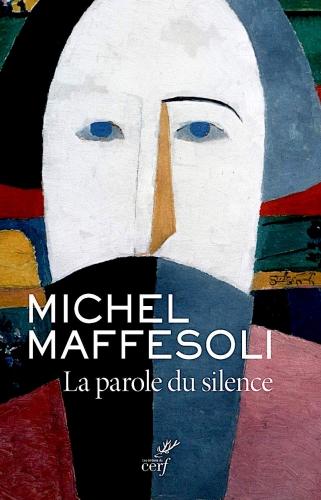
Raphaël Juan: Votre livre insiste sur la nécessité du mystère qu’implique toute sociabilité empreinte du sacré, c’est-à-dire pour vous toute socialité authentique. Vous évoquez des figures étranges comme ce "roi clandestin" dont parle le sociologue Georg Simmel. Qu’est-ce que ce roi clandestin ? A-t-il quelque chose à voir avec le roi du monde dont parle René Guénon ?
Soyons attentifs au fait que, dans la foulée de la philosophie des Lumières, se développant au 18e siècle et se poursuivant tout au long du 19e siècle, le mystère a été durablement relativisé, voire dénié. Pour ma part, je rappelle, dans la suite de cette dialogie existant entre le visible et l’invisible, que le clair-obscur est une des caractéristiques essentielles de toute espèce humaine. C’est en ce sens qu’il convient de comprendre le terme même de mystère qui tout à la fois insiste sur l’importance de l’ombre et le fait que ce phénomène de l’ombre partagée constitue la socialité de base.
C’est en ce sens que ce penseur important que fut Georg Simmel a, à plusieurs reprises, parlé du « roi clandestin ». Je ne sais pas si cette expression peut être comparée à ce que René Guénon nomme « le roi du monde ». L’idée même du roi clandestin rend attentif au fait que, à côté d’un pouvoir surplombant, pouvoir institué, pouvoir établi, il existe une société officieuse, pour ce qui me concerne ce que l’on appelle la souveraineté populaire, qui tout en étant cachée n’en est pas moins réelle et régulièrement tend à s’affirmer et à être reconnue comme telle. Ces diverses métaphores soulignent l’importance qu’il convient de donner ou de redonner au mystère comme étant un élément structurant de tout être ensemble. Faut-il le rappeler, il existe une proximité sémantique entre des mots tels que mystère, mythe, muet, mythique etc. Mots qui rendent attentif au fait, qu’au-delà d’une attitude quelque peu paranoïaque consistant à tout expliquer, il y a aussi, au sein même de la connaissance sociétale, des éléments secrets qui permettent de comprendre, au sens fort du terme, ce qu’est cette socialité de base, celle de la vie quotidienne qui ne peut pas être expliquée seulement à partir de la raison raisonnante. Pour ma part j’ai d’ailleurs consacré un livre, Éloge de la raison sensible, au fait qu’il faut compléter la raison, celle des Lumières, par le sensible qui renvoie à l’ombre constituant, également, la vie individuelle et la vie collective.
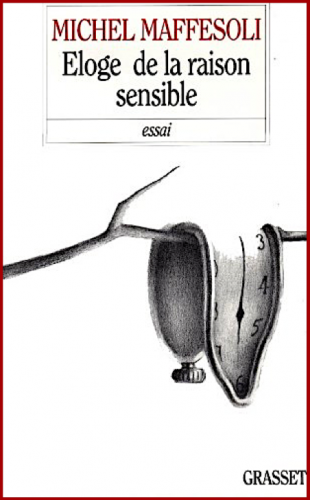
RJ : La fermentation, l’œuvre au noir, l’obscurité, le secret, le silence vous semblent être des dispositions essentielles pour faire germer, à titre individuel ou collectif, le divin. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette « stratégie des ténèbres » ?
MM : Il est en effet important d’observer que « l’œuvre au noir » ou ce qui est secret, est constitutif tant d’un point de vue individuel que d’un point de vue collectif de toute existence humaine. On peut, à cet égard, parler d’une « stratégie des ténèbres ».
Pour bien me faire comprendre je rappelle que le terme latin qu’utilisait la philosophie médiévale, la discretio renvoie à la nécessité d’être discret et c’est cette discrétion qui aboutit à ce qui est peut être la caractéristique essentielle de notre espèce animale, le discernement. Donc plutôt que de mettre l’accent purement sur la dimension explicative de la raison raisonnante, le silence est aussi une manière de comprendre et ce dans le sens strict du terme, le fondement de toute vie sociale, ce que j’appelle pour ma part socialité. Expliquer, c’est déplier le réel, relier chaque phénomène à une cause, comprendre, c’est saisir l’ensemble des phénomènes dans leur interaction, ce qu’on nomme un écosystème. Expliquer relève de la pure recherche des causes rationnelles, comprendre prend en compte les rêves, les émotions, tout ce que le pur rationalisme avait laissé de côté.
Ainsi, alors que la sociabilité est la conséquence d’un social purement rationnel, la socialité quant à elle prend en compte l’entièreté du mystère sociétal.
RJ : Ce livre est, entre autres choses, une apologie du génie du catholicisme qui aurait su comprendre l’humaine nature mieux que les autres religions, et notamment que le protestantisme. Communion des saints, culte de la vierge, piété populaire, intégration de l’héritage gréco-romain, Trinité, « tolérance » du pêché sont des idées et pratiques qui retiennent votre attention, pourquoi ?
MM : Il me semble en effet qu’à l’opposé de ce que fut la dimension très rationnelle du protestantisme à partir du 16esiècle, le génie du catholicisme a su garder ce que le philosophe Jacques Maritain nommait « un humanisme intégral ». Humanisme s’exprimant bien, dans le catholicisme traditionnel par le culte des saints, la dévotion mariale, la piété populaire sous ses diverses manifestations et bien évidemment par l’accentuation très forte donnée au mystère de la Trinité. Dans chacun de ces cas, ce qui est en jeu, c’est, au-delà d’une foi simplement individualiste, le fait que l’essence même de la religion est toujours un relationisme, c’est-à-dire une manière de mettre en relation, de relier. De ce point de vue, je consacre quelques pages à ce mystère dans mon livre, l’idée trinitaire qui est une particularité du christianisme traditionnel que le catholicisme met en valeur, explique bien ce primum relationis ou pour le dire à la manière du philosophe catholique Max Scheller un ordo amoris qui est le propre de tout échange et de tout partage. Il ne faut pas avoir peur de mettre en relation cet ordo amoris trinitaire avec le dogme de la communion des saints qui met l’accent sur ce qu’il convient d’appeler la réversibilité comme étant un élément important de tout être-ensemble. C’est cette réversibilité que l’on peut retrouver dans le partage, l’échange, l’entraide que la culture numérique aidant, on voit revenir avec force dans toute société. Ce qu’on appelle actuellement la société collaborative en est un bon exemple.
RJ : Vous semblez convaincu qu’il y a un retour des jeunes générations vers le catholicisme. Or, en France (la situation est sans doute différente en Italie voire en Espagne), le déclin des pratiques et notamment de la fréquentation de la messe est quantifiable et constante depuis le milieu des années 1960. Quels signes et indices retenez-vous qui vous invitent à parier sur un retour en force du catholicisme chez les jeunes ?
MM : Cette nostalgie du sacré est particulièrement repérable dans les aspirations et les pratiques des jeunes générations. Certes, on ne peut nier qu’il y a une sécularisation croissante dans de nombreux pays. Disons tout net que cette sécularisation est la conséquence du rationalisme des Lumières du 18e siècle et du mythe du progrès qui s’élabora tout au long du 19e siècle. Mais à côté de cette sécularisation il est non moins intéressant d’observer que depuis quelques décennies il y a un retour à des dimensions spirituelles de plus en plus affichées et dont on peut repérer les indices multiples. Par exemple le développement des communautés charismatiques, l’importante renaissance des pélerinages, la reviviscence des communautés monastiques, le tout particulièrement repérable grâce aux divers réseaux sociaux qui fleurissent sur Internet. Il y a dans ces réseaux sociaux des groupes de recherche et d’échange sur la philosophie thomiste, sur la méditation et sur diverses voies d’accès à la contemplation. Voilà quels sont les indices (index, signifie ce qui pointe) du retour en force du catholicisme dans les jeunes générations, qui par après contamine toutes les autres couches de la société.
RJ : Vous insistez sur la tradition qui constitue la source à laquelle s’abreuve l’imaginaire des peuples pour vivre et créer. Quelle est la tradition que vous défendez, est-ce l’immémoriale sophia perennis, celle du christianisme des origines, les traditions populaires des villages, le passé mythique ? Comment peut-on favoriser la transmission de cette tradition aujourd’hui ?
MM : Ainsi que je l’ai souvent indiqué, et tout au début de ma carrière j’y ai consacré tout un livre, le progrès fut le grand mythe du 19e siècle, qui ne l’oublions pas, est l’apogée de la modernité (La violence totalitaire, 1979). Le propre de ce progressisme consistait, en tirant toutes les conséquences de la philosophie de l’Histoire avec Hegel, à se déraciner du passé tout comme de l’espace d’ailleurs, afin d’atteindre le paradis à venir : la société parfaite. Certains bons esprits, je pense en particulier à Karl Löwith n’oubliaient pas de souligner que ce progressisme était la forme sécularisée du messianisme judéo-chrétien. Le paradis n’étant plus à réaliser au ciel, mais devant se concrétiser sur terre, ultérieurement.
C’est ce mythe du progrès qui, en quelque sorte, invalidait la tradition, c’est-à-dire ce qui se rattachait au passé, à la lente sédimentation des cultures humaines. Il me semble, ce que l’on peut résumer avec l’expression de Léon Bloy, « le prophète est celui qui se souvient de l’avenir », qu’au-delà ou en deçà de la recherche futuriste d’un bonheur à venir, il y a de diverses manières un retour de la tradition. C’est cette tradition que le magistère de l’Eglise catholique a jusqu’ici su conserver. Ce qui est particulièrement repérable en effet dans les pratiques populaires enracinées dans les terroirs, celles du culte des saints en particulier ou des multiples pélerinages locaux. Cette tradition est en effet l’expression d’une sagesse populaire, « sophia perennis » qui d’une manière plus ou moins discrète reprend force et vigueur dans les divers festivals ou rassemblements historiques traditionnels, rappelant ce qu’est la force du rythme de la vie, à savoir (rythme : rheein, couler) qu’il ne peut y avoir écoulement qu’à partir d’une source.
Pour reprendre l’oxymore que j’utilise fréquemment, depuis de longues années, la tradition ne peut qu’exprimer l’enracinement dynamique, c’est-à-dire la reconnaissance que comme toute plante, la plante humaine a besoin de racines pour croître et se développer.
RJ : On sait que les relations entre les organisations de la Franc-maçonnerie et l’Eglise catholique sont complexes et même souvent conflictuelles, pour diverses raisons. Vous vous référez souvent à Joseph de Maistre qui était à la fois un catholique intransigeant et un franc-maçon de haut-grade. En quoi la figure de Joseph de Maistre – grand défenseur, lui aussi, de la tradition – vous semble être en prise avec notre temps et pensez-vous qu’une réconciliation entre la franc-maçonnerie et le catholicisme soit possible à court terme ? Cette réconciliation vous semble en tout cas souhaitable, si je vous comprends bien…
MM : Il est certain que les relations entre la Franc-maçonnerie et l’Eglise catholique ne furent pas toujours des relations d’apaisement. Cela dit, dans la diversité des obédiences franc-maçonnes, certaines que l’on qualifie de « régulières » gardent le souci du spirituel, voire de l’ésotérisme comme étant des caractéristiques essentielles de leur manière d’être ensemble.
Joseph de Maistre qui est pour moi toujours une source d’inspiration, a écrit de très beaux textes sur la franc-maçonnerie traditionnelle tout en étant un farouche défenseur de la catholicité. En ce sens ses écrits peuvent aider un rapprochement qui n’est plus une utopie lointaine entre la franc-maçonnerie et l’église catholique. Je rappelle à cet égard un très bel écrit de mon maître Gilbert Durand, Un comte sous l’acacia (réédité in Gilbert Durand, Pour sortir du 20e siècle, CNRS éditions 2010) qui rappelle en des pages inspirées comment la pensée de Joseph de Maistre s’inscrit dans une tradition mystique qui est un élément important de l’église catholique.
RJ : Vous vous dites mécréant mais l’on voit bien à travers vos livres récents que vous vous détachez progressivement de l’orgiasme païen développé dans L’ombre de Dionysos, par exemple, pour vous rapprocher du grand silence des monastères catholiques. Est-ce que, personnellement, vous attendez ou espérez la Grâce ?
MM : Il m’arrive de dire, inspiré en cela d’Auguste Conte et peut-être de Charles Maurras que je suis catholique et non chrétien. Je rappelle que grâce au culte des saints et à la vénération mariale, l’église catholique a maintenu une certaine forme de polythéisme. Dans mon livre L’Ombre de Dionysos, je montre que certains cultes des saints, par exemple Saint Pothin à Lyon, avaient pour origine la vénération d'une divinité ithyphallique que l’église catholique avait su, avec subtilité baptiser, si je peux m’exprimer ainsi. Je pense également que la mystique développée dans les monastères catholiques est tout à fait en phase avec l’esprit du temps postmoderne. Je n’ai pas à exposer ce que j’attends personnellement d’un tel mouvement, d’une telle évolution, mais je rappelle que grâce, ou à cause du mystère de l’incarnation qui est une très belle métaphore, le catholicisme a pu développer ce que j’ai souvent nommé la transcendance immanente. Cette immanentisation de l’invisible dans le visible se retrouve dans la pensée de St Thomas d’Aquin lorsqu’il rappelle qu’il n’y a rien dans l’intellect qui n’ait d’abord été dans les sens (nihil est in intellectu quod non sit prius in sensu).
Dans le livre que je suis en train d’écrire et qui fera suite à La Nostalgie du sacré, m’inspirant du très beau livre du cardinal John Newman : Grammaire de l’assentiment, je montre que c’est la référence au magistère catholique, au culte des saints qui peut nous aider à comprendre l’assentiment propre à la sagesse populaire qui consiste à dire « oui à la vie », « oui tout de même à la vie ».
