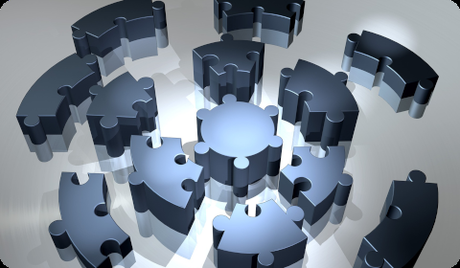La mise en ligne récente de la table ronde virtuelle du Sibos 2020 consacrée à la monétisation de l'« open banking » et la synthèse qu'en propose Finextra me donnent l'occasion de m'arrêter sur ce sujet primordial, qui préoccupe tant de responsables du secteur… et qui, hélas, est généralement abordé sous un angle inapproprié.
La mise en ligne récente de la table ronde virtuelle du Sibos 2020 consacrée à la monétisation de l'« open banking » et la synthèse qu'en propose Finextra me donnent l'occasion de m'arrêter sur ce sujet primordial, qui préoccupe tant de responsables du secteur… et qui, hélas, est généralement abordé sous un angle inapproprié.Le point de départ de la réflexion est un défaut bien connu dans les grandes organisations : avant de lancer un projet, surtout de grande ampleur, il faut d'abord démontrer son retour sur investissement (ROI). En l'occurrence, ce préalable induit une tension extrême entre une injonction émanant des « experts » et du « marché », la sourde perception (au moins par une partie des décideurs) de l'importance de suivre la tendance et la difficulté à matérialiser des cas d'usage concrets générateurs de revenus.
Interrogés sur les bénéfices qu'ils espèrent retirer de l'« open banking », les participants à une enquête informelle placent ainsi en tête, pour près de la moitié d'entre eux, la création de nouvelles solutions à valeur ajoutée (le reste se répartissant principalement entre 29% concernés en priorité par la conformité réglementaire et 19% souhaitant améliorer de la sorte leurs collaborations avec la FinTech… probablement dans un objectif de développement et d'enrichissement de leurs catalogues, là encore).
Les intervenants invités sur la scène du Sibos – qui exercent au sein de grands groupes, NatWest, BNY Mellon et BNP Paribas, et de fournisseurs technologiques, Finastra et Fidel – expriment des points de vue similaires, oscillant entre le désir de déployer de nouvelles offres et la possibilité de distribuer leurs services à travers des canaux extra-financiers, en passant par l'optimisation des processus internes. Les éditeurs logiciels vont jusqu'à considérer les API – fondations de l'ouverture – comme des produits à part entière.
Cependant, ces tentatives de justification passent entièrement à côté de l'essentiel. Certes, le partage de données, brutes ou raffinées, l'accès à l'émission de virement, la fiabilisation de la vérification d'identité (exemples cités)… profitent de la simplification apportée par le recours à des interfaces de programmation reposant sur des standards. Mais ces API ne sont qu'un outil passif – et l'« open banking » une philosophie – facilitant la mise en œuvre de ces applications, sans en être un quelconque moteur.
En conséquence, espérer quantifier la rentabilité d'une telle démarche sera toujours un exercice vain. Le concept, dans son ensemble, devrait plutôt être envisagé comme un canal supplémentaire d'interactions, notamment avec les clients, et sa rentabilité se mesurerait alors à l'aune de la qualité de l'expérience utilisateur qu'il autorise. Le principe n'est pas si éloigné de celui qui a régi l'émergence de la banque mobile et les leçons apprises dans ce domaine depuis une douzaine d'années restent d'actualité.
Il est vrai qu'il faut cette fois composer avec un surcroît de complexité, introduisant de multiples défis inédits. D'un côté, la notion d'ouverture, qui s'accompagne de la transition vers la logique de plate-forme et/ou de services enfouis, impose d'accepter une éventuelle ré-intermédiation de la relation avec le client. D'autre part, les APIs, qui en sont le support de l'implémentation, requièrent une attention à plusieurs dimensions d'expérience, vis-à-vis des développeurs, des entreprises partenaires, des usagers finaux…
Quoi qu'il en soit, rien dans le modèle de l'« open banking » ne peut-être assimilé à un produit en soi, susceptible d'être commercialisé et de dégager directement un profit. En revanche, il constitue une étape majeure dans la redéfinition des méthodes de consommation des services financiers. À ce titre, les dirigeants d'institutions devraient s'inquiéter de rester en phase avec l'évolution du monde « digital » au lieu de s'enfoncer dans l'obsolescence en continuant à s'interroger sur l'équilibre économique des APIs.