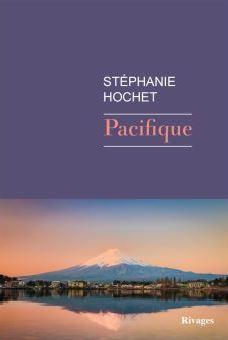
Avec son dernier roman Pacifique (Rivages, 141 pages, 16 €), Stéphanie Hochet continue de creuser son sillon et de s’affirmer comme l’une des meilleures auteures de sa génération. La diversité des thèmes qu’elle choisit de traiter depuis plusieurs années prouve qu’elle ne se fige pas dans un univers exclusif. Avec Un Roman anglais, elle conduisait son public dans le crépuscule de l’Angleterre édouardienne, L’Animal et son biographe nous transportait dans le Lot, sur les traces des rêves génétiques fous d’un duce de province. Dans Pacifique – titre habilement polysémique – elle aborde un Japon pré-Hiroshima qui vit encore au rythme respiratoire d’un empereur-dieu et cultive, sur des terres de plus en plus asséchées, la tradition mythique du samouraï.
L’histoire que nous conte Stéphanie Hochet est celle du jeune Isao Kaneda, fils de la petite bourgeoisie nippone. Elevé par sa grand-mère dans le culte des ancêtres samouraïs, mais aussi curieux de la pensée philosophique occidentale, Kaneda s’engage dans l’armée de son pays en guerre et devient pilote de chasse. Mais au printemps de 1945, l’heure n’est plus aux combats où l’on se couvre de gloire en remportant des duels aériens ; l’honneur dicte de devenir l’un de ces Kikusui, ces « chrysanthèmes flottants » (quel nom poétique pour désigner un kamikaze !) dont la mission sera de précipiter son appareil rempli d’explosifs sur les navires ennemis.
Tout au long de ce récit en trois parties, l’auteure fait parler son personnage principal. Celui-ci passe en revue son enfance protégée, sa formation militaire, jusqu’au jour de ce qu’il pense être son dernier décollage, mais où rien ne se passera comme prévu.
Ce roman, haletant, retient l’attention du lecteur de bout en bout. Servi par un style impeccable, rigoureux, un style intemporel – en d’autres termes personnel et qui ne cède pas aux modes, là réside sa supériorité – il immerge avec pertinence chacune et chacun dans la société ultra-ritualisée du Japon. Dans cette culture très ancienne, collective (au sens des dimensions culturelles développées par le psychologue néerlandais Geert Hofstede), on ne pense pas « je », mais « nous ». On ne redoute pas la culpabilité, hantise réservée au judéo-christianisme, mais la honte vis-à-vis des membres de la communauté en cas d’échec ou d’infraction aux règles. Malheur à celui qui « perd la face » car il connaîtra alors une mort sociale ! Tout le dilemme d’Isao Kaneda tient dans cette pression du groupe sur l’individu, élevée au rang de dogme; l’auteure, en y accordant toute l’importance qu’il mérite, donne de l’épaisseur à son héros et de la substance à son récit. Car, si le jeune pilote associe, en sujet loyal du Mikado, devoir envers l’empire et sacrifice de sa vie conforme à la tradition du suicide, la philosophie grecque, dont il s’est nourri, en lui ouvrant l’esprit, lui suggère une autre logique : « Il n’y a rien d’honorable à mourir pour une cause perdue. »
Au-delà d’une peinture réussie de la société japonaise, Stéphanie Hochet nous apporte d’intéressants éléments de réflexion sur le personnage du kamikaze dont le djihadisme nous fournit un ersatz contemporain. De la comparaison entre les belles certitudes de Kosugi, camarade et compagnon de chambre de Kaneda qui, perméable à l’endoctrinement officiel, ne se pose aucune question, et le doute du jeune Isao, nous tirons un enseignement : la conviction relève de la tranquillité d’esprit (presque de la physiologie) tandis que le doute, qui, certes, rend l’esprit intranquille, relève de l’intelligence.

