Il fut un temps lointain où des femmes cumulaient les fonctions d’assistantes sociales, pompiers, médecins, infirmières, aides-soignantes à domicile, femmes de ménage, blanchisseuses, cuisinières, éducatrices, voire mères de substitution, et tout ça gratuitement. C’étaient les bonnes soeurs.
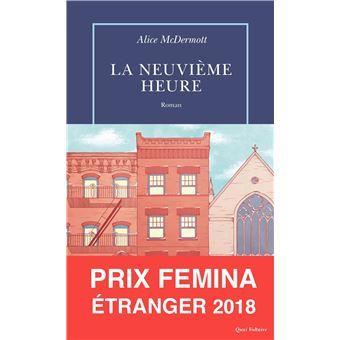
Il y avait les Petites Soeurs des Pauvres, les Petites Soeurs de l’Assomption, les Soeurs soignantes des Pauvres Malades de la Congrégation de l’Enfant-Jésus, les Soeurs des Pauvres de Saint-François, les Soeurs dominicaines des Pauvres Malades de l’Immaculée Conception, les Pauvres Clarisses, la Petite Compagnie de Marie. Il y avait les Soeurs de la Divine Compassion, de la Divine Providence, du Sacré-Coeur. Il y avait les Petites Soeurs des Pauvres Malades de la Congrégation de Marie devant la Croix, Stabat Mater, leur ordre.
Au début du XXe siècle, il y en avait des dizaines et des dizaines de milliers, appartenant à des milliers de congrégations, oeuvrant sur les cinq continents. Elles avaient renoncé à un époux terrestre pour épouser le Christ et se mettre au service de leur prochain, selon le commandement d’amour de leur divin époux. C’était aussi pour elles une façon de gagner une certaine forme d’autonomie et de compétence socialement reconnue, dans un monde encore très patriarcal. Certaines quittaient leur pays natal sans espoir de retour, pour gagner les contrées les plus lointaines.
J’en ai croisé beaucoup de ces bonnes soeurs jamais inactives, à la pointe du progrès social de leur temps sous leur cornette et leur scapulaire, quand je faisais ma thèse d’histoire sur les femmes catholiques au Mexique dans l’Entre-deux-guerres. La série Call the midwife a braqué le projecteur sur elles, en mettant en scène une communauté de religieuses sages-femmes opérant dans les quartiers pauvres du Londres des années cinquante. Il manquait un roman sur ces héroïnes mal connues ; Alice McDermott l’a fait. Elle a même inventé sa propre congrégation religieuse pour l’occasion : les « Petites Soeurs des Pauvres Malades de Marie devant La Croix » !
La neuvième heure, c’est celle du milieu de l’après-midi, quand les religieuses présentes au couvent arrêtent leurs activités pour prier ensemble à la chapelle. Après une journée à quêter dans le grand magasin Woolworth, soeur Saint-Sauveur a largement dépassé la neuvième heure, mais elle n’aspire qu’à rentrer dans son couvent de Brooklyn pour soulager sa vessie et reposer ses vieilles jambes gonflées. C’était sans compter l’incendie d’un immeuble sur son chemin du retour. Elle se sent appelée à secourir Annie, jeune Irlandaise pauvre et enceinte de son premier enfant, dont le mari vient de se suicider au gaz (d’où la cause du sinistre). Dès lors Annie est employée à la blanchisserie du couvent tandis que sa fille Sally grandit entourée des robes bruissantes des religieuses, dans les vapeurs de la buanderie du sous-sol, bercée par les histoires de rédemption racontées par la jeune et enthousiaste soeur Jeanne.
Soeur Saint-Sauveur avait pour vocation d’entrer chez des gens qu’elle ne connaissait pas, surtout des malades et des personnes âgées, de pénétrer dans leur foyer et de circuler comme si elle était chez elle, d’ouvrir l’armoire à linge, leur vaisselier ou les tiroirs de leur commode…
Plus tard, Sally se croit une vocation religieuse. La sévère soeur Lucy se charge de l’éprouver. Issue d’une famille aisée, soeur Lucy est entrée dans cette congrégation soignante par devoir, pour aider les souffrants en qui elle voit le Christ en Croix. Sensible aux violences faites aux femmes, elle les prévient contre les grossesses rapprochées et les maris brutaux. À sa suite, Sally pénètre au coeur de la misère humaine, qu’elle découvre sous ses aspects les plus repoussants – comme cette femme unijambiste, geignarde et en pleine période menstruelle (youpi tralalala) qu’elle doit laver et coiffer. Sally serre les dents et tient bon. Elle est prête à embrasser cette misère-là pour racheter le péché de son père. Mais elle n’est pas au bout de son voyage au bout de la nuit…
Comme l’indique sa quatrième de couverture, ce roman emprunte au gothique irlandais. Des fantômes y croisent une fondatrice de congrégation catholique dépossédée de son oeuvre (Jeanne Jugan, pour ne pas la nommer) ; une famille nombreuse et bohème côtoie un ancien de la Guerre de Sécession ; les rues populeuses du Brooklyn du début XXe pullulent de chiens errants, d’immigrés descendus du bateau, d’enfants négligés, de mères poussant de lourds landaus, et de bonnes soeurs empressées.
Pendant des années, nous crûmes que les Petites Soeurs soignantes des Pauvres Malades de la Congrégation de Marie devant La Croix apparaissaient dans tous les foyers chaque fois qu’une crise ou qu’une maladie en perturbait la routine, chaque fois qu’un substitut était nécessaire pour Celle Qui Ne Pouvait Pas Être Remplacée.
J’ai été profondément touchée par l’atmosphère de ce roman, tissée de détails très texturés – à l’image d’un rayon de soleil sur du mobilier verni, d’images saisissantes (comme ces deux vieilles poupées sur la cheminée d’une morte) et d’une certaine forme de mélancolie, car c’est raconté comme une mémoire familiale. Mais ce qui m’a le plus touchée, ce sont ces religieuses dont la foi impétueuse, parfois doloriste, naïve ou hygiéniste, déplaçait les montagnes. Certaines vont jusqu’à braver les interdits, affronter un monstre ou risquer leur paradis pour sauver la mise à leurs amis.
« Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Ces religieuses-là l’illustrent bien, à leur manière. Il était peut-être risqué d’en faire les personnages d’un roman ; on aurait pu craindre l’écueil hagiographique, le portrait à charge (façon Magdalene Sisters) ou simplement l’ennui mortel, avouons-le. Mais Alice McDermott a pleinement relevé le défi en livrant un récit nuancé et humain, où aucun personnage n’est de trop.
Premier livre lu en 2020 (oui, je ne suis pas en avance dans mes chroniques), et je peux le dire, premier coup de coeur de l’année !
Et je ne l’ai pas fait exprès, mais la thématique tombe pile avec le premier jour du Carême aujourd’hui 😉
Charlotte a trouvé ce roman « absolument magnifique », pour Dominique c’est un roman « très vivant, plein d’humour, de chaleur et de réalisme », Virginie a été touchée.
« La neuvième heure » d’Alice McDermott, Traduit de l’anglais (États-Unis) par Cécile Arnaud, Quai Voltaire, 2018, 288 p.
éèé
