
Neac nous a hélas quitté cette année, qu’il repose en paix ! Nous l’avions interviewé dans un des premiers numéros du magazine mais pour lui rendre hommage ici nous avons choisi de publier une interview réalisée par notre ami Cédric Naïmi pour son livre État des lieux.
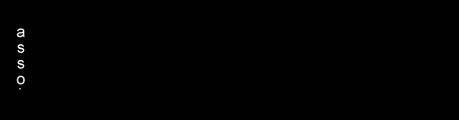
Comment as-tu commencé le graffiti ?
J’ai démarré quand j’étais au collège à environ quinze ans, en 1987-1988. J’étais sur Colombes et Nanterre. J’avais regardé Spraycan Art, etc. on s’inspire de cette époque et après, j’ai commencé à taguer dans la rue. En 1988, j’ai monté un petit groupe de copains, les DKA, qui étaient issus de Colombes, de Nanterre, et du 92.
As-tu rencontré des gens par hasard ? Sur des friches ?
Non, j’ai côtoyé soit des gens du quartier, soit à l’école. Au départ, on s’est lancé, on signait notre nom et on a monté notre groupe. En quelques mois, on est passé d’une dizaine, à une vingtaine, à une cinquantaine, jusqu’à une centaine. À l’intérieur, il y avait des artistes avec des gens qui chantaient, rappaient, dansaient, et d’autres faisaient des sports de combat. À la fin, on s’est rassemblé pour constituer un groupe assez costaud pour l’époque. On faisait des graffs partout, des rendez-vous que ça soit au MacDonald de Colombes, à Nation, à Châtelet, à Charles de Gaulle – Étoile,la Défense etc. C’est une époque qu’on n’oublie jamais. Après, on a commencé à aller sur les terrains du terrain Vert a Nanterre,la petite école a Nanterre et Paris, à rencontrer d’autres groupes. C’est avant tout une passion.
Qu’est-ce que vous faisiez ? Des friches ? Des chantiers ?
Au départ, c’était à la sauvage : on attaquait les RER, les métros, les rues…
Vous êtes-vous fait chopper ?
Moi non, j’ai eu de la chance et je courais vite ! Mais pour certains, oui. Maintenant, on se revoit, on a tous la quarantaine, et on en reparle. Je raconte aussi mes histoires à mes enfants, mais je crois que cette période des années quatre-vingt-dix, c’était pour moi les meilleurs moments. En tout cas, je n’oublierai jamais et je ne regrette rien. Sur Nanterre, il y avait aussi la municipalité qui a mis en place un endroit qui s’appelait La petite école.. À l’époque, il y avait le magasine Intox et nous, la banlieue, on était peu représenté par rapport aux tagueurs et aux graffeurs de Paris. Oliver Megaton, qui avait été interviewé, avait alors dit qu’il se passait aussi beaucoup de choses en banlieue. Je m’en rappelle et j’ai encore ces Intox chez moi, j’ai tous les numéros.
C’est collector !
C’est collector. Après, il y a eu une pression de la banlieue et du coup, on a été dans tous les Intox ! Olivier Megaton avait aussi une de ces têtes rouges dans les premiers qui étaient sortis.

Comment ça se passe ensuite ? Vous êtes-vous séparés ? Avez-vous continué ?
On est toujours resté uni et encore aujourd’hui. On a tous la quarantaine et on est toujours là. « On », c’est Rel, Shuck 2, Bears, Fint, Junky, Roner, Manyak, Ecraze ,Gemo, Skofe, Boste, Bonus, Astro ? une grande partie des DKA. Avant, les groupes de Nanterre étaient les DKA, DKC, et les TCP. Dans les trois, on se connaissait tous. J’étais le leader des DKA, Shuck 2 les TCP, et Keal les DKC.

Comment devient-on leader ? Quel est la différence avec les autres ?
C’est moi qui ai monté le groupe avec Jef Tba . Je dis « groupe » mais pour moi, c’est une famille. Vingt ans après, on est encore là. On se fait des barbecues, des graffs ensemble avec nos enfants, etc. Aujourd’hui, avant tout, ça reste donc une famille. Bien sûr, dans les années quatre-vingt-dix, j’ai traîné beaucoup à la Défense avec Shuck 2 et les BD, les Black Dragon, qui étaient des groupes de cette époque. J’allais à l’entraînement avec eux au parc de Nanterre, car j’aimais bien aussi faire un sport de combat, mais ça n’empêche pas que derrière, j’ai réussi à faire mes projets. C’est un autre choix, chacun son parcours. Après, la ville de Nanterre nous a beaucoup aidé, on peut les remercier. On a eu un animateur qui s’appelait Ahmed Kartoubi, il était payé par la ville pour faire des projets. Au départ, on faisait des graffs, on coloriait tout Nanterre, car la mairie nous donnait un coup de main pour avoir des murs facilement. Après, en 1992, Ahmed Kartoubi est parti pour travailler à l’Institut du Monde Arabe à Paris, et c’est là que j’ai monté l’association avec laquelle nous avons continué les projets sur la ville de Suresnes. Par exemple, pour la gare de Belvédère de Tramway, on a été appelé par l’association Parélie qui créée des projets avec des jeunes et derrière, on encadrait. Tu es obligé de passer par-là, sinon, tu ne fais pas grand-chose. Aujourd’hui, en France, c’est un système qui n’est pas simple quand tu es artiste ou quand tu veux le devenir. Moi, je garde le graffiti en tant que passion, je vais aussi à des expos mais j’ai mon boulot à côté. Après, on a fait beaucoup de choses sur la ville de Nanterre en bénévolat.
Qu’avez-vous fait d’emblématique ?
Sur Nanterre, on a réalisé un débat sur le graffiti et sa place dans la ville, on a fait venir le maire de l’époque. La salle était pleine, il y avait Patrick Jarry. Quand tu as quinze ou vingt ans, tu as beaucoup d’aide, maintenant, on en a quarante et le graffiti sur Nanterre est devenu compliqué.
Pourquoi est-ce devenu compliqué ?
Aujourd’hui, on nous appelle souvent pour faire des toiles de trois mètres sur deux, ou pour faire des expositions, et c’est aussi compliqué. Sur Nanterre, il y a des gens qui viennent de Paris et d’ailleurs, ils ne connaissent pas vraiment l’entité de cette ville, ni le graffiti alors que Shuck2 et d’autres, nous y sommes depuis les années quatre-vingts, on sait beaucoup de choses. On aurait même voulu faire des façades des bâtiments, et aujourd’hui, certains dont Shuck2 se battent pour faire un Graffpark qui devrait arriver sur Nanterre. Je vais souvent à celui de Mantes-la-Jolie, dans la zone industrielle. Des endroits sont faits pour, et on se bat aujourd’hui à Nanterre pour avoir un mur de trente mètres de long sur deux mètres de haut, mais on pourrait aussi faire autre chose. Du coup, j’ai été appelé par la ville de Suresnes où nous peignons chaque année pendant les vacances scolaires. Dernièrement, on a fait un autre mur sur la ligne de tramway de la Défense, Belvédère, Saint-Cloud.

Par qui était-ce commandité ?
Par l’association Parélie, ça fait plus de dix ans qu’on bosse avec eux. On a fait aussi un atelier toile avec des retraités et des jeunes. C’était marrant, on était une vingtaine. Les plus anciens faisaient de l’aquarelle ou autres, ils faisaient tous du dessin et ils sont trouvés ça génial, ils ont beaucoup aimé. C’est une chose que nous allons renouveler, on a tous mangé ensemble à la fin et les gens étaient contents, joyeux. Ce n’est pas uniquement du graff, mais ce sont aussi des rencontres. Les gens s’y intéressent et dans la rue, on ne prend plus ça pour du vandalisme comme il y a une dizaine d’années. Les gens regardent, s’arrêtent, et discutent avec nous. Le graff est perçu autrement.
Est-ce que son image, notamment avec le tag, n’a pas pénalisé le graffiti au niveau de son intégration, de son adaptation par rapport aux « dirigeants », aux gens responsables ?
Si, sûrement mais les personnes qui font du pochoir dans la rue, est-ce qu’on leur dit quelque chose ? Non. Dans les villes, il peut y avoir de nombreux terrains comme celui de Mantes-la-Jolie ou de Nanterre. En 1991, j’ai perdu mon père, et je peignais sur le mur à Stalingrad. Tout le monde venait, le samedi, le dimanche. Au-delà du graff, du crew, c’est une amitié. Les gens qui ne l’ont pas vécu, et qui connaissent rien, vont encore se dire que ce sont des voyous même si c’est de moins en moins le cas. Heureusement, les choses ont évolué. Quand tu veux faire un graff sur un grand mur à Nanterre, il faut les autorisations, ça prend du temps, on t’endort un peu. J’ai même arrêté d’aller dans les débats, et je leur dis aux élus : « sortez de votre bureau, venez voir ce qui se passe sur le terrain et après, on pourra faire des choses ensemble ». J’avance donc de mon côté.
C’est frustrant. Comment rebondis-tu autrement ?
J’ai carrément monté ma société. C’est un regroupement d’artistes, toujours les mêmes depuis 1987-1988, et nous allons lancer dans la grande distribution des produits : des valises, des toiles, des vêtements, tout un concept street-art. Le premier magasin sera au 4 Temps a la Défense, à partir du mois de juin.
Est-ce que ça va s’ouvrir à d’autres artistes ?
Je ne sais pas, ce n’est pas un milieu simple. Aujourd’hui, ça existe sur du textile alors que nous allons plus loin dans la démarche avec des objets du quotidien. Avec différentes thématiques, on peut faire beaucoup de choses. Après, il faut prendre le risque mais je suis quelqu’un qui avance et se qui me projette.
Quels sont les risques de ton engagement ?
Les risques financiers, car c’est un investissement .Tu lances par exemple mille valises, mille poussettes de marché, et il faut stocker dans un entrepôt qui est déjà prévu. Je vais recevoir cent-soixante-dix mille sacs pour faire les courses, il y a une logistique derrière et il faut être organisé. Tu ne peux pas lancer un concept, travailler avec la grande distribution si tu n’es pas carré. Tu peux vite te retrouver dehors.

Oui, il n’y aura pas de souci. On est parti sur des valises, des sacs, des tee-shirts, des toiles, des thermos à café, des plateaux…
Qui valide le projet ?
C’est moi. La fabrication se fait en Chine, et c’est très compliqué. C’est beaucoup d’échanges par mail, et on doit se déplacer. Je pars en mai pour justement valider certaines choses, nous parlons anglais. On arrive donc à se débrouiller, et il faut compter quatre mois pour faire un produit.
Avec la grande distribution, il faut que les délais soient respectés.
Bien sûr, l’idée est de beaucoup anticiper. Il faut que je commence maintenant si je veux faire quelque chose pour Noël. Il vaut mieux prendre de l’avance, car il faut compter un mois quand le conteneur part de Chine. Il y aussi le cahier des charges à respecter, nous sommes par exemple obligés de mettre sur les sacs « respect de l’environnement » pour pouvoir le distribuer. Il y a des normes des matières recyclées, on ne peut pas faire tout et n’importe quoi.
Quels sont tes autres projets ?
De sortir un livre de huit-cents pages sur toute la ville de Nanterre, de 1984 jusqu’à maintenant. C’est un long projet, et l’idée est de regrouper des interviews d’artistes anciens et récents qui ont participé à tout ce qui a pu être fait dans la ville de Nanterre. À chaque fois des nouveaux arrivent dans le groupe. Il y aura aussi beaucoup de photos, des mises en ambiance. Mes deux garçons peignent sur des terrains où c’est légal, chose que nous n’avions pas à l’époque.
Quels sont les chantiers les plus phénoménaux que tu as pu faire ?
Pour moi, c’est sur la ville de Nanterre. Aujourd’hui, à chaque fête de quartier, on intervient. On a fait pas mal de choses comme à la fête de la musique. Mon plus grand chantier, c’est la ligne de tramway sur la ville de Suresnes. On avait fait aussi une grande toile tout le long de l’Arche de la Défense où, en dessous, il y avait aussi le projet avec la RATP. On a fait un mur à Nanterre de 240m² rue de la Paix, il est toujours là avec Shuck 2, Rel. Aujourd’hui, niveau graff, c’est juste entre nous. J’ai un entrepôt de soixante mètres de long pour dix mètres de haut où je peux peindre directement sur place, mon bureau est à côté. J’ai le terrain à domicile ! Mais même à l’époque, chez moi à la maison, je m’étais construit un mur de quinze mètres sur deux !
Carrément ! Que penses-tu de l’amplitude du graffiti ?
Je ne le regarde plus trop comme je le regardais dans les années quatre-vingt-dix. Même les métros, je ne sais pas quel jeune cartonne le plus en ce moment. Je regarde un peu sur internet, mais sans plus. On reste entre nous : DKA, 90DBC, TCP, sont des groupes du coin. On graff ensemble, et on ne va pas plus loin. J’ai une vie de famille, et je n’ai pas le temps non plus d’aller à l’étranger. Aujourd’hui, je le garde donc en tant que passion. L’idée est de mettre en avant les artistes français, c’est surtout la marque de fabrique de mettre en avant des produits faits par eux. On va vraiment faire une opération street-art comme on ne l’a jamais vue dans la grande distribution. C’est un pari, j’y crois et il faut aller jusqu’au bout.
Pour le bouquin, je sais qu’il y avait beaucoup de choses sur Nanterre, nous avons une histoire et dans les interviews, il y a des anecdotes. Chacun a quelque chose à dire. La place sera donc pour les artistes, beaucoup de gens participeront à ce livre .Je veux faire une bible de huit-cents pages, avec des photos lisibles. Il n’y a vraiment aucune concurrence, c’est pour dire ce qu’il y a eu avec le groupe dans les années quatre-vingts et aujourd’hui. Ça reste une famille, simple, et comme on a perdu pas mal de personne, c’est aussi un hommage à eux. On a la quarantaine mais on est toujours là. Parfois, oui, tu baisses les bras face aux villes et quand ceux de Nanterre voulaient m’aider quand ils ont su que je voulais faire un livre, je leur ai répondu que non, je le ferai tout seul, sans l’aide de la ville, car je n’ai pas envie d’être récupéré. Dans le débat, je dis ce que je pense, et ils peuvent faire ce qu’ils veulent mais ils n’y connaissent pas grand-chose. À Nanterre, des milliers d’euros sont pour la culture, mais je ne sais pas dans quoi ils les mettent. J’ai arrêté, car à chaque fois qu’ils nous appellent, c’est pour faire une planche trois mètres sur deux. Quand tu as quinze ans, ça va mais à quarante ans, tu as envie d’un vrai projet. J’ai aussi un atelier de 100m² à Nanterre où on peut exposer nos toiles. Il y a une dizaine d’années, pendant deux ans, on a aussi peint à la Maison d’arrêt de Nanterre.
Comment fait-on pour rentrer là-bas ? Comment ça se passe ?
Ils m’ont appelé avec l’association, et j’ai eu un rendez-vous avec le SPIP. Ils m’ont demandé de faire des cours avec les détenus et de réaliser une fresque de cent mètres de long dans les couloirs. Sur Nanterre, on a donc peint la Maison d’Arrêt. Au départ, j’étais tout seul avec sept ou huit détenus. Il y avait aussi ceux qui surveillaient, les « matons » comme ils les appelaient. Là-bas, ils font aussi des concerts, ils ont une salle de sport que nous avions peint : des joueurs de foot, des gens qui faisaient de la musculation. Puis, on nous a carrément demandés de faire des toiles pour pouvoir les mettre dans les couloirs des détenus. Enfin, avec les majeurs, on a fait les murs. On a fait alors pareil pour une Maison d’Arrêt du 95, et celle de Poissy. Donc, trois au total. Celle qui m’a impressionné est celle de Poissy. Quand tu rentres pour la première fois, mon cœur est monté, une sensation… Franchement, ça te met un coup. Après, pour rentrer, il faut que j’ôte mes bombes de peinture, ma ceinture, et à chaque fois, c’était tout le temps le même procédé. D’ailleurs, j’ai rencontré des amis qui habitaient à Nanterre. À l’intérieur, quand je discutais avec eux, je ne faisais pas la différence. On parlait de tout et de rien mais ils me respectaient beaucoup : les jeunes, les majeurs. Le contact s’est vraiment très bien passé même s’ils se sont pris la tête avec les « matons ». Pendant deux ans, tous les mercredis, j’y allais.
Quelle est la sensation que tu as eu ? De faire une fresque et de ressentir que tu peux partir et pas eux ?
Exactement. Et parfois, je revoyais certains jeunes entre les différentes Maisons d’Arrêt.
Que penses-tu de ceux qui ont fait de la prison pour du graffiti ?
Il y a dix-quinze ans, Junky, il a fait un mois de prison, car il a peint sur un train quand on était ensemble à Bois-Colombes. Aujourd’hui, quand tu vois la répression qui est faite même sur le code pénal, c’est quand même démesuré quand tu fais un graffiti. Un mec qui vend de la drogue va être moins sanctionné qu’un mec qui fait du graffiti. Aujourd’hui, quand tu te fais attraper, c’est comme si tu avais tué quelqu’un. J’ai beaucoup de souvenirs de cette époque, et l’essentiel est qu’on s’en rappelle vingt ans après.
As-tu déjà eu des coups de flip ? De te dire que tu es allé trop loin ?
Oui, dans le métro, sur les toits. On est parti aussi peindre en Angleterre, à Londres, pour un festival grandiose équivalent un peu à la fête de la musique. On est parti une dizaine de Nanterre, avec deux animateurs, c’était un échange organisé par la ville.
Interview : Cédric Naïmi
Photographies : DR

