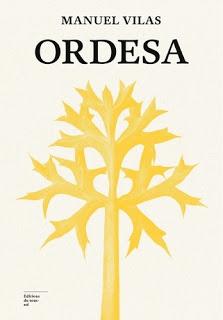 Autoportrait ? Cela y ressemble bien. Ordesa, de Manuel Vilas, traduit par Isabelle Gugnon, est la longue
complainte d’un écrivain qui ne parvient pas à faire le deuil de ses parents.
Cela ne semble pas enthousiasmant. Et pourtant, dans les méandres des remords,
l’illumination des souvenirs, la perte de moments, l’oubli de visages, la
disparition d’articulations importantes d’autrefois, la vie et la mort se
renvoient sans cesse la balle. Le mouvement est parfois infime, parfois il
prend une amplitude plus grande – toujours il exerce sur le lecteur une
fascination qui ne cesse de croître jusqu’aux dernières pages, un épilogue en
forme de poèmes qui reviennent, afin que nul n’oublie, sur quelques idées
fortes parmi celles qui animent Ordesa.
Ordesa est une vallée pyrénéenne à côté de laquelle se
dresse le mont Perdu, nom symbolique qui ne se pose pas là par hasard puisque
tout le livre est une tentative de résistance à l’effacement de faits que le
temps érode. Et aussi à ce qu’a fait le père : « Plus que mourir, mon
père s’est perdu, il a pris la tangente. Il est devenu un mont Perdu. »
Au point de départ, et pour expliquer la difficulté à
affronter sereinement cette disparition ainsi que celle de la mère, il y a
peut-être cette faute originelle – du moins considérée comme telle –, d’avoir
choisi la crémation plutôt que l’enfouissement : « la crémation est
irréparable, elle interdit toute possibilité d’exhumation du corps. »
La peur a accompagné le narrateur au fil des années :
peur des colères du père, quand il se mettait à tout casser sans jamais
cependant s’en prendre directement aux membres de sa famille, peur de
l’appartement, de la ville, peur de tout, mais il faut l’envisager comme un
sentiment salutaire : « Mon Dieu, comme j’aime les désespérés. Ce
sont les meilleurs. »
Il y a eu la culpabilité, aussi, devant les gestes ambigus
d’un prêtre que la mémoire n’a pas retenus, ce qui est pire que s’ils étaient
restés avec précision, car la présence du Mal, quand celui-ci est flou,
interdit aux victimes de se racheter, les rend « excrémentielles », méprisables.
« On aime les héros, pas les victimes. »
Et le narrateur n’a certes rien d’un héros. Seule peut-être
son affirmation de la liberté, quand il a volontairement renoncé à
l’enseignement qui le tenait enfermé dans un statut social précis, fut un geste
de bravoure. Mais sa valeur est allée ensuite en diminuant, la faute à une vie
qui se délite en compagnie des morts, et des morts que les morts ont connus, et
des morts à venir qui auront côtoyé les vivants d’aujourd’hui.
Ordesa est un
roman obsessionnel, sur l’étroite ligne de crête qui sépare deux mondes pas si
étrangers l’un à l’autre qu’il y paraît. La conscience aigüe des limites de
l’homme fournit l’équilibre précaire de celui qui raconte avec ironie :
« Le côté comique de la condition humaine, c’est qu’elle n’a pas besoin de
la vérité, considérée comme un ornement, un ornement moral. »
Ordesa est un livre âpre qui
réveille.
Autoportrait ? Cela y ressemble bien. Ordesa, de Manuel Vilas, traduit par Isabelle Gugnon, est la longue
complainte d’un écrivain qui ne parvient pas à faire le deuil de ses parents.
Cela ne semble pas enthousiasmant. Et pourtant, dans les méandres des remords,
l’illumination des souvenirs, la perte de moments, l’oubli de visages, la
disparition d’articulations importantes d’autrefois, la vie et la mort se
renvoient sans cesse la balle. Le mouvement est parfois infime, parfois il
prend une amplitude plus grande – toujours il exerce sur le lecteur une
fascination qui ne cesse de croître jusqu’aux dernières pages, un épilogue en
forme de poèmes qui reviennent, afin que nul n’oublie, sur quelques idées
fortes parmi celles qui animent Ordesa.
Ordesa est une vallée pyrénéenne à côté de laquelle se
dresse le mont Perdu, nom symbolique qui ne se pose pas là par hasard puisque
tout le livre est une tentative de résistance à l’effacement de faits que le
temps érode. Et aussi à ce qu’a fait le père : « Plus que mourir, mon
père s’est perdu, il a pris la tangente. Il est devenu un mont Perdu. »
Au point de départ, et pour expliquer la difficulté à
affronter sereinement cette disparition ainsi que celle de la mère, il y a
peut-être cette faute originelle – du moins considérée comme telle –, d’avoir
choisi la crémation plutôt que l’enfouissement : « la crémation est
irréparable, elle interdit toute possibilité d’exhumation du corps. »
La peur a accompagné le narrateur au fil des années :
peur des colères du père, quand il se mettait à tout casser sans jamais
cependant s’en prendre directement aux membres de sa famille, peur de
l’appartement, de la ville, peur de tout, mais il faut l’envisager comme un
sentiment salutaire : « Mon Dieu, comme j’aime les désespérés. Ce
sont les meilleurs. »
Il y a eu la culpabilité, aussi, devant les gestes ambigus
d’un prêtre que la mémoire n’a pas retenus, ce qui est pire que s’ils étaient
restés avec précision, car la présence du Mal, quand celui-ci est flou,
interdit aux victimes de se racheter, les rend « excrémentielles », méprisables.
« On aime les héros, pas les victimes. »
Et le narrateur n’a certes rien d’un héros. Seule peut-être
son affirmation de la liberté, quand il a volontairement renoncé à
l’enseignement qui le tenait enfermé dans un statut social précis, fut un geste
de bravoure. Mais sa valeur est allée ensuite en diminuant, la faute à une vie
qui se délite en compagnie des morts, et des morts que les morts ont connus, et
des morts à venir qui auront côtoyé les vivants d’aujourd’hui.
Ordesa est un
roman obsessionnel, sur l’étroite ligne de crête qui sépare deux mondes pas si
étrangers l’un à l’autre qu’il y paraît. La conscience aigüe des limites de
l’homme fournit l’équilibre précaire de celui qui raconte avec ironie :
« Le côté comique de la condition humaine, c’est qu’elle n’a pas besoin de
la vérité, considérée comme un ornement, un ornement moral. »
Ordesa est un livre âpre qui
réveille.
Magazine Culture
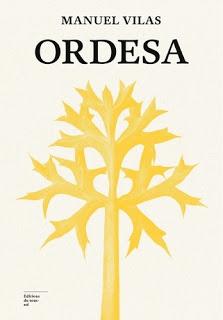 Autoportrait ? Cela y ressemble bien. Ordesa, de Manuel Vilas, traduit par Isabelle Gugnon, est la longue
complainte d’un écrivain qui ne parvient pas à faire le deuil de ses parents.
Cela ne semble pas enthousiasmant. Et pourtant, dans les méandres des remords,
l’illumination des souvenirs, la perte de moments, l’oubli de visages, la
disparition d’articulations importantes d’autrefois, la vie et la mort se
renvoient sans cesse la balle. Le mouvement est parfois infime, parfois il
prend une amplitude plus grande – toujours il exerce sur le lecteur une
fascination qui ne cesse de croître jusqu’aux dernières pages, un épilogue en
forme de poèmes qui reviennent, afin que nul n’oublie, sur quelques idées
fortes parmi celles qui animent Ordesa.
Ordesa est une vallée pyrénéenne à côté de laquelle se
dresse le mont Perdu, nom symbolique qui ne se pose pas là par hasard puisque
tout le livre est une tentative de résistance à l’effacement de faits que le
temps érode. Et aussi à ce qu’a fait le père : « Plus que mourir, mon
père s’est perdu, il a pris la tangente. Il est devenu un mont Perdu. »
Au point de départ, et pour expliquer la difficulté à
affronter sereinement cette disparition ainsi que celle de la mère, il y a
peut-être cette faute originelle – du moins considérée comme telle –, d’avoir
choisi la crémation plutôt que l’enfouissement : « la crémation est
irréparable, elle interdit toute possibilité d’exhumation du corps. »
La peur a accompagné le narrateur au fil des années :
peur des colères du père, quand il se mettait à tout casser sans jamais
cependant s’en prendre directement aux membres de sa famille, peur de
l’appartement, de la ville, peur de tout, mais il faut l’envisager comme un
sentiment salutaire : « Mon Dieu, comme j’aime les désespérés. Ce
sont les meilleurs. »
Il y a eu la culpabilité, aussi, devant les gestes ambigus
d’un prêtre que la mémoire n’a pas retenus, ce qui est pire que s’ils étaient
restés avec précision, car la présence du Mal, quand celui-ci est flou,
interdit aux victimes de se racheter, les rend « excrémentielles », méprisables.
« On aime les héros, pas les victimes. »
Et le narrateur n’a certes rien d’un héros. Seule peut-être
son affirmation de la liberté, quand il a volontairement renoncé à
l’enseignement qui le tenait enfermé dans un statut social précis, fut un geste
de bravoure. Mais sa valeur est allée ensuite en diminuant, la faute à une vie
qui se délite en compagnie des morts, et des morts que les morts ont connus, et
des morts à venir qui auront côtoyé les vivants d’aujourd’hui.
Ordesa est un
roman obsessionnel, sur l’étroite ligne de crête qui sépare deux mondes pas si
étrangers l’un à l’autre qu’il y paraît. La conscience aigüe des limites de
l’homme fournit l’équilibre précaire de celui qui raconte avec ironie :
« Le côté comique de la condition humaine, c’est qu’elle n’a pas besoin de
la vérité, considérée comme un ornement, un ornement moral. »
Ordesa est un livre âpre qui
réveille.
Autoportrait ? Cela y ressemble bien. Ordesa, de Manuel Vilas, traduit par Isabelle Gugnon, est la longue
complainte d’un écrivain qui ne parvient pas à faire le deuil de ses parents.
Cela ne semble pas enthousiasmant. Et pourtant, dans les méandres des remords,
l’illumination des souvenirs, la perte de moments, l’oubli de visages, la
disparition d’articulations importantes d’autrefois, la vie et la mort se
renvoient sans cesse la balle. Le mouvement est parfois infime, parfois il
prend une amplitude plus grande – toujours il exerce sur le lecteur une
fascination qui ne cesse de croître jusqu’aux dernières pages, un épilogue en
forme de poèmes qui reviennent, afin que nul n’oublie, sur quelques idées
fortes parmi celles qui animent Ordesa.
Ordesa est une vallée pyrénéenne à côté de laquelle se
dresse le mont Perdu, nom symbolique qui ne se pose pas là par hasard puisque
tout le livre est une tentative de résistance à l’effacement de faits que le
temps érode. Et aussi à ce qu’a fait le père : « Plus que mourir, mon
père s’est perdu, il a pris la tangente. Il est devenu un mont Perdu. »
Au point de départ, et pour expliquer la difficulté à
affronter sereinement cette disparition ainsi que celle de la mère, il y a
peut-être cette faute originelle – du moins considérée comme telle –, d’avoir
choisi la crémation plutôt que l’enfouissement : « la crémation est
irréparable, elle interdit toute possibilité d’exhumation du corps. »
La peur a accompagné le narrateur au fil des années :
peur des colères du père, quand il se mettait à tout casser sans jamais
cependant s’en prendre directement aux membres de sa famille, peur de
l’appartement, de la ville, peur de tout, mais il faut l’envisager comme un
sentiment salutaire : « Mon Dieu, comme j’aime les désespérés. Ce
sont les meilleurs. »
Il y a eu la culpabilité, aussi, devant les gestes ambigus
d’un prêtre que la mémoire n’a pas retenus, ce qui est pire que s’ils étaient
restés avec précision, car la présence du Mal, quand celui-ci est flou,
interdit aux victimes de se racheter, les rend « excrémentielles », méprisables.
« On aime les héros, pas les victimes. »
Et le narrateur n’a certes rien d’un héros. Seule peut-être
son affirmation de la liberté, quand il a volontairement renoncé à
l’enseignement qui le tenait enfermé dans un statut social précis, fut un geste
de bravoure. Mais sa valeur est allée ensuite en diminuant, la faute à une vie
qui se délite en compagnie des morts, et des morts que les morts ont connus, et
des morts à venir qui auront côtoyé les vivants d’aujourd’hui.
Ordesa est un
roman obsessionnel, sur l’étroite ligne de crête qui sépare deux mondes pas si
étrangers l’un à l’autre qu’il y paraît. La conscience aigüe des limites de
l’homme fournit l’équilibre précaire de celui qui raconte avec ironie :
« Le côté comique de la condition humaine, c’est qu’elle n’a pas besoin de
la vérité, considérée comme un ornement, un ornement moral. »
Ordesa est un livre âpre qui
réveille.
