Il m'est arrivé d'être dégoûtée des études littéraires à force de trop de chipotage sur les détails. Il m'est arrivé d'en avoir assez de disséquer des textes tel le chirurgien qui ouvre des corps sous la lumière crue du bloc opératoire afin de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Il m'est arrivé de ne plus percevoir le sens général d'un écrit et de n'y voir plus que des sons, des lettres, des mots isolés, des images tirées par les cheveux et des références peu évidentes à l'Antiquité ou à Dieu. Il m'est arrivé de ne plus avoir envie de lire. Il m'est arrivé de haïr des romans magnifiques et de la poésie sublime. Mais quand je me suis plongée dans l'univers infiniment vaste de l'oeuvre de Steinbeck, j'ai eu la nostalgie de tout cela. L'envie soudaine qu'un professeur, quelqu'un qui s'y entende en analyse et qui ait étudié le sujet de fond en comble, me serve sur un plateau de la référence biblique, de la légende, de la poétique et de la métaphore. Envie qu'on me m'explique ce que je suis trop brute pour saisir au vol, que l'on me briefe sur les associations d'idées, les allusions et les notions culturelles que j'ignore, sur les messages sous-entendus que je ne soupçonne pas. Le roman est tellement riche, ça se sent et on se trouve privé d'une partie de l'explication quand on s'arrête au premier degré. Bien sûr, on peut très bien se contenter d'une simple lecture, de suivre l'histoire. Mais, moi, j'en voulais plus. J'avais soif.
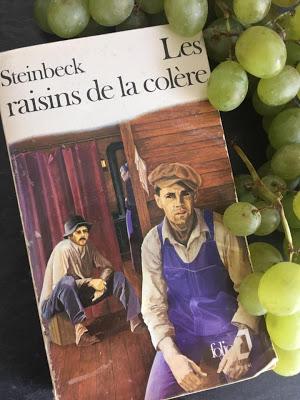
Ce roman est un tout, résume l'histoire de l'Humanité, le rapport entre les humains, la domination et les dominés, les maîtres invisibles, le pouvoir de l'argent, le capitalisme dévorant qui écrase les millions de bras qui travaillent pour eux sans jamais voir le bout du tunnel. J'ai lu les conflits intérieurs qui naissent dans les têtes de tant de souffrances à affronter et avec lesquelles composer. Les interrogations existentielles et le point de vue des faibles qui, rassemblés, peuvent devenir les puissants. Ou plutôt, une puissance, celle du peuple, de ce personnage à mille tête qui ignore encore son potentiel. J'ai aussi lu l'amour qui unit les êtres, le lien filial et ce personnage central qu'est la mère, sorte de déesse de la fécondité, paysanne visionnaire qui lit dans les cicatrices de ses semblables un avenir possible. Les raisins de la colère est une oeuvre totalement subversive - et qui a été reçue comme telle jusqu'à ce que, finalement, le cinéma et son pouvoir envoûtant la réhabilite - en ce qu'elle raconte comment s'insinue dans des êtres que l'on veut faire taire à tout prix la semence de la rébellion. Cette colère légitime qui gronde dans les sillons, dans les allées des plantations, sous les fruits mûrs et qui menace d'exploser un jour et de changer la face du monde. Le roman, en fait, n'a pas de fin. Les personnages, tel un peuple errant à la recherche de la Terre Promise, revivent sans cesse les mêmes traumatismes et les mêmes humiliations, s'en sortent toujours cependant, tels des survivants. La misère se lève chaque jour avec le soleil. On se demande si le combat n'est pas qu'une illusion, un rêve élaboré dans les pensées des héros, un fantasme commun mais en réalité jamais exprimé et si tout cela aura une fin un jour. Des décennies plus tard, on sait bien que non. Que la machine dévoreuse d'hommes n'a cessé d'avancer, de se développer, de grossir et d'engloutir de plus en plus de vies. Alors, nous vient une question : a-t-on encore au fond de nous ce rêve commun de révolte, cette colère qui nous unirait et nous pousserait à nous défendre ? Phrase bateau par excellence : on ne sort pas indemne d'une telle lecture. Forcément, on se questionne. Et on s'interroge : que lire, après ça ? Dur d'ouvrir autre chose quand on a eu à faire à un livre qui englobait tous les autres.
