 Moins un tableau affiche l’évidence, plus il intrigue et
approche d’une vérité cachée. C’est l’un des axes sur lequel court, en deux
volumes, le roman de Haruki Murakami, Le Meurtre du Commandeur. Le narrateur est un peintre spécialisé
dans le portrait et vit confortablement des commandes passées par des personnes
aisées. Mais sa vie change quand son épouse, dont il n’avait pas mesuré la
volonté de changement, envisage une séparation. Après quelque temps d’errance
au volant de sa voiture, il se pose dans la maison d’un vieux peintre célèbre, Tomohiko
Amada, installé dans une résidence médicalisée où, très affaibli, il termine sa
vie. Le fils de celui-ci, Masahiko Amada, un ami du personnage principal, la
lui prête contre un loyer dérisoire, surtout pour qu’elle ne reste pas
inoccupée.
C’est là, au sommet d’une montagne, dans une demeure dédiée
depuis longtemps à la création artistique solitaire et avec le soutien de cours
qu’il donne à des enfants comme à des adultes de la ville la plus proche, que
le portraitiste recommence à travailler. Il ne voulait plus prendre de
commandes, il revient cependant sur sa décision pour répondre au désir d’un
voisin agréable et prévenant, Wataru Menshiki, riche au point de proposer, pour
le travail, une somme à laquelle il est difficile de résister. L’occasion est
offerte, par la liberté que Menshiki l’autorise à prendre par rapport à son
style habituel, d’expérimenter une forme inédite et d’explorer une voie
nouvelle.
A travers ce portrait atypique, augmenté de celui d’une
jeune adolescente à laquelle Menshiki croit être lié ainsi que d’un troisième,
représentant un homme mystérieux croisé pendant son errance, le peintre cherche
et croit trouver le moyen d’exprimer le plus intime d’une personnalité. Une
quatrième toile, très différente, reproduit un lieu proche de la maison du
peintre, une fosse qu’il a découverte en compagnie de son voisin grâce au son
d’une clochette qui semblait en provenir. Etrange endroit après l'ouverture
duquel « d’inexplicables événements
s’étaient mis à se produire, l’un après l’autre. Ou bien, tout avait peut-être
commencé lorsque j’avais découvert, dans le grenier, Le Meurtre du
Commandeur et que je l’avais sorti de son
emballage. »
Une autre toile encore, peinte à l’évidence par Tomohiko
Amada, peut-être inspirée par un épisode de sa vie à Vienne avant la Seconde
Guerre mondiale. Elle montre l’assassinat de celui qui, sous la forme d’un
petit homme habillé comme le Commandeur et pas plus haut que soixante
centimètres, apparaît dès lors devant le narrateur. Le Commandeur pratique une
langue curieuse, pas toujours intelligible immédiatement et pleine d’énigmes
destinées à se résoudre d’elles-mêmes à condition d’accepter quelques règles.
Une dimension fantastique double le réel comme pour lui
ajouter une couche de sens, mais aussi pour en rendre la perception plus floue :
« dans notre vie, il est fréquent de
ne pas pouvoir discerner la frontière entre le réel et l’irréel. Et il me
semble que cette frontière est toujours mouvante. Comme une frontière entre
deux pays qui se déplacerait à son gré selon l’humeur du jour. Il faut faire
très attention à ces mouvements. Sinon, on finit par ne plus savoir de quel
côté on se trouve. »
Moins un tableau affiche l’évidence, plus il intrigue et
approche d’une vérité cachée. C’est l’un des axes sur lequel court, en deux
volumes, le roman de Haruki Murakami, Le Meurtre du Commandeur. Le narrateur est un peintre spécialisé
dans le portrait et vit confortablement des commandes passées par des personnes
aisées. Mais sa vie change quand son épouse, dont il n’avait pas mesuré la
volonté de changement, envisage une séparation. Après quelque temps d’errance
au volant de sa voiture, il se pose dans la maison d’un vieux peintre célèbre, Tomohiko
Amada, installé dans une résidence médicalisée où, très affaibli, il termine sa
vie. Le fils de celui-ci, Masahiko Amada, un ami du personnage principal, la
lui prête contre un loyer dérisoire, surtout pour qu’elle ne reste pas
inoccupée.
C’est là, au sommet d’une montagne, dans une demeure dédiée
depuis longtemps à la création artistique solitaire et avec le soutien de cours
qu’il donne à des enfants comme à des adultes de la ville la plus proche, que
le portraitiste recommence à travailler. Il ne voulait plus prendre de
commandes, il revient cependant sur sa décision pour répondre au désir d’un
voisin agréable et prévenant, Wataru Menshiki, riche au point de proposer, pour
le travail, une somme à laquelle il est difficile de résister. L’occasion est
offerte, par la liberté que Menshiki l’autorise à prendre par rapport à son
style habituel, d’expérimenter une forme inédite et d’explorer une voie
nouvelle.
A travers ce portrait atypique, augmenté de celui d’une
jeune adolescente à laquelle Menshiki croit être lié ainsi que d’un troisième,
représentant un homme mystérieux croisé pendant son errance, le peintre cherche
et croit trouver le moyen d’exprimer le plus intime d’une personnalité. Une
quatrième toile, très différente, reproduit un lieu proche de la maison du
peintre, une fosse qu’il a découverte en compagnie de son voisin grâce au son
d’une clochette qui semblait en provenir. Etrange endroit après l'ouverture
duquel « d’inexplicables événements
s’étaient mis à se produire, l’un après l’autre. Ou bien, tout avait peut-être
commencé lorsque j’avais découvert, dans le grenier, Le Meurtre du
Commandeur et que je l’avais sorti de son
emballage. »
Une autre toile encore, peinte à l’évidence par Tomohiko
Amada, peut-être inspirée par un épisode de sa vie à Vienne avant la Seconde
Guerre mondiale. Elle montre l’assassinat de celui qui, sous la forme d’un
petit homme habillé comme le Commandeur et pas plus haut que soixante
centimètres, apparaît dès lors devant le narrateur. Le Commandeur pratique une
langue curieuse, pas toujours intelligible immédiatement et pleine d’énigmes
destinées à se résoudre d’elles-mêmes à condition d’accepter quelques règles.
Une dimension fantastique double le réel comme pour lui
ajouter une couche de sens, mais aussi pour en rendre la perception plus floue :
« dans notre vie, il est fréquent de
ne pas pouvoir discerner la frontière entre le réel et l’irréel. Et il me
semble que cette frontière est toujours mouvante. Comme une frontière entre
deux pays qui se déplacerait à son gré selon l’humeur du jour. Il faut faire
très attention à ces mouvements. Sinon, on finit par ne plus savoir de quel
côté on se trouve. »
 De quel côté nous sommes, on ne le sait pas toujours dans Le Meurtre du Commandeur. Bien souvent,
des deux côtés à la fois, superposés, confondus avec l’Idée du premier volume
et la Métaphore du second. Chaque sous-titre introduit, majuscule comprise, une
de ces notions : « Une Idée apparaît » et « La Métaphore se
déplace ». L’Idée s’est d’abord concrétisée dans le Commandeur – elle
prendra un autre sens à la fin du roman, rejoignant la Métaphore qui, avec
minuscule cette fois, trouve sa place dans le glissement d’une signification
vers une autre : « dans tout
phénomène et dans toute chose, une bonne métaphore est à même de faire surgir
une voie de possibilités cachées, de nous la montrer. De la même façon qu’un
bon poète, avec sa propre vision, est à même de nous révéler une autre scène,
nouvelle et différente. Et il va sans dire que la plus belle des métaphores
fera le plus beau des poèmes. »
La coexistence de plusieurs mondes dont l’un n’est pas moins
authentique que l’autre est un thème récurrent chez Haruki Murakami. On se
souvient de la deuxième Lune de 1Q84,
manifestation visuelle puissante de la dualité dans laquelle nous vivons tous,
souvent sans le savoir. Le romancier japonais nous ouvre les yeux sur la part
inconnue d’un environnement plus complexe qu’il le semblait. Il n’en épuise pas
le mystère mais en approche le cœur jusqu’à faire douter de la raison sur
laquelle nous fondions notre existence. A ébranler ainsi quelques certitudes,
il offre l’exaltante possibilité d’envisager l’existence autrement, d’y tracer
des chemins fascinants en compagnie de personnages qui deviennent des guides
partageant l’inquiétude d’un lecteur plongé dans leur aventure.
De quel côté nous sommes, on ne le sait pas toujours dans Le Meurtre du Commandeur. Bien souvent,
des deux côtés à la fois, superposés, confondus avec l’Idée du premier volume
et la Métaphore du second. Chaque sous-titre introduit, majuscule comprise, une
de ces notions : « Une Idée apparaît » et « La Métaphore se
déplace ». L’Idée s’est d’abord concrétisée dans le Commandeur – elle
prendra un autre sens à la fin du roman, rejoignant la Métaphore qui, avec
minuscule cette fois, trouve sa place dans le glissement d’une signification
vers une autre : « dans tout
phénomène et dans toute chose, une bonne métaphore est à même de faire surgir
une voie de possibilités cachées, de nous la montrer. De la même façon qu’un
bon poète, avec sa propre vision, est à même de nous révéler une autre scène,
nouvelle et différente. Et il va sans dire que la plus belle des métaphores
fera le plus beau des poèmes. »
La coexistence de plusieurs mondes dont l’un n’est pas moins
authentique que l’autre est un thème récurrent chez Haruki Murakami. On se
souvient de la deuxième Lune de 1Q84,
manifestation visuelle puissante de la dualité dans laquelle nous vivons tous,
souvent sans le savoir. Le romancier japonais nous ouvre les yeux sur la part
inconnue d’un environnement plus complexe qu’il le semblait. Il n’en épuise pas
le mystère mais en approche le cœur jusqu’à faire douter de la raison sur
laquelle nous fondions notre existence. A ébranler ainsi quelques certitudes,
il offre l’exaltante possibilité d’envisager l’existence autrement, d’y tracer
des chemins fascinants en compagnie de personnages qui deviennent des guides
partageant l’inquiétude d’un lecteur plongé dans leur aventure.
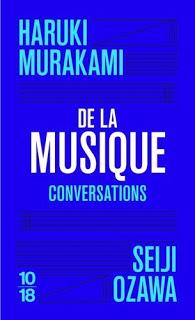 A la sortie de 1Q84,
les lecteurs étaient devenus mélomanes en se précipitant sur le Sinfonietta de Leos Janacek. L’incolore Tsukuru Tazaki et ses années de
pèlerinage épousait le rythme d’une œuvre de Franz Liszt. Le narrateur du Meurtre du Commandeur défend une thèse
selon laquelle il est important, pour certains disques, d’avoir à les
retourner, face A, face B. Et l’on sait Murakami amateur de jazz. Dans De la musique, ses
conversations avec le chef d’orchestre Seiji Ozawa sont la rencontre de deux
manières différentes de s’intéresser à la même chose. Murakami en dilettante
éclairé, Ozawa en professionnel averti.
Du coup, il y a de quoi satisfaire tous les publics (sauf,
bien entendu, celui qui serait totalement réfractaire à cet art). L’écrivain
prévient : « Au fil de nos
conversations, certains de mes commentaires ont sans doute pu paraître
amateurs, voire insultants ». Mais, ajoute-t-il, « Ozawa n’est pas du genre à se laisser atteindre par ces
choses-là. » Le musicien dira d’ailleurs : « j’aime bien parler musique avec vous, parce que vous avez une
tout autre perspective que la mienne. »
A la sortie de 1Q84,
les lecteurs étaient devenus mélomanes en se précipitant sur le Sinfonietta de Leos Janacek. L’incolore Tsukuru Tazaki et ses années de
pèlerinage épousait le rythme d’une œuvre de Franz Liszt. Le narrateur du Meurtre du Commandeur défend une thèse
selon laquelle il est important, pour certains disques, d’avoir à les
retourner, face A, face B. Et l’on sait Murakami amateur de jazz. Dans De la musique, ses
conversations avec le chef d’orchestre Seiji Ozawa sont la rencontre de deux
manières différentes de s’intéresser à la même chose. Murakami en dilettante
éclairé, Ozawa en professionnel averti.
Du coup, il y a de quoi satisfaire tous les publics (sauf,
bien entendu, celui qui serait totalement réfractaire à cet art). L’écrivain
prévient : « Au fil de nos
conversations, certains de mes commentaires ont sans doute pu paraître
amateurs, voire insultants ». Mais, ajoute-t-il, « Ozawa n’est pas du genre à se laisser atteindre par ces
choses-là. » Le musicien dira d’ailleurs : « j’aime bien parler musique avec vous, parce que vous avez une
tout autre perspective que la mienne. »Le plus souvent, ils partent de l’écoute d’un enregistrement, puis d’un autre, pour comparer différentes interprétations et saisir leurs principales caractéristiques. Comprendre comment la musique vit, vibre et touche au cœur, c’est au fond le but ultime de leurs échanges. Et ceux-ci l’atteignent puisque, le livre refermé, on n’a rien de plus pressé que de réécouter Glenn Gould ou… Seiji Ozawa.
