Seconde lecture de cette sélection du Prix du polar, un roman signé par un français, Christian Blanchard, au titre sûrement énigmatique pour la majorité : Iboga.
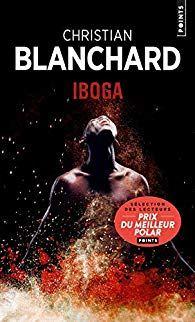
Voilà de quoi relever un grand coup le niveau de cette sélection après un premier contact sans grand intérêt. Mais le livre peut également poser problème…
En effet, comme certains lecteurs du jury se le sont demandés, s’agit-il d’un polar ? Iboga n’est pas à proprement parler un roman policier. Il ne pose pas vraiment d’intrigue, il n’y a pas d’enquête à proprement parler. Ce qui n’empêche pas le récit de poser un nombre de questions et, petit à petit, de les résoudre ou du moins d’aiguiller le lecteur.
Si Iboga fonctionne, c’est d’abord par sa construction, intimement liée à une narration à la première personne. Le protagoniste et narrateur est Jefferson Petitbois, un gamin (de dix-sept ans lorsqu’on le découvre) condamné à mort pour une série de meurtres.
Le livre débute en 1980 et son histoire couvre un peu plus de vingt ans. Un long délai, où il ne se passe finalement pas grand-chose, puisque le récit est orchestré avec une certaine instabilité qui fait souvent tourner en boucle les réflexions du personnage. Des réflexions sur sa condamnation à mort d’abord, qui ne sera pas concrétisée, puisque l’intrigue a lieu en France et que Mitterrand est élu et que son gouvernement abolit la peine de mort ; puis des réflexions sur lui-même, sur sa condition, et bien sûr sur ses actes.
Les actes de Petitbois sont justement l’élément majeur du récit, disséminés au fil de la lecture, par petites touches, entraînant la curiosité et les questionnements du lecteur. C’est là le moteur principal de l’intrigue, qui implique des questions sur la personne même de Jefferson Petitbois (sachant qu’en prime, en tant que narrateur, il a d’autant plus de raison de nous mentir ou d’omettre des éléments).
En soi, le livre n’a aucun surprise, aucun retournement à nous offrir. Mais son architecture instable, répétitive, et les qualités évidentes de la plume de son auteur, Christian Blanchard, donne une puissance indéniable au tout.
En réalité, ce que Blanchard nous raconte, c’est une sorte de révélation, un récit anti-biblique, un évangile criminel où, malgré tout, une certaine repentance semble servir de clé de voûte.
Inspiré probablement par la condamnation à mort de Bruno Triplet (dix-sept ans à l’époque du meurtre qu’il a commis, gracié par Valéry Giscard d’Estaing), Blanchard joue d’une symbolique christique à longueur de roman. Avec ses lieux où règne l’enfermement et le repli sur soi, une sorte de vision prophétique motrice du passage à l’acte et qui donne son titre au livre (l’iboga est une plante africaine aux vertus psychotropes), des rappels aux évangiles (les 33 chapitres du livre par exemple), Blanchard raconte une résurrection d’un gamin trop tôt meurtrier, forcé à vivre après avoir attendu la mort, sans cesse tenté par ses excès de violence et la possibilité d’une stabilité.
Derrière un nom aux sonorités noires de la Louisiane, sous les traits de son univers carcéral, on devine l’attrait de Christian Blanchard pour les récits américains prenant place en prison. Une souris confidente de son protagoniste renvoie directement (très probable) à Stephen King et La ligne verte.
« En prison, il n’y a plus cette peur de l’instant. Un lendemain différent n’existe pas. Il est la copie perpétuelle du moment présent. » (p. 82)
Du coup, on traîne, on tourne, on répète, on ajoute un fragment ici ou là, et on reproduit encore le cercle. Cercle des relations, cercle des crimes, cercle des réflexions, cercle des peurs. Le livre, encore une fois, ne raconte pas grand-chose, il aurait pu se réduire de 50 ou 100 pages. Mais c’est tout le style qui en aurait souffert, toute la logique de Jefferson Petitbois qui aurait sauté, tout le ressenti d’étouffement du lecteur qui aurait été sacrifié.
Non, décidément, si Iboga est un bon livre, un beau récit, c’est parce qu’il traîne. Parce qu’il hésite, parce qu’il tourne en boucles.
On lui pardonne de rapides lourdeurs finales, des facilités, sur les relations entre les personnages (la psy en particulier), car le gros morceau, celui que Blanchard a assaisonné par à-coups au fil de son texte, il le laisse entier à son lecteur. Pas pour mordre dedans à pleines dents – il n’y a pas de révélation permettant un tel luxe -, mais pour le déguster, pour avoir finalement le dernier mot sur son intrigue et faire, à l’égal du protagoniste Petitbois, le choix de sa vérité…
