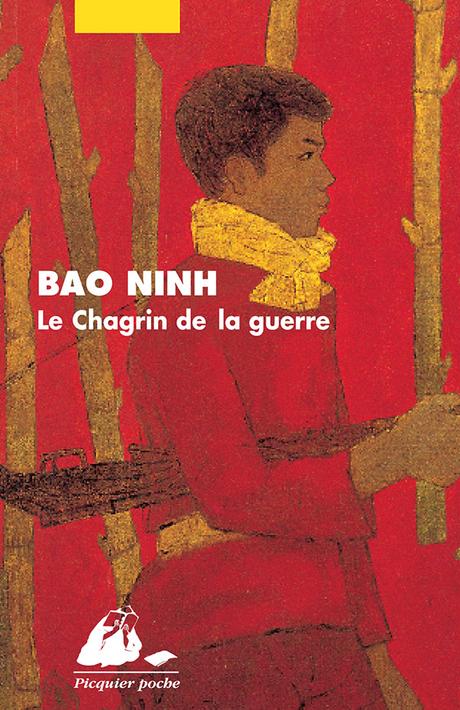 Je ne l’ai rencontré qu’une seule fois. Le Vietnam s’ouvrait tout juste alors. Sachant mon intérêt pour la littérature de leur pays, des amis avaient profité de ma présence là-bas pour réunir quelques écrivains. Plusieurs générations s’étaient rejointes dans un petit appartement. Lui, Bao Ninh, on me l’avait présenté comme l’auteur d’un roman qui avait fait beaucoup de bruit à sa parution à la fin des années quatre-vingts, et été interdit depuis. Cet après-midi-là, il n’avait presque rien dit. Il avait écouté les uns et les autres. Il se taisait devant les dissidents présents, ceux du moins qui avaient osé venir.
Je ne l’ai rencontré qu’une seule fois. Le Vietnam s’ouvrait tout juste alors. Sachant mon intérêt pour la littérature de leur pays, des amis avaient profité de ma présence là-bas pour réunir quelques écrivains. Plusieurs générations s’étaient rejointes dans un petit appartement. Lui, Bao Ninh, on me l’avait présenté comme l’auteur d’un roman qui avait fait beaucoup de bruit à sa parution à la fin des années quatre-vingts, et été interdit depuis. Cet après-midi-là, il n’avait presque rien dit. Il avait écouté les uns et les autres. Il se taisait devant les dissidents présents, ceux du moins qui avaient osé venir.
Je ne soupçonnais pas que son livre bien plus tard allait me retrouver. Qu’il deviendrait même une des nervures de ma relation avec ce pays.
C’est une œuvre triste et de la désillusion, mais j’y reconnais un pays qui est mien, où pourtant je ne suis pas né, avec lequel ma famille n’a aucun lien, et que je n’ai découvert que par le hasard des amitiés. Peut-être n’est-ce pas un pays physique dont il s’agit, mais une contrée plus intérieure aux frontières imprécises. C’est que là-bas s’est ouvert pour moi un autre pays : cet à-venir qu’on reconnaît et qui semble surgir d’un passé au-delà de notre propre existence.
On me l’a souvent dit en souriant, j’ai dû être vietnamien dans une vie antérieure. Et chaque fois que je relis Le Chagrin de la guerre, je ne peux m’empêcher de penser que c’est peut-être vrai. Car, même si je fais taire mes souvenirs de voyage et divagations superstitieuses, même si je sens monter la tristesse devant l’étendue du carnage et d’un deuil sans mesure, même si je laisse prendre possession de moi la « douleur sans perspective » que porte ce roman, même si une langueur furieuse se soulève comme une brume, je me sens gagné par une troublante fraternité.
C’est pourtant un livre dur et boueux, épais comme la vie entravée, et qui tente de faire un peu de clarté sur la viscosité du destin.
En l’ouvrant, nous voici de l’autre côté. Non pas celui du pays étranger et d’une guerre enlisée, d’Apocalypse now ou de Platoon, non celui qu’on voit d’hélicoptère et où l’on attend d’être extrait, par les birds, des rizières piégées et des forêts pleines de tigres maigres et de serpents venimeux. Nous voici parmi les soldats à voix nasillarde des films, ceux qu’on voit à peine et qui sont partout. Nous voici dans la jungle avec eux qui parlent de fatigue, d’amour, d’épuisement, de désertion, qui dressent des autels pour les morts, qui sont fragiles et apeurés, couards ou superstitieux, sans merci et héroïques ; avec ces bô dôï qui jouent aux cartes, boivent et fument, des herbes et roses maléfiques, qui se souviennent des amis et amours de lycée, des petits lacs de Hanoi et de la rue Nguyen Du, et de ce qu’il faut cacher aux commissaires politiques. Nous voici de l’autre côté, et c’est toujours la même humanité.
L’autre côté, c’est aussi celui du retour. Quand on ne peut vivre un réel aussi puissant et absolu que la guerre, sinon l’amour. Quand on baisse « la tête pour n’avoir pas à subir l’incompétence, l’absence de talent, la grossièreté, la vulgarité, la morgue dévergondée, la fadeur lamentable, si caractéristique de la vie spirituelle de l’après-guerre. » Quand ce sont au contraire les drames de ce violent passé, qui aident et donnent « le courage d’échapper à tant de sales comédies de la vie d’aujourd’hui. » Quand on se retrouve encore face à l’enfance, à l’exil intérieur qui semble remonter loin, au pas de côté dont on ne revient pas, à l’impasse d’une idéologie qui a englouti tant de morts et ne se lasse pas d’en réclamer, à un amour qui ne s’accomplit plus.
L’autre côté, c’est encore celui pour l’écrivain qui avance dans la jungle de son manuscrit. Là où « la voie du roman se fond dans le chemin du retour, après la guerre, sur les traces des équipes de ramassage des os, parmi les tombes éparpillées sur les hauteurs nord des Hauts-Plateaux, dans l’atmosphère hantée des jungles ténébreuses, empoisonnées, empestant le souffle des morts. » Comment écrire, se demande Bao Ninh, comment écrire la guerre ? Comment écrire tout ce qu’elle a contaminé de son aile mauvaise et jusqu’à ce qui ne la concernait pas ? Comment écrire ce qui ne sera pas une lamentation, ni une déploration, mais aussi une célébration de la vie, malgré tout ? C’est la question que se posent tous les écrivains. Comment écrire ce qui s’est défait et qui ne peut se réparer, dans la perte de quoi on reste ? Comment écrire après la mort de l’amour ?
Cet autre côté, c’est enfin ce lieu vers où l’on se tourne quand l’impossible vient des êtres eux-mêmes. « Tu es devenu ce que tu es, et moi, ce que je suis devenue, on n’y peut plus rien » dit son amie au héros-écrivain. Ce lieu, c’est ce là-bas plus réel que tout et qui devient refuge, l’insondé d’une promesse qu’on ne perçoit qu’au retour : quand l’art devient une voie qui sauve du suicide. Parce que l’on sera à jamais hanté et qu’on aura perdu pour longtemps, pour toujours peut-être, la capacité de mener une vie normale.
La première fois que j’ai vu la couverture du roman dans son édition française, un jeune soldat en arme, détail tiré d’une laque du musée des Beaux-Arts de Hanoi, c’était entre les mains d’un ami que je rejoignais dans un café. Il venait de le découvrir et me demandait si je l’avais déjà lu. Le nom de l’auteur me parut familier. Je scrutai la photo en quatrième. Et soudain c’était évident, je connaissais cet homme. Et ce livre était celui dont on m’avait parlé autrefois et dont j’ignorais qu’il avait été depuis traduit en de multiples langues.
Tant d’années que je n’étais pas retourné au Vietnam. Je craignais les fantômes de ma propre vie, et des désillusions qui n’auraient pas manqué de devenir douloureuses en ce pays qui avait été justement le lieu d’une promesse sans contenu. Depuis, j’avais connu des drames, des amours mortes ou impossibles ; j’étais passé de l’autre côté et j’avais écrit des livres. Mais en retrouvant ce roman pour enfin le lire, je fus frappé de constater comme moi aussi c’était vers les morts que je revenais toujours, ou plutôt vers ce mort-jamais-mort en soi qui fait écrire, ce caillou noir dans un jardin zen, cette faille que rien ne peut soigner ni consoler que momentanément. Moi aussi j’avais affronté un monstre impossible à saisir, et été tenu comme le personnage de Bao Ninh, « dans la cage d’acier » de mon récit. Comme pour lui la guerre, la maladie pour moi, et ce déchirement de la mort et du retour improbable pour tous deux. Et bien sûr le livre à écrire en lequel cela « refusait de se terminer, même après le silence des armes. »
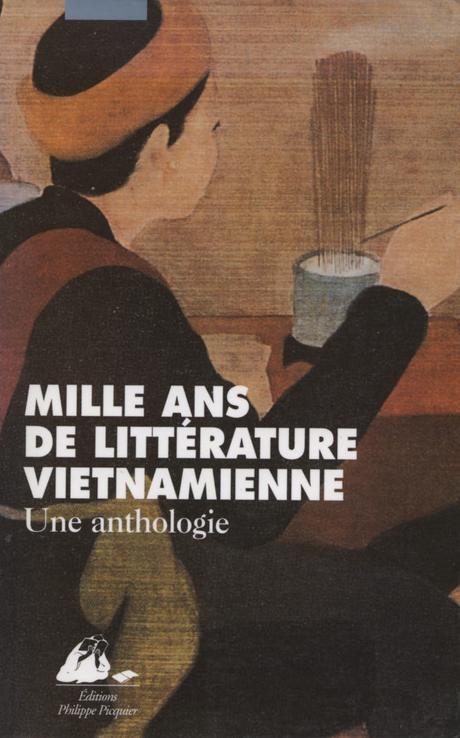
Or, si longtemps après, en découvrant l’œuvre de Bao Ninh, j’avais été frappé par la force qu’ont les croyances quand on se sent justement pris par la viscosité ou l’opacité d’un destin, quand on est apeuré dans la jungle de notre propre vie. Écrire alors ou brûler de l’encens. Et cultiver cette attention qui vient de la conscience que les fantômes existent bien, au moins dans nos esprits, et que le monde des vivants doit pour vivre en paix régler envers eux sa dette. Le chef de la mission de ramassage des ossements, où opérait le héros de Bao Ninh, le rappelait : « Si nous n’arrivons pas à savoir qui ils sont, leur mort pèsera toujours sur notre vie. »
C’est ce roman qui me décida de retourner à Hanoi. Il fallut trouver le bon moment. Les amis que j’y connaissais s’étaient dispersés aux quatre coins du monde. D’autres étaient morts. Mais certains proches avaient décidé de profiter de ma venue pour aller au pays.
Les premiers jours de mon séjour, j’avais pourtant souhaité rester seul. J’avais relu Le Chagrin de la guerre et longuement flâné près du lac Thiên Quang, dans la rue Nguyen Du, où le personnage de Bao Ninh erre lui aussi. J’étais allé devant la maison au premier étage de laquelle nous nous étions réunis autrefois, et qui était vendue. J’étais repassé voir la courette ombragée de la maison (elle aussi vendue) d’un vieil ami disparu, rue Ly Quoc Su. J’avais fait brûler des bâtonnets d’encens.
Après quelques jours, les fantômes m’ont laissé en paix. J’ai repris le cours de mon amitié avec ce pays qui m’avait donné une idée très haute de ce que pouvait être la littérature. Et j’ai épinglé au-dessus de l’étroite table, qui me servait de bureau dans la chambre d’hôtel, cette phrase de Bao Ninh : « Combien d’autres souvenirs encore, combien de gens, de destins, que jamais il ne pourrait oublier, mais que jamais aussi il ne pourrait transformer en histoire. »
Patrick Autréaux
Bao Ninh, Le Chagrin de la guerre Picquier poche, 283 pages, 9 euros.
Share this...

