Les gens, je crois qu’il va falloir que j’en rabatte de mes prétentions. Comment ai-je pu croire que j’allais pouvoir continuer à bloguer tranquille (ce qui, ne nous leurrons pas, est quand même un passe-temps plutôt prenant, mine de rien) avec trois enfants en bas âge, dont un bébé d’à peine un mois (❤️️), alors que j’ai déjà du mal à trouver du temps pour lire, voire à disposer de temps pour satisfaire mes besoins les plus élémentaires ?! (Genre me shooter au café ou prendre ma douche).

Mais, que voulez-vous, je suis atteinte du syndrome de la pensée magique. Quand j’étais ado, je rêvais que le temps s’arrête ; par exemple, une minute aurait duré une heure ; et ce, juste au moment où mon réveil sonnait le matin, afin de prolonger mon temps de sommeil racorni par les heures de lecture du soir. Rassurez-moi, nous sommes nombreux dans ce cas, à courir après le temps comme le lapin d’Alice ?
Brrrrreeeef, tout ça pour dire : ne vous attendez pas à une grande activité sur ce blog ces temps-ci. Toutefois, je suis tellement accro à ma drogue (3615 mes livres-mon blog) que je pense quand même essayer de dégager un peu de temps pour des billets par-ci par-là. Mais alors, il ne faut pas s’attendre à de l’analyse fine et détaillée, je n’aurais sans doute pas le temps de fignoler. (Telle que vous me voyez, je profite, pour vous écrire tout ça, que les deux grandes jouent au bébé dans le couffin de leur petit frère – alors que clairement c’est l’heure de leur dîner – tandis que ledit petit frère passe son temps d’éveil à les observer attentivement depuis son transat) (j’oubliais le fameux tag : #mèreindigne) (N.B. : l’état de grâce n’a duré que 8 minutes et demie).
Je vais donc vous faire un rapide tour d’horizon des livres lus pendant ma période post-accouchement (celle où je bénéficiais de la présence diligente des deux grands mères de ma couvée, et n’avais qu’à m’occuper de nourrir le petit dernier : donc celle où j’ai beaucoup lu).
« L’éducation sentimentale » de Flaubert, Préface d’Albert Thibaudet, contient « À propos du style de Flaubert » par Marcel Proust, Folio Classiques, 2005, 512 p.

Oui, je balance du lourd là. J’ai commencé à le lire au début de l’année 2019, en même temps que je couvais Junior pour son dernier mois in utero, et je dois dire que le rythme assez lent du roman fleuve de Flaubert collait bien à l’ambiance neigeuse et expectative de cette période. Bon, je n’en ai lu que la moitié, mais je compte bien le finir un de ces jours. L’éducation sentimentale (j’aime tellement ce titre !), c’est celle d’un jeune bachelier, Frédéric Moreau, dans le Paris des années 1840. Autour de lui les esprits s’échauffent, les étudiants manifestent sur la montagne Sainte-Geneviève, les socialistes et les « doctrinaires » se disputent dans les cafés, la bohème et la petite bourgeoisie se mêlent dans des salons plus ou moins respectables, la révolution de 1848 couve. Mais on dirait que tout ce tintouin glisse sur Frédéric comme un cours magistral de droit sur un auditoire endormi. Toutes ses pensées, tous ses efforts, et tout l’argent qu’il réussit à obtenir sont tournés vers les beaux yeux graves de la vertueuse Madame Arnoux. Ainsi, les années passent, les situations sociales et amoureuses se font et se défont, la révolution de 48 éclate, mais Frédéric reste cet éternel amoureux platonique, plein de velléités qu’il n’accomplit jamais.
Et elle, Mme Arnoux, comment la revoir maintenant ? Cela, d’ailleurs, était complètement impossible, n’ayant que trois mille francs de rente !
C’était drôle de lire L’éducation sentimentale après L’été des quatre rois, puisque du point de vue narratif, le premier est un peu la suite chronologique du second : après avoir éjecté Charles X, les Parisiens se préparent à virer son successeur Louis-Philippe du trône. Mais évidemment, le point de vue est tout différent, et pas seulement parce qu’un siècle sépare les deux auteurs (Flaubert a écrit et publié son roman sous le Second Empire). Loin d’écrire une chronique détaillée d’un changement de régime, Flaubert se centre sur le personnage assez médiocre de Frédéric, comme le rai de lumière traverse un prisme pour refléter toute une ambiance. Frédéric lui-même n’a guère plus d’épaisseur qu’une potiche de salon ; il est agi par les événements, plus qu’il n’agit sur eux ; et par là, Flaubert nous montre qu’il a bien le génie littéraire qu’on lui reconnaît, car toute son écriture vise à créer ce halo d’impuissance qui entoure Frédéric, à travers l’usage des temps verbaux (beaucoup d’imparfait) et de la forme passive notamment. Bon j’avoue, je n’ai pas trouvé ça toute seule : cette édition Folio a eu la bonne idée d’inclure un court essai de mon cher Proust qui explique tout ça bien mieux que moi ; il montre par exemple que les collines, les maisons et les objets sont parfois plus souvent les sujets des phrases que les êtres humains dans ce roman. (Petite parenthèse de groupie pâmée d’écrivains morts : j’adoooore quand un génie littéraire parle d’un autre génie littéraire, et encore plus quand je vois l’influence de l’un sur l’autre ; car je trouve qu’il y a un peu du caractère velléitaire du héros de « L’Éducation » dans le héros de « la Recherche » (son approche d’Albertine ressemble vraiment à l’approche de Mme Arnoux par Frédéric). Mais j’ai conscience que quand je dis ça, je réinvente l’eau chaude).
il n’existait au monde qu’un seul endroit pour faire valoir (ses talents) : Paris ! car, dans ses idées, l’art, la science et l’amour (ces trois faces de Dieu comme eût dit Pellerin) dépendaient exclusivement de la capitale.
En fin de compte, je ne peux pas dire que l’histoire en elle-même m’ait vraiment intéressée, malgré quelques morceaux de bravoure fort sympathiques, notamment les passages de fêtes (il faut dire qu’il me manque à lire toute la troisième partie, celle où l’Histoire avec un grand H s’accélère). On est loin du roman d’apprentissage, malgré son titre, car Frédéric semble ne rien retenir des événements qui coulent sur lui. Mais ce que j’ai adoré, vraiment, c’est le style. Dès l’incipit je me suis délectée des phrases gourmandes de Flau-Flau, de leur tournure à la fois solide et élégante, de leur allure faussement naturelle. Je me l’imaginais même fort bien ce grand homme, carré dans un fauteuil à oreillettes de sa maison de Croisset, ses yeux de crapaud mi-clos, en train de marmotter des bribes de cette histoire entre deux bouffées de pipe, toute ironie rentrée.
Voilà qui m’a conduite à écrire une chronique plus longue que prévue ; que voulez-vous, quand on aime, on ne compte pas.
Je passe donc rapidement sur les livres suivants, dont la consistance est à l’oeuvre flaubertienne ce que les amuse-bouche sont au ragoût de sept heures, mais qui étaient sans doute plus adaptées au chamboulement post-accouchement :
« Les filles de l’ouragan » de Joyce Maynard, traduit de l’américain par Simone Arous, Éditions 10-18, Littérature étrangère, 2013, 357 p.
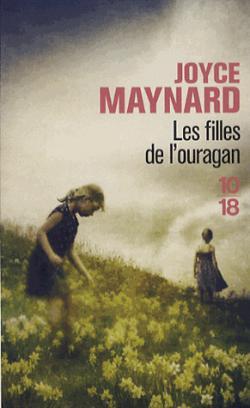
Deux voix alternent dans ce roman : celles de Ruth et de Dana, toutes deux nées dans le même hôpital d’un coin rural du New Hampshire le 4 juillet 1950. Hormis leur date et leur lieu de naissance, rien ne semble apparement les réunir. Ruth est la cinquième et dernière fille d’un ménage de fermiers enracinés dans la région depuis l’arrivée des premiers colons anglais sur le sol américain ; Dana a un grand frère et des parents complètement déconnectés de la réalité qui passent leur temps à déménager de région en région. Et pourtant, un secret les lie. De l’enfance à l’âge mûr, elles font face à un schéma familial qui n’est pas fait pour elles, se battent pour pouvoir vivre de leur passion (la peinture pour Ruth, l’agriculture pour Dana) et finissent enfin par faire la lumière sur leur origine.
Dès le début on pressent le tour de passe-passe qui entoure la naissance des deux « soeurs de naissance » (un filon que l’on connaît bien depuis Un long fleuve tranquille) et dès lors, une seule interrogation demeure : comment cela s’est-il produit ? Hormis ce petit mystère, l’ensemble de l’histoire manque singulièrement de souffle. L’auteur tourne autour du pot pendant tout le roman, délayant les états d’âmes des deux dames sur 350 pages, sans parvenir à provoquer l’étincelle magique qui entourait l’histoire des deux soeurs de L’homme de la montagne que j’avais tant aimée. Même l’équipée de Ruth à Woodstock manque de peps (un comble !) Il y a bien quelques passages émouvants, comme la relation passionnée de Ruth et de Ray, mais la flamme s’éteint assez vite. Reste un éclairage intéressant sur la vie de fermiers américains dans la seconde moitié du XXe siècle, et un personnage touchant, le père de Ruth.
« Le confident » d’Hélène Grémillon, Folio, 2012, 320 p.
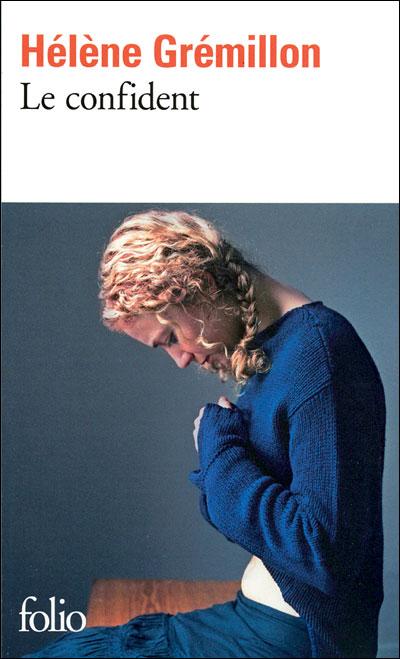
À la mort de sa mère en 1975, Camille Werner reçoit d’étranges lettres non signées qui lui narrent l’histoire d’une jeune fille passionnée nommée Annie, dont la jeunesse se déroule dans un petit village campagnard à la fin des années trente. À la faveur de l’installation d’un couple bourgeois dans le village, Annie se lie avec la jeune femme, Madame M., qui n’arrive pas à avoir d’enfant. Spontanément, Annie lui propose une solution aussi généreuse qu’insensée. Ceci va l’embarquer dans une aventure secrète qui se transforme en machination intime, dans le théâtre d’un Paris occupé par les Allemands, chaque acteur du drame se croyant piégé et cherchant à « avoir » l’autre. La deuxième partie du roman contient les « confidences » d’un des personnages principaux, confidences qui jettent une lumière autre, terrible, sur ce qui s’est noué dans ces années de guerre au sein de la famille Werner. Assez vite, Camille comprend qu’il y a un lien entre elle, cette Madame M. et cette Annie inconnues.
Cette lecture m’a bien divertie par son intrigue faite de faux-semblants et d’effets dominos, et les agissements parfois féroces de ses personnages féminins. Elle m’a fortement rappelé les romans labyrinthiques de Sébastien Japrisot, l’auteur d’Un long dimanche de fiançailles, de La femme dans l’auto avec des lunettes et un fusil et de Piège pour Cendrillon. Je vais d’ailleurs le citer parce que je trouve que cette citation s’applique bien au premier roman d’Hélène Grémillon et à son héroïne : « J’aime les personnages qui sont dépassés par les événements et qui, finalement, gagnent sur les événements. C’est d’autant plus intéressant quand c’est une héroïne, qu’on croit plus vulnérable, en tout cas plus fragile physiquement que les hommes, et qui est protégée par le lecteur qui a peur pour elle plus que pour un héros masculin. » (Citation trouvée sur la page Wikipédia de Sébastien Japrisot).
Je reconnais sinon que question style, profondeur historique et psychologique, on repassera, mais franchement, pour un premier roman, c’est pas mal.
Publicités
