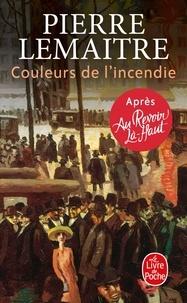 Quatre ans et des poussières après Au revoir là-haut, un Goncourt qui a séduit le public et colonisé
l’écran avec la complicité d’Albert Dupontel, Pierre Lemaitre a donné le deuxième
volet de ce qui sera une trilogie. Couleurs de l’incendie, réédité au Livre de poche, ausculte la France de 1927 à 1933 à travers l’histoire de
Madeleine Péricourt, déjà rencontrée dans le volume précédent.
Autant le dire d’emblée : on n’est pas déçu. Toutes les
bonnes raisons qui ont fait aimer Au
revoir là-haut en 2013 sont au rendez-vous d’un roman qui emporte autant
par la succession des événements que par la force des personnages et leurs
relations souvent conflictuelles. Les enjeux personnels et internationaux dans
un monde en voie de basculement se mêlent intimement, la trahison et la
vengeance sont des accélérateurs du récit plus efficaces que le projet, pas
encore au point, d’un moteur à réaction. Le livre frémit, bouillonne, fait
circuler vers la Suisse l’argent de la fraude fiscale, la morale n’est pas
toujours sauve. Mais, on l’avait vu dans Au
revoir là-haut, une bonne arnaque peut être un excellent ressort
romanesque…
Quatre ans et des poussières après Au revoir là-haut, un Goncourt qui a séduit le public et colonisé
l’écran avec la complicité d’Albert Dupontel, Pierre Lemaitre a donné le deuxième
volet de ce qui sera une trilogie. Couleurs de l’incendie, réédité au Livre de poche, ausculte la France de 1927 à 1933 à travers l’histoire de
Madeleine Péricourt, déjà rencontrée dans le volume précédent.
Autant le dire d’emblée : on n’est pas déçu. Toutes les
bonnes raisons qui ont fait aimer Au
revoir là-haut en 2013 sont au rendez-vous d’un roman qui emporte autant
par la succession des événements que par la force des personnages et leurs
relations souvent conflictuelles. Les enjeux personnels et internationaux dans
un monde en voie de basculement se mêlent intimement, la trahison et la
vengeance sont des accélérateurs du récit plus efficaces que le projet, pas
encore au point, d’un moteur à réaction. Le livre frémit, bouillonne, fait
circuler vers la Suisse l’argent de la fraude fiscale, la morale n’est pas
toujours sauve. Mais, on l’avait vu dans Au
revoir là-haut, une bonne arnaque peut être un excellent ressort
romanesque…Un enterrement ouvre le roman. Il s’y produit un épisode spectaculaire. Le lecteur a à peine eu le temps de s’acclimater au contexte qu’il est happé par celui-ci. On n’est pas près d’en sortir, car l’envie de connaître la suite, autant que celle de comprendre ce qui est arrivé au début, emporte pendant plus de 500 pages traversées avec allégresse. Rien n’est bâclé dans ce qui semble pourtant, à certains moments, lancé au petit bonheur la chance. Pierre Lemaitre est un méticuleux qui ne laisse rien au hasard, on le comprendra en lisant ses explications. « Couleurs de l’incendie » est le deuxième volet d’une trilogie. Saviez-vous, avant même d’écrire « Au revoir là-haut », que vous partiez pour trois livres ? Non, je l’ai su seulement quand j’ai commencé le deuxième volume. En 2012, quand j’ai terminé Au revoir là-haut, j’avais pris tellement de plaisir à goûter une liberté que je ne connaissais pas, puisque je sortais du roman policier, un genre dont les contraintes sont très lourdes, j’avais pris un tel plaisir que, en feuilletoniste un peu expérimenté, j’avais laissé une ouverture à la fin du roman. Au cas où j’aurais besoin d’emprunter un couloir, je voulais que la porte ne soit pas fermée. Donc, dès la fin d’Au revoir là-haut, j’avais l’idée qu’il était possible de faire une suite. Je n’en avais pas le projet, mais les personnages étaient prêts, les situations étaient prêtes, de manière à ce que, si d’aventure je me lançais là-dedans, la chose soit narrativement possible. Il s’est passé le Goncourt, j’ai publié Trois jours et une vie, et quand je me suis attaqué à la suite, je me suis demandé si j’allais faire Au revoir là-haut 2, Le fils d’au revoir là-haut, Le retour du fils d’au revoir là-haut, etc. Je me suis dit qu’il fallait être rigoureux dans cette histoire. Ce qui m’avait surtout intéressé, c’était l’entre-deux-guerres. J’avais fait les années 20, j’avais envie de faire les années 30, et j’ai pensé que le projet pouvait conduire aux années 40, pour couvrir en trois livres cette période qui va de la fin de la Première Guerre mondiale au début de la Seconde. Sur les trois époques, j’avais quelque chose à dire – de mineur, je ne suis pas historien – et j’avais aussi un bon sujet sur les années 40. L’idée de la trilogie correspond à un souci formel et permettait aussi de creuser le sillon, ouvert avec Au revoir là-haut, d’un pays à la recherche de lui-même et qui finit par sombrer dans l’anxiété la plus totale lors de l’exode de 1940. Sans anticiper, peut-on imaginer que, comme « Au revoir là-haut » s’ouvrait sur les derniers jours de la Première Guerre mondiale, le troisième volume se fermera sur les premiers jours de la Seconde ? Je pense que c’est ce qui va se passer. En fait, pas vraiment. Pour un romancier, la « drôle de guerre » n’est pas un événement très excitant : il ne se passe rien. Mais le vrai début de la guerre, c’est l’exode, qui est un événement extraordinaire. On a rarement vu dix ou quinze millions de personnes perdre les pédales, verser dans l’hallucination, être prises d’une panique collective. Et c’est effectivement pendant l’exode que va se terminer le troisième volume. Faire une suite, en soi, n’est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Je l’ai fait avec un de mes personnages récurrents qui s’appelle Camille Verhoeven, pour une série policière. Dans le roman noir, ça passe bien ? Oui, mais encore, il y a des limites : ce que j’appellerais le potentiel narratif d’un personnage. Un personnage porte, dans son ADN, un potentiel d’histoires. Et, une fois qu’il l’a épuisé, il se répète. On le voit beaucoup dans le roman policier où de nombreux confrères le font, parfois d’ailleurs avec beaucoup de talent, mais on n’apprend plus grand-chose, le personnage n’arrive plus à vous surprendre parce que, d’une certaine manière, il est épuisé. J’ai failli tomber dans cet écueil avec la trilogie Verhoeven. Par bonheur, je crois l’avoir évité et avoir fait sortir le personnage au moment où il était mûr pour sortir. Là, je m’y suis pris différemment. Pour un livre, je vais puiser un personnage secondaire dans le livre précédent. Le personnage secondaire a beaucoup d’intérêt : il n’est pas épuisé du tout, son capital n’a pas été dépensé et il arrive dans votre bouquin absolument intact, avec juste ce qu’il faut pour plaire au lecteur et à moi, il possède un passé, un passif, un certain nombre de caractéristiques. Prendre un personnage secondaire et l’élever à la dignité de personnage principal, c’est à peu près inépuisable. D’une certaine manière, le fil narratif s’entretient lui-même, dans une dynamique assez féconde, je trouve. Donc, au-delà de la trilogie, rien ne m’empêcherait de poursuivre sous une autre forme. Ce sera peut-être un livre, deux livres, je ne sais pas. Mais cette manière d’utiliser ainsi les personnages est assez prometteuse. Pour vous, qui est le personnage principal de « Couleurs de l’incendie » ? Pour le lecteur, c’est très clairement Madeleine Péricourt, pendant la plus grande partie du roman. Mais, vers la fin, son fils Paul occupe de plus en plus de place… Je pense vraiment que c’est Madeleine, je vais essayer de vous dire pourquoi. J’avais un premier chapitre où j’entrelaçais la destinée de Madeleine et celle de Paul. Je me suis rendu compte qu’il y avait maldonne parce que, dès le deuxième chapitre, on attendait plus de Paul que de Madeleine. Donc j’ai refait ce début à de multiples reprises de manière à ne faire apparaître, globalement, que Madeleine. Même si le petit Paul, par ce qui lui arrive, devient un personnage essentiel. Là où vous avez raison, c’est que, dans la deuxième partie et surtout vers la fin, Paul devient de plus en plus important parce que, au fond, c’est le projet de Madeleine : faire quelqu’un de son fils. C’est d’ailleurs pour nettoyer le terrain par la vengeance qu’elle se livre à toutes ses exactions – c’est un personnage qui fait des choses assez vilaines. Paul était plus problématique, parce que je me suis demandé si j’allais boucler son histoire ou non. Et je l’ai bouclée pour ne pas avoir la tentation de le reprendre. Si j’avais laissé une situation ouverte, ça me tendait les bras et ç’aurait été un piège, parce que c’était une facilité. Son histoire, telle qu’elle est, est bien à sa place. Mais, au-delà, ça devient du trucage. Vous semblez accorder une grande importance à la forme, notamment dans la construction du roman qui, pour celui-ci, commence et, à peu de choses près, se termine par un enterrement. C’est le cas ? Oui. Il y a une chute à la fin d’Au revoir là-haut, Couleurs de l’incendie commence par une chute… C’est pour moi très important. Je pense que le lecteur qui lit seulement pour son plaisir perçoit la forme. Je ne sais pas s’il en a conscience. Mais la forme, c’est le fond qui remonte à la surface. Je pense que la solidité et l’élégance ou la puissance de la forme sont perçues confusément. Moi, j’en ai besoin parce qu’elle me tient debout, elle tient mon récit debout. La forme est le berceau de l’intrigue et je trouve que ce bébé pousse bien, donc j’en prends grand soin. Il y a l’architecture globale, mais aussi la forme dans le détail. Avez-vous conscience de faire un usage assez singulier, et très intéressant, de la virgule ? Je ne sais pas si c’est personnel. En littérature, je crois que je suis un peu postmoderne. C’était déjà présent dans Au revoir là-haut, mais pas autant. C’est quelque chose que j’ai beaucoup travaillé et qui vient un peu d’Aragon, notamment d’une lecture qui a été importante pour moi, Les voyageurs de l’impériale. Il y a chez lui quelque chose que j’ai toujours envié : une manière d’empoigner la littérature, de faire preuve d’une liberté de ton, d’une liberté narrative qui a peu d’équivalent, sauf peut-être au XVIIIe siècle. A l’intérieur d’une phrase, il peut faire circuler le point de vue d’un personnage à l’autre, il peut quasiment passer d’un siècle à l’autre sans que vous voyiez la couture. Il y a une extraordinaire fluidité qui est une facilité d’écriture époustouflante. Cela, je l’entremêle avec une autre leçon littéraire qui vient plutôt de Diderot, de Jacques le Fataliste, et du goût qu’il a pour le contrat implicite passé avec le lecteur. Diderot dit : je vais te raconter une histoire, je vais te prendre la main, de temps en temps ce sera très chaotique mais ne t’inquiète pas, on va y arriver. C’est ce qui lui permet de quitter son personnage, d’y revenir, de s’adresser au lecteur, tout cela avec une fluidité qu’on retrouve chez Aragon. En tant que lecteur, ça m’avait beaucoup plus et j’avais commencé à le travailler dans Au revoir là-haut. J’ai poursuivi ici sous une forme qui n’est peut-être pas personnelle mais qui traduit un souci personnel : cette idée de donner au lecteur l’illusion qu’on lui raconte l’histoire à voix haute. Cette illusion consiste à avoir un langage très écrit mais, à l’intérieur du langage écrit, de parsemer un certain nombre de signes qui appartiennent plutôt au registre de l’oral. Le but est de donner au lecteur le sentiment qu’on lui raconte l’histoire plutôt comme un conteur que comme un romancier. C’est notamment l’usage de la ponctuation qui le permet – je reviens à la question sur la virgule. En lisant, cela paraît simple, mais en réalité, c’est assez compliqué. Vous avez tout cela à l’esprit en écrivant ? Oui, totalement. Il y a deux moments. Il y a le moment où j’écris pour faire passer l’émotion de la scène, celle du personnage, j’essaie de traduire le mieux possible ce qui se passe. Une fois que c’est posé, il y a la question de savoir si c’est efficace, c’est-à-dire si le lecteur va bien ressentir l’émotion que j’ai voulu faire passer, et pas une autre. Si je veux qu’il soit scandalisé, je me demande si le personnage est assez scandaleux, si la situation est assez scandaleuse. Pareil pour les autres émotions, qu’elles soient positives ou négatives. C’est la question du style, de la voix, de la rythmique, de la musique… Vos premiers romans étaient des polars, une littérature de genre. Vous parlez de votre trilogie en cours comme d’un feuilleton et vous rendez hommage à votre « maître Dumas ». Ça ne vous dérange pas ? Non, pas du tout. Je ne crois pas aux genres mineurs. Je pense qu’il y a la littérature et, à l’intérieur de la littérature, il y a des genres. Les appellent mineurs ceux qui ont le sentiment que certains genres sont trop prosaïques… Ou trop populaires ? Oui, voilà, vous avez prononcé le gros mot. Quand on parle de littérature mineure ou de littérature populaire, on n’est pas dans le camp dans lequel j’essaie de m’insérer. Il y a, c’est vrai, des livres mineurs, qui sont plus représentés dans les genres que l’on dit mineurs. Dans le feuilleton, le roman policier, le roman populaire, le roman sentimental, voire dans le roman historique, il y a plus de déchets que de bons grains. Mais, au nom du fait qu’il y a plus de mauvais livres ou de livres moyens, parfois médiocres, dans un genre, le genre n’est pas pour autant frappé d’indignité. On trouve, dans ces genres-là, des livres majeurs. Il y a aussi des livres qui correspondent à des recettes et qui ne survivront pas à eux-mêmes. Mais, pour moi, la littérature populaire, c’est autre chose. Un genre populaire est un genre fédérateur pour plaire à des lectorats différents mais pas pour les mêmes raisons. Dans Couleurs de l’incendie, les lecteurs peuvent s’amuser, par exemple, de savoir que la scène où Charles Péricourt discute le soir avec un de ses députés est en fait décalquée d’une situation où, chez Proust, le duc de Guermantes réagit face à Swann qui vient lui annoncer qu’il va mourir. J’ai fait quasiment une parodie de cette scène mais quelqu’un qui n’a pas lu Proust peut apprécier la scène pour ce qu’elle vaut narrativement et émotionnellement. Un adolescent peut lire Couleurs de l’incendie comme il lirait Monte-Cristo, un autre lecteur peut trouver un autre intérêt au fond social, ou au fond politique, ou à ces jeux avec la littérature puisqu’il y a du Zola, du Balzac, du Proust, un peu de tout. C’est un petit patchwork, une salutation à la littérature dans laquelle les lecteurs plus experts dans ce domaine peuvent trouver du plaisir. La littérature populaire, pour moi, est celle qui est lisible sans qu’aucun lectorat n’exclue l’autre. Même un lecteur de journaux trouvera des échos de son univers contemporain dans une histoire d’évasion fiscale… Ce sont des clins d’œil à l’Histoire et ça peut amuser un lecteur qui n’a pas d’autre intérêt que de croiser des choses qu’il connaît déjà. Presque tous vos personnages sont ambigus, ni tout à fait mauvais, ni tout à fait bons. Seul Paul semble être un modèle de pureté. Le voyez-vous ainsi ? Ce qui touche chez Paul, c’est que c’est un enfant qui est en permanent décalage. La sexualité à l’adolescence, il va la connaître avec un effet décalé. Lorsque monsieur Dupré lui rend le service de le mettre en galante compagnie, il est presque anticipateur. C’est aussi parce que Paul est un enfant qui a un problème d’expression, et même l’expression de sa sexualité ne se fait pas. Monsieur Dupré le pressent avec beaucoup d’intelligence : quelque chose existe mais ne s’exprime pas. C’est le fond du caractère de Paul, l’incapacité d’exprimer les choses qui va peut-être le sauver puisque, pendant la guerre, même passé à la question, il ne parlera pas. C’est un personnage un peu idéal, vous avez raison, l’image de la pureté. Mais il possède aussi ses propres contradictions. Il est toujours dans l’expression de quelqu’un d’autre ou d’autre chose. Le fait qu’il fasse de la publicité montre bien qu’il va être un intermédiaire entre un produit et un client. Lui-même ne sait pas très bien s’il s’exprime à la place de l’un ou à la place de l’autre, il reste toujours dans l’entre-deux. Donc, il possède son ambigüité, mais elle n’est pas morale. Vous aimez les grandes scènes. Les deux enterrements sont dans ce registre. La plus marquante est peut-être le dernier récital de Solange Gallinato, un pied-de-nez au nazisme en présence d’Hitler lui-même… C’est une scène de genre – vous l’avez rappelé, je suis un écrivain de genres. Quand vous êtes romancier et que vous avez une situation comme celle-là, vous ne pouvez pas résister, il y a un plaisir… C’est un plaisir de lecteur, d’abord, c’est le souvenir que j’ai de ces morceaux de bravoure dans les grands romans, par exemple chez Dumas, il en fait des paquets énormes. C’est le plaisir que j’ai, en littérature, de trouver ces grandes scènes. Et, quand l’intrigue me le permet, le grand plaisir du romancier est d’articuler ces scènes. Il y en avait quelques-unes dans Au revoir là-haut, notamment une que j’avais empruntée d’Aragon. Elle se passait dans un centre de démobilisation en 1920, une espèce d’immense gare avec des milliers de types qui attendaient des trains qui n’arrivaient pas. C’était assez court, j’avais trois ou quatre pages qui m’avaient demandé un mois de travail, je crois, c’était colossal mais j’étais assez content du résultat. Une fois qu’elles sont allégées, qu’elles sont bien à leur place, qu’elles sont épurées, que le curseur est placé au bon endroit, ces scènes-là sont posées. La mort de Solange est aussi une scène de genre, très classique : le voyage en train, la mort pendant ce voyage, la réminiscence… Ce sont des choses qu’on trouve quasiment dans tous les romans, sous une forme ou sous une autre. C’est très amusant à faire, c’est très amusant de jouer avec les codes. Encore une fois, mon travail est une permanente salutation à la littérature. Après Albert Dupontel pour l’adaptation d’« Au revoir là-haut », qui verriez-vous volontiers réaliser le deuxième volet ?
Je ne sais pas, parce que je ne sais pas de quel côté il faudrait faire glisser l’adaptation. Est-ce qu’il faut la faire glisser du côté de l’aventure ? Plutôt du côté politique ? Ou lyrique ? Est-ce qu’il faut en faire un geste militant, par exemple sur la liberté des femmes qui est une grande question posée par le livre ? En fonction de ça, on n’aurait pas le même metteur en scène. Si le livre intéresse des metteurs en scène, je serais curieux du point de vue qu’ils aimeraient donner. C’est à ce moment-là que je pourrais vous dire : ce réalisateur est à sa place dans ce projet. Le livre est assez polymorphe pour permettre plusieurs types d’adaptations. Vous voyez, James Ivory, par exemple, ferait de ce livre un film formidable. Jean-Pierre Jeunet pourrait faire un film formidable. Jérôme Salle ferait un film épatant d’une histoire comme ça. Coppola ou Scorsese pourraient faire un film formidable… La chance de ce livre, c’est, me semble-t-il, de permettre plusieurs voies. Le cinéma décidera peut-être d’en emprunter une…
