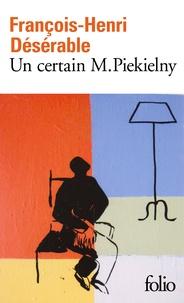 Le troisième roman de François-Henri Désérable est une
succession de moments jubilatoires et la magnifique réussite d’un projet qui
aurait pu mener l’écrivain à l’échec. Après deux fictions situées dans un passé
plus lointain, il aborde avec Un certain M. Piekielny les rives glissantes de l’autofiction. Il y est lui-même au
premier plan, avec quelques souvenirs qu’on rapproche volontiers de sa
biographie – il ne dément pas. Avec, aussi et surtout, une quête jusqu’à
l’absurde d’un personnage cité par Romain Gary dans La promesse de l’aube, un certain M. Piekielny au fond très
incertain…
Désérable fut un joueur de hockey sur glace. Il continue à
glisser et à se faufiler entre les hypothèses les plus diverses considérées
comme des adversaires à contourner. Les figures audacieuses réalisées avec brio
dans ses phrases valent bien celles qu’il effectuait à la patinoire. Mais,
comme lui, on ne va pas « tarasboulber
l’intrigue ». Plutôt l’écouter en parler.
C’est, comme le
raconte le roman, à Vilnius que vous avez eu l’idée de partir sur la piste de
Piekielny ?
J’avais lu son nom
dans La promesse de l’aube et le
passage m’avait marqué. Je me suis vraiment retrouvé à Vilnius par hasard, je
me suis vraiment fait voler mon portefeuille, je me suis vraiment promené dans
les rues, et je suis tombé sur une plaque commémorative qui m’a fait penser à
ce Piekielny dont je ne savais rien. Je n’ai pas tout de suite décidé d’écrire
un livre sur lui mais, plus j’y pensais, plus j’avais envie de savoir qui il
était.
Donc, vous avez mené
l’enquête…
Oui, je suis allé
plusieurs fois à Vilnius. Mais, en réalité, plus rapidement que je ne le dis
dans le livre, je me suis rendu compte qu’il y avait un truc qui clochait.
C’était un peu bizarre, que je ne trouve aucune trace de lui. Et puis, un jour,
j’ai vu Le Révizor de Gogol.
L’enquête est le
support réel dont vous aviez besoin ?
J’ai assez peu
d’imagination, en fait. Mon premier livre, Tu montreras ma tête au peuple, c’étaient pour la plupart des histoires
vraies. Evariste est un personnage
qui a existé. Et, là, c’est un personnage fictif mais j’avais besoin de
m’adosser à quelque chose. Je ne veux pas aller vers la non-fiction mais la
frontière poreuse entre le réel et la fiction m’intéresse.
On vous pensait parti
pour des romans situés dans le passé. Ici, vous basculez…
Oui, je n’ai jamais
voulu m’enfermer dans le genre du roman historique. Je ne suis d’ailleurs pas
un grand lecteur de romans historiques, et je trouve que c’est une distinction
qui n’a pas lieu d’être. Il y a des livres qui sont de la littérature et ceux
qui n’en sont pas, des livres où la langue n’est qu’un simple moyen de raconter
une histoire et ceux où la langue est une fin. C’est la seule distinction qui
devrait valoir et je suis toujours malheureux lorsque je vois, dans des
librairies, que mes deux premiers livres sont sur la table des romans
historiques. D’ailleurs, dans Evariste,
je tenais à un narrateur contemporain. Ici, j’essaie de jouer avec les époques,
à Vilnius dans les années 30, avec Gary à Londres, et l’enquête qui est
d’aujourd’hui.
On rit souvent en
vous lisant. L’effet est recherché ?
Disons que je le
cherche, oui. Il y a une tendance que je ne m’explique pas dans la littérature
contemporaine, c’est un goût pour le tragique, le plombant… La plupart des livres
où il n’y a pas d’humour m’ennuient. C’est donc très conscient de ma part. J’ai
décidé d’écrire après la lecture de Belle du Seigneur et c’est pour moi le livre le plus drôle de la littérature
francophone.
Vous avez cette
phrase, à la fin du roman : « Ecrire. Tenir le monde en vingt-six
lettres et le faire ployer sous sa loi. » C’est votre ambition ?
C’est très
présomptueux de dire ça. Lorsqu’on écrit, on est une sorte de démiurge devant
sa page ou son ordinateur. On peut, de quelques phrases, faire jaillir tout un
monde et c’est une liberté absolue, un champ des possibles infini. Mais la
difficulté est de transcender tout ça par le style.
Le troisième roman de François-Henri Désérable est une
succession de moments jubilatoires et la magnifique réussite d’un projet qui
aurait pu mener l’écrivain à l’échec. Après deux fictions situées dans un passé
plus lointain, il aborde avec Un certain M. Piekielny les rives glissantes de l’autofiction. Il y est lui-même au
premier plan, avec quelques souvenirs qu’on rapproche volontiers de sa
biographie – il ne dément pas. Avec, aussi et surtout, une quête jusqu’à
l’absurde d’un personnage cité par Romain Gary dans La promesse de l’aube, un certain M. Piekielny au fond très
incertain…
Désérable fut un joueur de hockey sur glace. Il continue à
glisser et à se faufiler entre les hypothèses les plus diverses considérées
comme des adversaires à contourner. Les figures audacieuses réalisées avec brio
dans ses phrases valent bien celles qu’il effectuait à la patinoire. Mais,
comme lui, on ne va pas « tarasboulber
l’intrigue ». Plutôt l’écouter en parler.
C’est, comme le
raconte le roman, à Vilnius que vous avez eu l’idée de partir sur la piste de
Piekielny ?
J’avais lu son nom
dans La promesse de l’aube et le
passage m’avait marqué. Je me suis vraiment retrouvé à Vilnius par hasard, je
me suis vraiment fait voler mon portefeuille, je me suis vraiment promené dans
les rues, et je suis tombé sur une plaque commémorative qui m’a fait penser à
ce Piekielny dont je ne savais rien. Je n’ai pas tout de suite décidé d’écrire
un livre sur lui mais, plus j’y pensais, plus j’avais envie de savoir qui il
était.
Donc, vous avez mené
l’enquête…
Oui, je suis allé
plusieurs fois à Vilnius. Mais, en réalité, plus rapidement que je ne le dis
dans le livre, je me suis rendu compte qu’il y avait un truc qui clochait.
C’était un peu bizarre, que je ne trouve aucune trace de lui. Et puis, un jour,
j’ai vu Le Révizor de Gogol.
L’enquête est le
support réel dont vous aviez besoin ?
J’ai assez peu
d’imagination, en fait. Mon premier livre, Tu montreras ma tête au peuple, c’étaient pour la plupart des histoires
vraies. Evariste est un personnage
qui a existé. Et, là, c’est un personnage fictif mais j’avais besoin de
m’adosser à quelque chose. Je ne veux pas aller vers la non-fiction mais la
frontière poreuse entre le réel et la fiction m’intéresse.
On vous pensait parti
pour des romans situés dans le passé. Ici, vous basculez…
Oui, je n’ai jamais
voulu m’enfermer dans le genre du roman historique. Je ne suis d’ailleurs pas
un grand lecteur de romans historiques, et je trouve que c’est une distinction
qui n’a pas lieu d’être. Il y a des livres qui sont de la littérature et ceux
qui n’en sont pas, des livres où la langue n’est qu’un simple moyen de raconter
une histoire et ceux où la langue est une fin. C’est la seule distinction qui
devrait valoir et je suis toujours malheureux lorsque je vois, dans des
librairies, que mes deux premiers livres sont sur la table des romans
historiques. D’ailleurs, dans Evariste,
je tenais à un narrateur contemporain. Ici, j’essaie de jouer avec les époques,
à Vilnius dans les années 30, avec Gary à Londres, et l’enquête qui est
d’aujourd’hui.
On rit souvent en
vous lisant. L’effet est recherché ?
Disons que je le
cherche, oui. Il y a une tendance que je ne m’explique pas dans la littérature
contemporaine, c’est un goût pour le tragique, le plombant… La plupart des livres
où il n’y a pas d’humour m’ennuient. C’est donc très conscient de ma part. J’ai
décidé d’écrire après la lecture de Belle du Seigneur et c’est pour moi le livre le plus drôle de la littérature
francophone.
Vous avez cette
phrase, à la fin du roman : « Ecrire. Tenir le monde en vingt-six
lettres et le faire ployer sous sa loi. » C’est votre ambition ?
C’est très
présomptueux de dire ça. Lorsqu’on écrit, on est une sorte de démiurge devant
sa page ou son ordinateur. On peut, de quelques phrases, faire jaillir tout un
monde et c’est une liberté absolue, un champ des possibles infini. Mais la
difficulté est de transcender tout ça par le style.
Magazine Culture
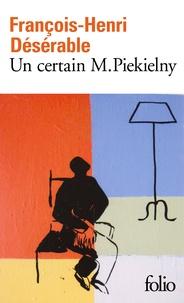 Le troisième roman de François-Henri Désérable est une
succession de moments jubilatoires et la magnifique réussite d’un projet qui
aurait pu mener l’écrivain à l’échec. Après deux fictions situées dans un passé
plus lointain, il aborde avec Un certain M. Piekielny les rives glissantes de l’autofiction. Il y est lui-même au
premier plan, avec quelques souvenirs qu’on rapproche volontiers de sa
biographie – il ne dément pas. Avec, aussi et surtout, une quête jusqu’à
l’absurde d’un personnage cité par Romain Gary dans La promesse de l’aube, un certain M. Piekielny au fond très
incertain…
Désérable fut un joueur de hockey sur glace. Il continue à
glisser et à se faufiler entre les hypothèses les plus diverses considérées
comme des adversaires à contourner. Les figures audacieuses réalisées avec brio
dans ses phrases valent bien celles qu’il effectuait à la patinoire. Mais,
comme lui, on ne va pas « tarasboulber
l’intrigue ». Plutôt l’écouter en parler.
C’est, comme le
raconte le roman, à Vilnius que vous avez eu l’idée de partir sur la piste de
Piekielny ?
J’avais lu son nom
dans La promesse de l’aube et le
passage m’avait marqué. Je me suis vraiment retrouvé à Vilnius par hasard, je
me suis vraiment fait voler mon portefeuille, je me suis vraiment promené dans
les rues, et je suis tombé sur une plaque commémorative qui m’a fait penser à
ce Piekielny dont je ne savais rien. Je n’ai pas tout de suite décidé d’écrire
un livre sur lui mais, plus j’y pensais, plus j’avais envie de savoir qui il
était.
Donc, vous avez mené
l’enquête…
Oui, je suis allé
plusieurs fois à Vilnius. Mais, en réalité, plus rapidement que je ne le dis
dans le livre, je me suis rendu compte qu’il y avait un truc qui clochait.
C’était un peu bizarre, que je ne trouve aucune trace de lui. Et puis, un jour,
j’ai vu Le Révizor de Gogol.
L’enquête est le
support réel dont vous aviez besoin ?
J’ai assez peu
d’imagination, en fait. Mon premier livre, Tu montreras ma tête au peuple, c’étaient pour la plupart des histoires
vraies. Evariste est un personnage
qui a existé. Et, là, c’est un personnage fictif mais j’avais besoin de
m’adosser à quelque chose. Je ne veux pas aller vers la non-fiction mais la
frontière poreuse entre le réel et la fiction m’intéresse.
On vous pensait parti
pour des romans situés dans le passé. Ici, vous basculez…
Oui, je n’ai jamais
voulu m’enfermer dans le genre du roman historique. Je ne suis d’ailleurs pas
un grand lecteur de romans historiques, et je trouve que c’est une distinction
qui n’a pas lieu d’être. Il y a des livres qui sont de la littérature et ceux
qui n’en sont pas, des livres où la langue n’est qu’un simple moyen de raconter
une histoire et ceux où la langue est une fin. C’est la seule distinction qui
devrait valoir et je suis toujours malheureux lorsque je vois, dans des
librairies, que mes deux premiers livres sont sur la table des romans
historiques. D’ailleurs, dans Evariste,
je tenais à un narrateur contemporain. Ici, j’essaie de jouer avec les époques,
à Vilnius dans les années 30, avec Gary à Londres, et l’enquête qui est
d’aujourd’hui.
On rit souvent en
vous lisant. L’effet est recherché ?
Disons que je le
cherche, oui. Il y a une tendance que je ne m’explique pas dans la littérature
contemporaine, c’est un goût pour le tragique, le plombant… La plupart des livres
où il n’y a pas d’humour m’ennuient. C’est donc très conscient de ma part. J’ai
décidé d’écrire après la lecture de Belle du Seigneur et c’est pour moi le livre le plus drôle de la littérature
francophone.
Vous avez cette
phrase, à la fin du roman : « Ecrire. Tenir le monde en vingt-six
lettres et le faire ployer sous sa loi. » C’est votre ambition ?
C’est très
présomptueux de dire ça. Lorsqu’on écrit, on est une sorte de démiurge devant
sa page ou son ordinateur. On peut, de quelques phrases, faire jaillir tout un
monde et c’est une liberté absolue, un champ des possibles infini. Mais la
difficulté est de transcender tout ça par le style.
Le troisième roman de François-Henri Désérable est une
succession de moments jubilatoires et la magnifique réussite d’un projet qui
aurait pu mener l’écrivain à l’échec. Après deux fictions situées dans un passé
plus lointain, il aborde avec Un certain M. Piekielny les rives glissantes de l’autofiction. Il y est lui-même au
premier plan, avec quelques souvenirs qu’on rapproche volontiers de sa
biographie – il ne dément pas. Avec, aussi et surtout, une quête jusqu’à
l’absurde d’un personnage cité par Romain Gary dans La promesse de l’aube, un certain M. Piekielny au fond très
incertain…
Désérable fut un joueur de hockey sur glace. Il continue à
glisser et à se faufiler entre les hypothèses les plus diverses considérées
comme des adversaires à contourner. Les figures audacieuses réalisées avec brio
dans ses phrases valent bien celles qu’il effectuait à la patinoire. Mais,
comme lui, on ne va pas « tarasboulber
l’intrigue ». Plutôt l’écouter en parler.
C’est, comme le
raconte le roman, à Vilnius que vous avez eu l’idée de partir sur la piste de
Piekielny ?
J’avais lu son nom
dans La promesse de l’aube et le
passage m’avait marqué. Je me suis vraiment retrouvé à Vilnius par hasard, je
me suis vraiment fait voler mon portefeuille, je me suis vraiment promené dans
les rues, et je suis tombé sur une plaque commémorative qui m’a fait penser à
ce Piekielny dont je ne savais rien. Je n’ai pas tout de suite décidé d’écrire
un livre sur lui mais, plus j’y pensais, plus j’avais envie de savoir qui il
était.
Donc, vous avez mené
l’enquête…
Oui, je suis allé
plusieurs fois à Vilnius. Mais, en réalité, plus rapidement que je ne le dis
dans le livre, je me suis rendu compte qu’il y avait un truc qui clochait.
C’était un peu bizarre, que je ne trouve aucune trace de lui. Et puis, un jour,
j’ai vu Le Révizor de Gogol.
L’enquête est le
support réel dont vous aviez besoin ?
J’ai assez peu
d’imagination, en fait. Mon premier livre, Tu montreras ma tête au peuple, c’étaient pour la plupart des histoires
vraies. Evariste est un personnage
qui a existé. Et, là, c’est un personnage fictif mais j’avais besoin de
m’adosser à quelque chose. Je ne veux pas aller vers la non-fiction mais la
frontière poreuse entre le réel et la fiction m’intéresse.
On vous pensait parti
pour des romans situés dans le passé. Ici, vous basculez…
Oui, je n’ai jamais
voulu m’enfermer dans le genre du roman historique. Je ne suis d’ailleurs pas
un grand lecteur de romans historiques, et je trouve que c’est une distinction
qui n’a pas lieu d’être. Il y a des livres qui sont de la littérature et ceux
qui n’en sont pas, des livres où la langue n’est qu’un simple moyen de raconter
une histoire et ceux où la langue est une fin. C’est la seule distinction qui
devrait valoir et je suis toujours malheureux lorsque je vois, dans des
librairies, que mes deux premiers livres sont sur la table des romans
historiques. D’ailleurs, dans Evariste,
je tenais à un narrateur contemporain. Ici, j’essaie de jouer avec les époques,
à Vilnius dans les années 30, avec Gary à Londres, et l’enquête qui est
d’aujourd’hui.
On rit souvent en
vous lisant. L’effet est recherché ?
Disons que je le
cherche, oui. Il y a une tendance que je ne m’explique pas dans la littérature
contemporaine, c’est un goût pour le tragique, le plombant… La plupart des livres
où il n’y a pas d’humour m’ennuient. C’est donc très conscient de ma part. J’ai
décidé d’écrire après la lecture de Belle du Seigneur et c’est pour moi le livre le plus drôle de la littérature
francophone.
Vous avez cette
phrase, à la fin du roman : « Ecrire. Tenir le monde en vingt-six
lettres et le faire ployer sous sa loi. » C’est votre ambition ?
C’est très
présomptueux de dire ça. Lorsqu’on écrit, on est une sorte de démiurge devant
sa page ou son ordinateur. On peut, de quelques phrases, faire jaillir tout un
monde et c’est une liberté absolue, un champ des possibles infini. Mais la
difficulté est de transcender tout ça par le style.
