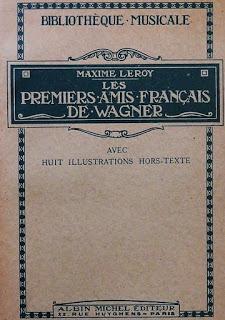 Le Journal des débats politiques et littéraires du 1er août 1926 publie dans sa Revue musicale un article d'Adolphe Jullien intitulé " Les premiers amis français de Richard Wagner " qui rend compte de la publication du livre éponyme que publia Maxime Leroy, le fils du journaliste wagnérien Léon Leroy, chez Albin Michel (1925).
Le Journal des débats politiques et littéraires du 1er août 1926 publie dans sa Revue musicale un article d'Adolphe Jullien intitulé " Les premiers amis français de Richard Wagner " qui rend compte de la publication du livre éponyme que publia Maxime Leroy, le fils du journaliste wagnérien Léon Leroy, chez Albin Michel (1925).
REVUE MUSICALE
Les premiers amis français de Richard Wagner
En 1869, lorsque Pasdeloup, voulant poursuivre au théâtre la campagne qu'il menait ardemment dans ses concerts au profit de Wagner, se fut fait attribuer le privilège du Théâtre Lyrique, à la place du Châtelet, il voulut que tout le monde autour de lui, qui s'apprêtait à représenter Rienzi, fût imprégné de l'idée wagnérienne. Il choisit donc comme secrétaire un journaliste, qui avait été un des tout premiers partisans de Wagner en France, dix ans plus tôt, qui n'avait cessé depuis lors de suivre, où qu'il se manifestât, le mouvement wagnérien, et qui, jusqu'à la fin, aida de tout son pouvoir à la diffusion de la musique de Wagner, payant même de sa personne à ces réunions si curieuses, si attachantes, qu'organisait alors le wagnériste passionné Antoine Lascoux et que ceux qui étaient admis à les suivre avaient plaisamment dénommées : le Petit Bayreuth. Il s'appelait Léon Leroy.
Quel bon souvenir pour moi, soit dit en passant, que celui de cette première représentation de Rienzi, où, flânant devant le théâtre, à l'affût de quelque aubaine inattendue, je parvins à m'y glisser je ne sais plus trop comment, et à m'installer au fond du parterre, qui ne contenait guère que cinquante mauvaises places! Avec quelle joie ne vis-je pas le vibrant Pasdeloup paraître à la tête de l'orchestre et conduire, avec la même fougue qui nous entraînait aux Concerts Populaires, cette ouverture de Rienzi à laquelle il aurait été bien difficile, dès cette époque, de faire opposition, car, si elle n'eût été signée de Wagner, elle n'aurait dû nullement heurter les préférences accoutumées du public Quel succès remportèrent, au milieu d'un auditoire pourtant assez mal disposé en général, les délicieux airs du Messager de paix où brillait la voix si pure de Mlle Priola, alors à ses débuts, et qui, après avoir passé par l'Opéra-Comique, devait aller mourir bien tristement à Marseille. Quel écho fit résonner dans toute la salle l'enthousiaste appel aux armes : Santo Spirito, cavaliere, auquel l'organe claironnant du ténor Monjauze prêtait, comme a tout le rôle du tribun du reste, un éclat extraordinaire ! Avec quelle sûreté le mezzo-soprano bien timbré de Mlle Borghèse, l'ancienne créatrice de la Rose Friquet des Dragons de Villars, se faisait entendre dans le personnage d'Adrian o; quels solides appuis donnaient à d'autres rôles des artistes de qualité nouveaux venus, tels que le baryton Lutz, la basse Giraudet, le soprano dramatique Mlle Stemberg, qui n'était pas encore Mme Vaucorbeil, etc. ; de quelle ardeur Pasdeloup savait animer chanteurs et instrumentistes enfin, quel spectacle attachant fut d'ensemble cette représentation d'une œuvre aux trois quarts italienne que les uns exaltaient comme les autres la décriaient, de confiance, en raison du seul nom de l'auteur, et qui aurait dû, en bonne justice, rencontrer alors un accueil unanimement favorable ! Et cependant...
Léon Leroy, pour revenir à lui, avait, toute sa vie durant, réuni articles, papiers, correspondances, annoté maintes publications ayant trait au musicien qu'il admirait et même aimait du fond du cœur, malgré des refroidissements passagers, provenant surtout de l'humeur capricieuse et passablement égoïste de Wagner, et c'est de tous ces documents, contrôlés par d'autres, que le fils de Léon Leroy, M. Maxime Leroy, vient de tirer la matière d'un beau volume intitulé Les Premiers amis français de Wagner (chez AIbin Michel). Ce livre repose sur une idée très juste qui est, en fixant les débuts de la conquête de la France par Wagner, de réagir contre la tendance qu'on a à résumer dans un seul nom, celui de Baudelaire, l'effort et la gloire du wagnérisme naissant, alors que ce ne fut pas un homme seul, mais tout un milieu littéraire et artistique, qui accueillit Wagner avec enthousiasme, comme s'il l'eût attendu et se fût reconnu tout de suite en lui. Tout ne se réduit donc pas, en 1859 et 60, dit fort bien notre auteur, à un dialogue sublime entre Wagner et Baudelaire couronné par le magnifique article de celui-ci, inséré dans la Revue européenne au lendemain de Tannhaeuser, et on ne rendra à cet événement historique toute sa signification, avec ses dimensions vraies, qu'en réagissant contre cette simplification excessive et en faisant revivre, autour de la figure centrale du poète, celles des autres amis du grand musicien, dont les tout premiers, la plume à la main, furent le docteur Auguste de Gasperini et le journaliste Léon Leroy.
Qu'est-ce qu'écrivait fiévreusement Gasperini à M. Léon Leroy, de Marseille, en septembre 1859 ? " Vite, vite, une grande nouvelle ! En recevant ceci, laissez là tout ce que vous avez à faire et courez avenue Matignon, n° 4. Vous demanderez au concierge si Richard Wagner est chez lui et vous monterez. Il est à Paris pour quelque temps ; c'est vous que je charge de me représenter auprès du grand homme. A bientôt ! Laissez là cette lettre et courez ! L'auteur de l'ouverture de Tannhaeuser ! Ouvrez toutes les portes ! " Leroy n'y courut pas aussi vite que l'eût souhaité Gasperini, mais, enfin, il lui rendit compte de sa visite avenue Matignon : " Je vous dirai donc que j'ai trouvé, dans un appartement fortement doré, un homme doux et affable, vêtu d'une longue robe de chambre en velours vert foncé et doublée de satin violet (ne retrouvait-on pas, dès lors, en ces jours de médiocre fortune, le grand goût de Wagner pour les étoffes luxueuses et de couleurs très voyantes?). Wagner m'a parlé de son voyage en France et des motifs qui l'ont décidé à l'entreprendre. C'est ici, cher ami, que j'ai à vous apprendre une nouvelle qui va , j'espère, vous faire bondir de joie : Wagner se fixe à Paris !!! et pour trois ans au moins !!! "
Ce que furent, pour le grand musicien, ces trois années dont il espérait profit et gloire et qui commencèrent par les concerts tellement discutés du Théâtre Italien pour aboutir à la déroute de Tannhaeuser à l'Opéra, tout le monde, aujourd'hui, le sait et peut le déplorer, mais, ce qu'on ne saurait trop souligner, c'est de quelle élite intellectuelle et artistique le musicien novateur était dès lors entouré. Tous les mercredis, dans le quartier alors presque suburbain de l'Arc-de-Triomphe, il voyait arriver chez lui Emile Ollivier, qui venait d'épouser à Florence, en 1857, la fille aînée de Liszt et de Mme d'Agoult, Blandine, une jeune femme charmante et profondément artiste, ravie par la mort cinq ans après son mariage ; Frédéric Villot, conservateur des musées impériaux, auquel Wagner a dédié ses quatre poèmes d'opéras traduits en français ; Edmond Roche, qui lui avait fait une si flatteuse réception à la douane française ; Hector Berlioz, en souvenir de leurs relations en Allemagne, puis à Londres, et dont la violente hostilité allait bientôt se déchaîner ; Emile Perrin, alors directeur inoccupé, n'ayant plus l'Opéra-Comique et n'ayant pas encore l'Opéra ; Carvalho, directeur du Théâtre Lyrique (non pas de l'Opéra-Comique) et très porté vers les œuvres nouvelles ; un dessinateur et un avocat, de vingt-sept ans tous les deux : Gustave Doré, dans le plein de sa vogue, et Jules Ferry, amené là par Emile Ollivier; puis force écrivains : Baudelaire, Champfleury, Charles de Lorbac, les deux fidèles Léon Leroy et Gasperini, qui firent tous énormément pour la réputation de leur hôte en forçant l'attention du public, surpris par leurs cris de guerre et leurs articles enflammés.
Et M. Maxime Leroy, sans les nommer tous, fait très justement observer que, pour ces fervents adeptes de Wagner, que les oeuvres couramment entendues jusque là ne préparaient guère cependant à pareille secousse, ce fut comme une révélation presque surhumaine dont eux-mêmes se rendirent bien compte et qu'ils eurent la bonne foi de proclamer. C'est Gasperini qui reçoit le coup de foudre en entendant un fragment de Lohengrin aux Concerts de Bade, en 1857 ; c'est Leroy qui le ressent après une exécution de l'ouverture de Tannhaeuser aux Concerts Ste-Cécile, à Paris; c'est M. Edouard Schuré à l'audition de Tristan et Iseult ; Mme Judith Gautier, rien qu'en lisant au piano Le Vaisseau fantôme ; Baudelaire, aux Concerts du Théâtre Italien ; Reyer, en entendant Tannhaeuser à Bade, dès 1857 ; un autre critique enfin, qui, n'ayant guère que seize ans en 1861, n'avait pas pu entendre Tannhaeuser à Paris, courait le voir jouer dès qu'il fut représenté à Bruxelles en 1873, et s'écriait, lui aussi, dans son article : " Ce fut un envahissement de tout mon être et qui ne fit qu'augmenter pendant trois heures. " Si celui-là est encore de ce monde, c'est bien possible, après tout, puisqu'il n'aurait que quatre-vingt-un ans tandis que M. Schuré en a quatre-vingt-cinq, il serait assez curieux de demander à l'un et à l'autre, derniers survivants de ces temps héroïques, s'ils ont toujours la même fraîcheur d'impression, la même chaleur d'enthousiasme, la même ardeur combative qu'en leurs jeunes années. Et pourquoi pas ?
ADOLPHE JULLIEN.

