“L’attentat s’infiltre dans les coeurs qu’il a mordus, mais on ne l’apprivoise pas.”
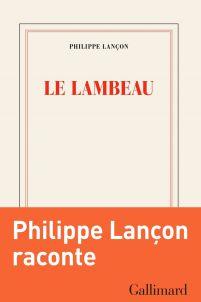
Je n’aurais sûrement pas osé lire ce témoignage qui rouvre des blessures encore fraîches dans notre conscience collective si je n’avais entendu Philippe Lançon en parler à la radio. On aurait pu craindre un accès d’émotion bien légitime, à tout le moins une énième tentative d’explication de l’inexplicable. Il n’en fut rien, et en cela je crois qu’une commune dignité caractérise en général les victimes d’attentat. Dans ce cas particulier, la lucidité, la modestie et même j’ose le dire, la sagesse du personnage m’avaient séduite à l’écoute de l’émission. Quand j’ai vu que ma micro-bibliothèque de village l’avait dans ses maigres rayons, je n’ai pas hésité à emprunter l’ouvrage.
Dans son témoignage, Philippe Lançon revient très souvent sur sa carrière de journaliste mais aussi sur sa jeunesse, ses aïeux, ses amours, ses voyages, ses affinités culturelles, à la façon d’un entonnoir pointé sur la rupture du 7 janvier 2015. Ces jours de janvier 1991 passés à Bagdad à la veille de la première Guerre d’Irak, avec quelques rares autres occidentaux restés par amour de l’information, haine de l’Amérique ou aveuglement (ou les trois), sont un des fils qui tissent la calamité du présent à celle d’hier, traçant un motif presque inscrutable pour nos esprits effarés. Mais rien ne destinait Lançon à être un martyr de la cause arabo-musulmane. Deux jours avant les bombardements américains sur l’Irak en 1991, il prenait le dernier avion quittant Bagdad. « C’est à cause du tapis » (acheté quelques jours auparavant), lui dit pince-sans-rire un collègue. Depuis, amoureux de Cuba, des femmes et de la littérature latino-américaines, il était devenu critique culturel à Libé et Charlie Hebdo.
Evidemment, l’auteur évoque ce matin du 7 janvier. Quelle émotion étrange de voir revivre la conférence de rédaction de Charlie Hebdo, les vannes des uns, les désaccords des autres, mais surtout le rire communément partagé par les journalistes et dessinateurs d’un journal honni par certains et ignoré de la plupart, rire qui prélude à l’irruption des deux tueurs. Choc du familier et de l’inconcevable. Les mots peinent à décrire ce qui s’est vraiment passé, tant le passage funeste de la mort fut rapide et brutal.
“L’irruption de la violence nue isole du monde et des autres celui qui la subit.”
Finalement, l’auteur parle assez peu des « frères K » comme il les nomme ; ils sont aussi peu vivants que le métal de leurs kalachnikovs, aussi peu consistants que les « K. » du Procès et du Château de Kafka (et aussi tourmentés que les frères Karamazov de Dostoïevski ? Evidemment, au petit jeu des initiales, on peut mettre Paris dans un violon). Il évoque surtout l’après, concentré qu’il est sur sa simple survie. Il explique combien dès lors plus rien n’a d’importance en-dehors de sa chambre, des soignants et des parents et amis qui viennent le visiter. La plus grande partie de ce livre est donc le journal d’un “voyage autour de ma chambre”.
“Tout le malheur des hommes vient de ce qu’ils ne savent pas rester au repos dans une chambre.” (Pascal, cité par l’auteur).
J’ai adoré les portraits très soignés des soignants (la « marquise des langes », cette infirmière aux doigts d’ange qui lui refait son bandage à la perfection, Chloé la chirurgienne, Annie la cantatrice, Annette-aux-yeux-clairs l’anesthésiste, oui beaucoup de femmes mais il y a des hommes aussi) : ces mains et ces visages qui le raccrochent à la vie et dont il dépend complètement. L’auteur montre très bien la sensation physique de la faiblesse et du processus de guérison qui fait mal dans la mesure où il fait du bien (répare son corps). Certains détails sont vraiment touchants : les policiers qui montent la garde et l’accompagnent jusqu’au bloc vêtus de blouses et de charlottes – sa lecture et sa relecture de “la mort de la grand-mère dans la Recherche de Proust” à chaque descente au bloc (comme d’ailleurs tous ses souvenirs liés à ses “trois grands-mères” à lui Philippe Lançon) – et même la visite de François Hollande. Il dit avoir cherché à adopter une attitude la plus “dandy” possible, c’est-à-dire de l’humour et de la bonne volonté face à ce qu’il lui était impossible de maîtriser. Cela parlera peut-être à ceux qui connaissent la maladie et les séjours à l’hôpital… Finalement, cet amas d’humanité finit par combler tant bien que mal, avec les moyens du bord, l’espèce de faille béante que l’attentat a creusé entre lui et le reste du monde “normal”.
“… ma seule prière passait pour l’instant par Bach et Kafka : l’un m’apportait la paix, et l’autre, une forme de modestie et de soumission ironique à l’angoisse.” (Dans un échange avec l’aumônier d’hôpital).
Au bout du compte, il y a un côté passionnant (et universel) dans ce récit d’un homme qui remonte lentement de l’enfer, mais d’un autre côté j’ai fini par trouver ce récit un poil trop long. Sa portée dépasse la simple visée thérapeutique ; pourtant le partage de choses très intimes, aussi exemplaire soit-il dans sa simplicité de ton (eu égard à l’événement hors norme qui l’a provoqué), a fini par me blaser un peu sur la fin. C’est peut-être ce que l’auteur évoque quand il dit combien la plupart de ses proches sont incapables de comprendre ce qu’il vit.
Limites du témoignage personnel que connaissaient par ailleurs bien les combattants de la Grande Guerre quand ils revenaient à l’arrière, et à qui je souhaite rendre hommage à la veille du centenaire du 11 novembre 1918. La paix, la santé, la vie : on ne mesure leur valeur que lorsqu’on les perd (ou qu’on a été à deux doigts de les perdre). Si seulement nous n’avions pas besoin d’une guerre ou d’un attentat pour nous le rappeler !
Hasard du calendrier : je viens d’apprendre que Philippe Lançon a reçu le prix Femina pour Le Lambeau il y a trois heures !
Le billet de Keisha, celui de Panullum.
« Le lambeau » de Philippe Lançon, Gallimard, 2018, 510 p.
Publicités
