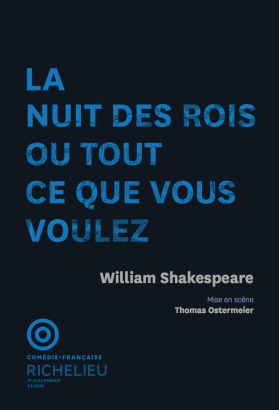
Critique de La nuit des rois ou Tout ce que vous voulez, de William Shakespeare, vu le 6 octobre 2018 à la Comédie-Française
Avec Denis Podalydès, Laurent Stocker, Stéphane Varupenne, Adeline d’Hermy, Georgia Scalliet, Sébastien Pouderoux, Noam Morgensztern, Anna Cervinka, Christophe Montenez, Julien Frison, Yoann Gasiorowski, et Paul-Antoine Bénos-Djian / Paul Figuier, Clément Latour / Damien Pouvreau
Ce spectacle, à la Comédie-Française, est sans doute l’un des événements de la rentrée théâtrale. La venue de Thomas Ostermeier dans le Premier Théâtre de France pour y monter pour la première fois La Nuit des Rois est un accomplissement certain pour Eric Ruf : il l’avait dit, l’un des buts de son mandat était de faire venir au Français les grands metteurs en scène européens. La saison passée avait été presque « sacrifiée » au profit de celle-ci, qui accueille de grands noms comme Ostermeier ou Ivo Van Hove. Mais grand nom implique-t-il forcément grand spectacle ?
La Nuit des Rois telle que l’a traduite Olivier Cadiot interroge la question du genre. On est en Illyrie et le bateau de Viola et Sébastien, deux jumeaux, vient de faire naufrage. Les frères et soeurs échouent à des endroits différents du royaume et pensent tous deux que leur moitié s’est noyée. Viola, amoureuse du duc d’Orsino qui gouverne le pays, décide de se faire passer pour un homme, Césario, et se rend à sa Cour pour lui proposer ses services. Orsino accueille le jeune travesti avec joie et lui confie la mission d’aller parler pour lui à la Comtesse Olivia, dont il est fou amoureux, et qui refuse constamment ses avances. Viola-Césario, bien que contrarié par cette situation, accepte l’ambassade et se rend auprès d’Olivia qui tombe amoureuse de lui (ou d’elle, cela dépend de comment vous voyez la chose). Voilà grossièrement l’intrigue à laquelle se mêlent des quiproquos introduits par les similitudes physiques qui lient Sébastien et Viola, et des scènes de pures comédies menée par le bouffon d’Olivia, son oncle ivrogne et un de leurs compagnons.
Vous avez forcément vu des images de ce spectacle sur les réseaux sociaux. Les Comédiens-Français en petite tenue – strings, guêpières et déshabillés de dentelle au programme – ont beaucoup fait parler. Il faut dire que l’idée était bonne et la forme est cohérente d’un bout à l’autre : quoi de mieux en effet pour traiter la question du genre que d’en souligner un de ses éléments les plus caractéristiques ? L’idée de la passerelle traversant la salle vient renforcer encore cet effet, mettant les derrières des comédiens à la vue de tous. Une idée qui fonctionne bien, il n’y a pas à dire.
Mais ensuite ? Comment faire entendre ce qu’on a donné à voir ? Sur ce dernier point, je trouve qu’Ostermeier pêche un peu. Beaucoup. Pour parler crûment – après tout je reste ainsi dans le ton du spectacle : on s’ennuie ! Le désir, l’amour, le bouillonnement attendus manquent à l’appel. La sensualité est également aux abonnés absents. A aucun moment on ne sent les personnages déstabilisés par le désir – on se contente de les voir, mais jamais cela ne passe des yeux dans la poitrine. Seule la fin, assez brillante, semble ajouter un peu de fond à une forme peut-être trop privilégiée dans ce spectacle où tout reste en surface.

© Jean-Louis Fernandez
Il faut dire que le spectacle a du mal à se lancer. En cause, un Denis Podalydès un peu mou, qui peine à trouver le rythme adéquat lors de la première scène et nous perd dans ses déclarations. Il faut dire qu’en plus d’être difficilement crédible dans son rôle de duc d’Orsino, il est un intrus total dans cette distribution jeune et dynamique. La différence est d’autant plus appuyée que Podalydès, comme les autres comédiens, est en string, et même si, après certaines mises en scène récentes, sa physionomie n’a plus de secret pour nous, on a du mal à croire que Viola (Georgia Scalliet) soit folle de lui. Enfin, son incarnation est également en décalage avec le reste de la troupe, et on ne comprend pas vraiment où il va : il le joue fou, légèrement halluciné, rappelant parfois son interprétation magistrale de Calogero dans La Grande Magie il y a quelques années. Mais sans grand effet ici.
Le manque de rythme se fait lourd durant la première partie de la pièce. Les scènes entre Viola et Olivia m’ont laissée totalement de marbre, aucune alchimie ne semblant lier les personnages. Là où l’air devrait devenir électrique, le courant est nul. Les échanges sont lents, les silences ne semblent porter aucune intention véritable. L’ambiguïté liant les deux personnages n’éclate pas. Adeline d’Hermy, pourtant si belle dans son costume d’Olivia, est bien fade dans ses échanges avec Georgia Scalliet. De plus, si les interludes musicaux qui viennent ponctuer la plupart des scènes sont très appréciables au début de la pièce, ils deviennent un peu lassants avec l’avancée du spectacle (oui, même Monteverdi peut lasser !), en cassant un rythme qui a déjà du mal à s’installer.
Heureusement, les intermèdes burlesques parviennent à réveiller nos esprit endormis. Le contrepoint comique est mené de main de maître par un Laurent Stocker en grande forme. Si le trio Stocker-Varupenne-Montenez fonctionne à merveille, il est clair que c’est le premier qui mène la danse. Le moindre de ses gestes, le moindre de ses mots, la moindre de ses grimaces provoque le rire de la salle. Son échange avec Christophe Montenez sur l’actualité politique est facile, mais finalement bien trouvé et hilarant. L’arrivée d’Anna Cervinka dans le trio devenu quatuor ne gâte rien. Leur présence fait du bien, et ça se sent : dans la seconde partie du spectacle où ils sont plus présents, un certain rythme semble prendre ses marques, et notre attention se fait soudainement plus présente. Et je pense qu’on le leur doit en grande partie.
Le jour où j’ai vu le spectacle, Adeline d’Hermy a dû faire une annonce avant le début de la pièce : Noam Morgensztern ayant des problèmes de transport, ils ne savaient pas si un comédien devrait le remplacer ou s’il arriverait à temps pour interpréter son rôle. C’est peut-être cet imprévu qui les a rendus si absents ce jour-là, mais il n’a pas atteint une seconde le comédien en question : Noam Morgensztern, même dans un plus petit rôle, était brillant. Il avait vraiment saisi quelque chose de son personnage, n’en faisant pas qu’un pantin destiné à aimer mais un Antonio complexe, dégageant à la fois une puissance animale et une peur d’aimer qu’il semblait combattre. En quelques répliques, il a fait de son personnage le centre de toutes les attentions, il est devenu duc, il est devenu roi. Peut-être le seul roi de la Salle Richelieu, ce soir-là.
Une Nuit des Rois en petite culotte qu’on attendait bien plus culottée ! 

© Jean-Louis Fernandez

