J’étais désireuse de lire un autre roman de Siri Hustvedt, après Un été sans les hommes qui m’avait tellement plu, histoire de confirmer mon goût pour cette auteure. C’est donc avec une certaine curiosité mêlée d’appréhension que j’ai commencé cette lecture.
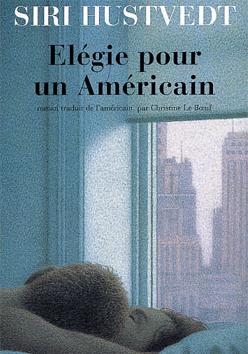
Verdict ? Elle m’a au départ complètement embarquée dans l’intimité d’Erik Davidsen, ce psychanalyste new-yorkais dont le père vient de mourir. C’est l’occasion pour lui et sa soeur Inga (veuve d’un écrivain célèbre) de replonger dans le passé de leur père, documenté par des extraits du journal du défunt. Fils d’immigrés norvégiens, grandi dans une ferme très pauvre du Minnesota, combattant de la Seconde Guerre mondiale, devenu à force de travail et de volonté un respectable professeur d’histoire à l’université, Lars Davidsen cachait un secret que ses enfants souhaitent à présent élucider. Dans le même temps, Erik accueille chez lui une nouvelle locataire affriolante et sa fillette de 5 ans, que menace l’ombre d’un ex-compagnon, photographe déséquilibré et vrai « stalker ». Ses patients lui prennent beaucoup d’énergie et d’espace mental. Quant à Inga, elle se débat avec ses propres ombres, dont le souvenir d’un mari adoré – pas que par elle -, et le traumatisme du 11 septembre 2001 qu’elle et sa fille ont vécu de tout près.
Avec finesse, Siri Hustvedt tisse la chronique douce-amère d’un homme entre deux âges, divorcé et sans enfants, à qui la mort de son père fait remonter des souvenirs anciens qui vont se mêler de façon énigmatique à la série d’événements plus ou moins désagréables qui lui tombent dessus. Comme dans Un été sans les hommes, mais de façon plus prégnante, nous sommes enserrés dans un réseau de considérations et théories psychologiques portées par des personnages, réels ou fictionnels. On y croise une tripotée de psychiatres, historiens de la médecine, neurologues, psychanalystes, et même neuro-psychanalystes (donc si le sujet vous emm****, il vaut mieux passer votre chemin). Comme l’indique la rituelle page de remerciements à la fin, l’auteure participe à de nombreux séminaires consacrés au sujet et anime des ateliers à destination de malades psychiques. Elle connaît donc bien son sujet et certaines anecdotes sont visiblement tirées de sa propre expérience ou de celle de collègues thérapeutes. La mise en scène de la confrontation praticien/patient dans les séances de thérapie d’Erik est à ce titre fascinante car on y assiste du point de vue du psychanalyste, dont on voit que l’inconscient est complètement perméable à celui du psychanalysé.
Ce qui rend également un son de vérité, ce sont les extraits du journal de guerre de Lars Davidsen. Je me demandais comment l’auteure avait pu se glisser à ce point dans la peau d’un jeune combattant américain de la Seconde Guerre mondiale. La page de remerciements, toujours, m’a appris qu’elle avait carrément inséré des extraits du journal de son propre père (lui aussi fils d’immigrés norvégiens), avec son autorisation et après sa mort.
C’est pourquoi ce roman dégage une tonalité effectivement élégiaque. Je ne sais jusqu’à quel point Siri Hustvedt l’a écrit en mémoire de son père et de sa famille, en mémoire des immigrés pauvres du début du 20e siècle, en mémoire des morts de la Seconde Guerre mondiale, du 11 septembre et des futurs morts de la Guerre d’Irak qui débutait. Ce roman fait-il partie d’un travail de deuil personnel (avec une visée collective que désigne l' »Américain » du titre) ? Ce n’est pas vraiment important pour le lecteur de le savoir, mais toujours est-il que ce récit m’a un peu larguée en route. Les personnages principaux, notamment Erik, m’ont semblé plats, éteints, voire un peu « morts ». Ils ont peine à prendre de l’épaisseur, malgré la richesse de leur histoire personnelle, comme s’ils étaient des masques plaqués sur des faits réels. Au milieu du livre, je m’ennuyais gentiment et j’avais du mal à retenir les noms des proches de la famille Davidsen et ce qui les reliait (rappelons qu’Erik et Inga procèdent à une sorte d’enquête principale, à laquelle se mêlent des enquêtes secondaires concernant leurs vies privées). Les conversations feutrées entre représentants de la classe intellectuelle supérieure n’arrivaient plus à m’émouvoir, malgré les sentiments violents des personnages.
Ce qui m’a retenu, c’est tout de même une grande qualité d’écriture, fluide, intime, chaleureuse – en gros tout ce qui me plaisait déjà chez elle. L’auteure m’emporte malgré moi dans les arcanes de ses personnages et de ses dadas (psychologie donc, mais aussi philosophie, linguistique, questions identitaires). Je suis donc partagée : ce n’est pas le coup de coeur vécu quand je l’ai découverte avec Un été sans les hommes, mais ce n’est pas un ratage non plus. Un entre-deux tout en camaïeu de gris domine dans ce roman à entrées multiples (l’illustration de couverture est à ce titre très bien trouvée), ce qui ne m’empêchera pas de récidiver avec mon amie Siri !
« Elégie pour un Américain » de Siri Hustvedt, traduit de l’anglais par Christine Le Boeuf, Actes Sud, 2008, 393 p.
Publicités
