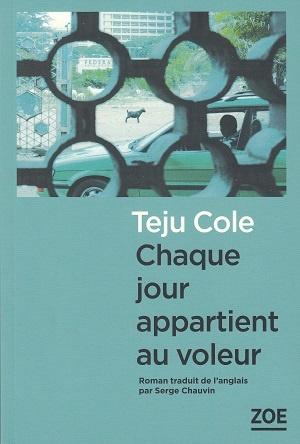
Le titre provient d'un proverbe yoruba, langue et ethnie du Nigeria, placé en épigraphe au livre:
Chaque jour appartient au voleur, mais un seul au propriétaire.
En retournant dans son pays d'origine, le Nigeria justement, après quinze ans passés à New-York, le narrateur, la trentaine, doit convenir que ce proverbe est toujours d'actualité.
Avant même d'y retourner il a, au consulat nigérian, un avant-goût de la corruption à laquelle il devra faire face sitôt débarqué à Lagos:
En plein New York, me voir insolemment réclamer un pot-de-vin, c'est un choc auquel je n'étais guère préparé.
Le fait est que c'est une bonne introduction à ce qui l'attend là-bas, à savoir une société clientéliste, qui n'a rien à voir avec celle qu'il s'apprête à quitter et où les libertés individuelles sont l'objet de respect.
Une fois sur place, il constate:
L'argent, dispensé en quantités appropriées au contexte, sert ici de lubrifiant social. Il facilite les mouvements tout en préservant les hiérarchies.
Tout le monde ici s'en accommode: C'est perçu soit comme une contrariété mineure soit comme une bonne occasion. A condition, bien sûr d'être raisonnable, c'est-à-dire de ne pas voler trop, ni trop vite...
C'est un cercle vicieux: C'est parce que tout le monde choisit la voie parallèle que rien ne fonctionne, et du coup la seule manière d'arriver à quelque chose est de prendre une nouvelle voie parallèle...
Le narrateur donne de nombreux exemples de corruption: l'escroquerie à l'avance de fonds dans les cybercafés, le racket dans la rue, le pot-de-vin dans toutes les relations avec les fonctionnaires, quels qu'ils soient, etc.
Le narrateur est là pour trois semaines, un mois. Il est venu avec l'intention d'écrire, de lire, de créer, mais c'est mission impossible: il arrive seulement à prendre quelques photos. Le livre est d'ailleurs illustré de photos prises par l'auteur.
Il y aurait pourtant beaucoup de choses à dire (les vies sont si pleines de romanesque imprévisible), mais encore faudrait-il pouvoir trouver refuge, contre le bruit, la chaleur, les déplacements qui épuisent, les coupures d'électricité etc.
Ce qui a changé en quinze ans, c'est que l'oppresseur n'est plus un gouvernant, mais risque fort d'être un citoyen comme vous, dont le sens éthique a été érodé par des années de souffrance et de vie au seuil du désespoir. La vénalité prospère ici, mais c'est pourtant l'atmosphère générale de désarroi, de capitulation qui brise le coeur.
Ici comme ailleurs le public ne souffre pas la comparaison avec le privé: Autant des endroits comme le Musée national anéantissent en moi tout désir de revenir vivre ici, autant des institutions comme le MUSON le raniment...
L'économie nigériane connaît certes une vitalité nouvelle:
Les affaires sont florissantes, la libre entreprise prospère, et avec elle, l'espoir d'arracher la population à la pauvreté.
Mais ce n'est encore qu'un progrès d'emprunt, auquel manquent les engagements idéologiques qui seuls peuvent le rendre réel.
Car il y a au Nigeria déconnexion du réel, endémique:
Le Nigeria a été déclaré le pays le plus pieux du monde [On attribue une explication surnaturelle aux événements les plus ordinaires...], les Nigérians le peuple le plus heureux du monde, et dans le rapport établi par Transparency International en 2005, le Nigeria était classé parmi les trois derniers ex-aequo (sur 159) dans l'évaluation des pays les moins corrompus.
Le narrateur de ce roman de Teju Cole, vrai reportage sur le Nigeria du début du XXIe siècle, pose deux questions lancinantes:
Pourquoi, si l'on est si pieux, accorder si peu d'importance à l'éthique ou aux droits de l'homme? Pourquoi si l'on est si heureux, tant de lassitude et de souffrance étouffée?
Francis Richard
Chaque jour appartient au voleur, Teju Cole, 192 pages, Zoé , traduit de l'anglais par Serge Chauvin (sortie le 4 octobre 2018)

