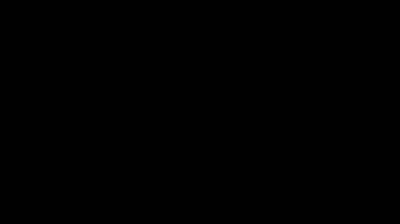On aura beaucoup glosé sur les similitudes entre le dernier-né de David Cameron Mitchell, réalisateur de l’acclamé It Follows, et Southland Tales de Richard Kelly, éphémère enfant chéri d’Hollywood désormais persona non grata, cloué au piloris sur la Croisette en 2006 par une critique cinglante dont il ne se releva pas. Dans un cas comme dans l’autre, deux metteurs en scène portés aux nues pour avoir enfanté deux pépites indé (It Follows, donc, d’un côté, Donnie Darko de l’autre), dont les projets suivants nourrissaient les espoirs et les fantasmes les plus grands. Des attentes renforcées et légitimées (consacrées) par une sélection en Compétition Officielle à Cannes qui, sous couvert de consécration précoce, s’est finalement bien vite transformée en malédiction. Si la disgrâce est désormais entérinée pour Richard Kelly (plus actif sur Twitter qu’au sein de l’industrie), rien n’est encore joué pour David Cameron Mitchell, dont le Under the Silver Lake, certes lesté d’une bien mauvaise réputation, peut encore capitaliser sur une sortie en salles prévue pour la fin de l’année, et tenter d’amorcer une certaine rédemption.
Soyons francs, au terme de ces presque deux heure et trente minutes de projection, et au vu du micmac visuel et thématique déployé par son auteur, l’affaire n’est absolument pas gagnée. Que l’on ne s’y trompe pas pour autant : Under the Silver Lake, malgré des errances et des manquements flagrants, possède bien trop d’envie de cinéma, bien trop d’idées pour qu’on le balaie d’un revers de main et le boude d’emblée. Film neo-noir autoproclamé, aux influences lynchiennes revendiquées, pétri d’un nombre presque indécent de références pop, le tout saupoudré d’hommages au cinéma des années trente-quarante, Under the Silver Lake est pour David Cameron Mitchell l’occasion de conjuguer cinéphilie débordante et expérimentations formelles novatrices dans leur exécution, tout en restant constamment déférentes. Effet Vertigo, fisheye, et autres distorsions visuelles la disputent ainsi à une excellente direction photo pour mettre en scène un Los Angeles interlope tout droit tiré d’un La La Land sous acide et fortement vicié. Amorçant un art du contrepied que Cameron Mitchell prendra un malin plaisir à ne surtout pas quitter, le film noir dans Under the Silver Lake se fait coloré, esthétiquement léché, sale et malpropre tout en se montrant flatteur à regarder.

Cherchant à bouleverser les codes des genres et des modèles qu’il convoque, David Cameron Mitchell détourne, travestit, voire trahit les canons en (ab)usant du pastiche (Hitchcock ou Welles sont notamment explicitement cités) ou de la parodie (les séquences de déchiffrage des symboles, tout droit tirées d’un film policier, constamment désamorcées par une vanne lancée par le personnage principal), pourà la fois baser ses effets sur des acquis solides (la technique des cinéastes fondateurs), et se faire plaisir en laissant libre court à ses propres élans créatifs. La démarche, loin d’être inintéressante, trouve cependant bien vite ses limites, tant David Cameron Mitchell, à force de citations et de clins d’œil permanents (à l’histoire du cinéma, mais aussi à celle de la musique, des comics, et de manière plus générale, à la la pop culture), finit par diluer son style pourtant clairement affirmé avec It Follows en particulier, et par perdre de vue ce qui faisait la spécificité de son propre cinéma. Ainsi, pas un seul plan n’échappe à l’injection ci et là d’un gimmick aisément identifiable, à l’apport d’un détail (une affiche, un accessoire, ou une tenue vestimentaire) connu des initiés, entravant par le fait même l’émanation d’un quelconque sens dû d’abord et avant tout à ce que ces plans peuvent intrinsèquement raconter. Détournant constamment l’attention, ces références siphonnent Under the Silver Lake de toute matière un tant soit peu profonde, et mettent au contraire l’accent sur le superficiel et sur ce que le métrage a de plus racoleur à offrir. Un choix d’autant plus assumé que la problématique se retrouve aussi bien dans le fond que dans la forme, avec un travail de montage certes abouti, mais symptomatique d’une vision foutraque et décousue, mal contenue par un Cameron Mitchell totalement en roue libre de ce point de vue. Sous couvert d’un mystère artificiellement entretenu près de deux heures et demi durant, Under the Silver Lake part dans toutes les directions pour, à chaque pas en avant, en faire deux en arrière, et revenir au point de départ avec le sentiment d’un manque flagrant de matière. Un désir de faire du Gilliam version Las Vegas Parano, sans la dose de folie nécessaire pour mettre la tête à l’envers.
À l’instar de Richard Kelly sur Southland Tales, David Cameron Mitchell construit un récit faussement complexe et érudit, moins brillant que malin, entretenant l’illusion d’une profondeur à explorer (en bon élève de Lynch ou des Coen de Barton Fink) par un trop plein de générosité, mais dont le château de cartes s’effondre littéralement une fois le pot aux roses (bien vite) révélé. Peu avare de son temps, Cameron Mitchell, en cherchant à épater la galerie par la seule force de sa culture et de son talent, pêche par gourmandise et vanité, oubliant au passage qu’un long-métrage reste une expérience à partager. Obscur et nombriliste, Under the Silver Lake raconte finalement (trop) peu avec beaucoup, marqué du sceau de la vacuité même si mis en scène avec goût.
Si la performance d’Andrew Garfield, en tête à claques un peu bêta, dépressive et paumée, saura, elle, faire l’unanimité (ce qui ne serait d’ailleurs que justice pour un acteur au jeu injustement décrié), c’est peu dire que le reste d’Under the Silver Lake risque de diviser ; les échos cannois, une fois n’est pas coutume, ne s’étaient finalement pas trompés, même si hurler au ratage à même de saborder la carrière de David Robert Mitchell s’avère, au vu du résultat certes perfectible mais détonant et inusité, grandement exagéré.

Film vu dans le cadre du Festival Fantasia 2018