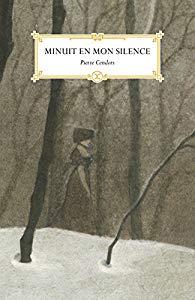
Ce livre de Pierre Cendors prend ses racines dans une littérature de la fin du XIXe siècle. Et disperse ses éclats dans les mots d’Orphée, mort au front. Je pense à Gérard de Nerval ( « La Treizième revient… » écrit celui-ci ; « une horloge sonne treize coups… » lit-on dans ce livre), je pense à René Char (à cause du sous-titre « Lettera amorosa »), je pense bien sûr à Arthur Rimbaud (« Aube »). D’autres poètes sont là, dans cette guerre du début du XXe siècle, que je connais moins.
Du poème de Rimbaud que je viens de citer, on voit aisément comme il irrigue le texte : « Les camps d’ombres ne quittaient pas la route du bois »… « La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom »… « Je ris au wasserfall blond qui s'échevela à travers les sapins : à la cime argentée je reconnus la déesse. »… « L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. »
La fleur qui dit son nom est peut-être l’Iris de la « lettera amorosa » de René Char, ici transformée en Isis, une déesse, dans « l’ombre augurale » de laquelle le lieutenant Heller écrit les mots d’un amour impossible : « Un autre visage nous attend là que l’on a cherché sa vie entière ».
La guerre, quelle qu’elle soit, vient interrompre quelque chose. Ici elle met fin à un amour non déclaré, elle laisse une toile vierge où devait être peint ce visage. La guerre est aussi ce qui tue : « Au moment de mon arrivée, je portais le deuil de mon enfance. J’avais vingt ans. Il était minuit en mon silence. »
Le texte de Pierre Cendors est d’une écriture élégante. « Je parle ma propre langue natale avec un accent. On en déduit que je suis un étranger instruit. » Ce n’est pas maniéré. « J’écris, madame, pour penser en dehors de la pensée. » Voilà bien une exigence poétique. Qui ne croit pas aux rêves, mais « à cela dont ils sont la signature ».
« La poésie, madame, c’est désimaginer le monde tel qu’on nous le vend. C’est découvrir qu’il n’est rien et que s’en éveiller est tout. »
