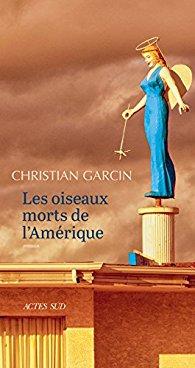 C’est fou comme le fait de bloguer peut vous changer vos habitudes de lecture et vous pousser à sortir de votre zone de confort. Tenez, moi par exemple. Il y a quelques années j’aurais très rarement bougé d’un iota de mes auteurs fétiches. Et voilà-t-y pas que, comme l’a fait Lili récemment, je saute dans l’inconnu, j’ose, je me montre d’une audace folle : j’emprunte à la bibliothèque un livre qui vient de paraître, d’un auteur inconnu au bataillon (enfin, le mien de bataillon, car il est tout de même reconnu dans le milieu, Garcin), et dont je n’ai encore lu aucune critique. La révolution, en quelque sorte.
C’est fou comme le fait de bloguer peut vous changer vos habitudes de lecture et vous pousser à sortir de votre zone de confort. Tenez, moi par exemple. Il y a quelques années j’aurais très rarement bougé d’un iota de mes auteurs fétiches. Et voilà-t-y pas que, comme l’a fait Lili récemment, je saute dans l’inconnu, j’ose, je me montre d’une audace folle : j’emprunte à la bibliothèque un livre qui vient de paraître, d’un auteur inconnu au bataillon (enfin, le mien de bataillon, car il est tout de même reconnu dans le milieu, Garcin), et dont je n’ai encore lu aucune critique. La révolution, en quelque sorte.
Eh bien figurez-vous que la révolution me va bien au teint car j’ai frôlé le coup de coeur pour ce roman taille S (un tour de tranche qui convient bien à la fille qui marine dans son Proust depuis des mois). C’est l’histoire d’un homme qui tient peu de place en ce bas-monde : à 70 berges passées, Hoyt Stappleton vit dans un collecteur d’eau à la périphérie de Las Vegas. Sa « petite vie misérable et tranquille » est à l’antipode de la capitale du fric et de la débauche. Ses possessions personnelles tiennent dans un baluchon et sa parole est rare, sauf à l’égard des grillons et d’une famille de mulots qui campent à proximité. Ses compagnons d’infortune en savent peu sur cet homme terne d’apparence, si ce n’est qu’il est un aficionado des voyages dans le futur : non seulement il a lu tous les ouvrages de prospective sur le sujet, mais il se transporte lui-même en pensée dans les siècles, voire les millénaires à venir, et ce qui est sûr, c’est que le pire peut arriver.
« Du centre-ville de Las Vegas jusqu’à la périphérie, les voies ferrées désertes, les no man’s land et les échangeurs autoroutiers, tout un réseau d’égouts et de collecteurs d’eau de pluie traversait la ville de part en part, trois cent vingt kilomètres en tout, des canalisations allant de tuyaux de soixante centimètres de diamètre à des tunnels de trois mètres de haut sur six de large dont beaucoup étaient habités, dessinant un monde souterrain en partie inexploré et secret, une ville bis, un envers du décor à l’ombre des lumières et des paillettes clignotantes du Strip. » (p. 11)
Ce voyageur sans bagage explore aussi l’envers d’une cité mégalo plantée en plein désert du Nevada : avec lui, on arpente les perspectives nues et poussiéreuses des avenues éloignées du centre, les arrières délabrés des motels anonymes, les terrains vagues. Plusieurs vétérans de plusieurs guerres se retrouvent pour partager le même bout de tunnel en guise de toit, boire, évoquer les séquelles des combats et se bagarrer. Hoyt, lui, a fait le Vietnam. Il ne parle jamais de son passé. Mais quand il se décide à emprunter le sens inverse dans ses voyages temporels, ses souvenirs le ramènent à une belle matinée de 1950 dans une cuisine ensoleillée, assis à boire son bol de chocolat, sa mère à ses côtés. Et de cette exploration du passé, il rapporte des pépites tout comme de troublantes trouvailles, enfouies depuis longtemps dans son inconscient. Sous les auspices bienveillants d’une fée bleue plantée au sommet d’un motel en ruine, les différentes strates de temporalité semblent vouloir se tordre, le passé remonte à la surface et embrasse le présent, les coïncidences abondent, et les apparitions sont aussi fugaces que les vérités sont enchevêtrées les unes aux autres.
« Peut-être la ville était-elle à présent truffée d’intersections entre passé et présent, de filons dans la niche temporelle qui ne demandaient qu’à être forés. Pendant quelques secondes, il demeura installé dans la plénitude de cette évidence, si aléatoire pourtant, hésitante et fragile comme un vol de chauve-souris. Puis il secoua la tête, et fit demi-tour. Le trafic et les bruits de la rue se réinstallèrent progressivement. Il passa le portail, rejoignit Sahara Avenue et se dirigea vers les lumières du Strip. » (p. 77)
Sans emphase, avec une grande économie de moyens, comme ces scènes anodines de SDF prenant leur café au soleil à côté d’une autoroute, Christian Garcin ouvre mine de rien quantité de « dossiers » dans cette histoire d’un vieil homme et l’amer : conscience écologique, avec la mise en scène de la surconsommation et du dépouillement, de l’angoisse apocalyptique ; considérations physiques et métaphysiques sur le temps et l’espace par où s’engouffre une part de magie ; récits croisés d’anciens combattants dont les guerres tracent chacune un sillon dans l’éternel champ de bataille de l’histoire ; roman familial d’amour et d’amitié aux personnages attachants ; intrigue à rebondissements ; morceaux de poèmes… Et pourtant, il ne s’agit ni d’une épopée, ni d’une saga, ni d’un roman-fleuve, juste d’un conte américain à la Steinbeck.
« Dessiner le silence : c’était son vrai projet. » (p. 107)
La morale de cette histoire est évanescente et se prête à plusieurs interprétations. Et c’est pourquoi on a envie de prolonger un peu notre séjour au bord d’un collecteur d’eau, sous un soleil de plomb, en compagnie de Hoyt et des autres…
« Les oiseaux morts de l’Amérique » de Christian Garcin, Actes Sud, janvier 2018, 220 p.
Publicités
