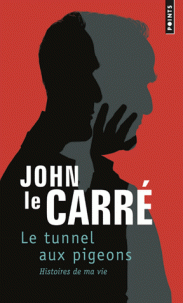 Parmi les films tirés de ses œuvres, estime John Le Carré,
les meilleurs « sont ceux qui n’ont
jamais vu le jour. » Si l’on en juge d’après les noms des réalisateurs
tentés par une adaptation sans aller jusqu’au bout, il a peut-être
raison : Fritz Lang, Sydney Pollack, Francis Ford Coppola ou Stanley
Kubrick. Mais, lui dira Pollack, « pourquoi
vous acharnez-vous à écrire des bouquins si compliqués ? »
La réponse à la question du cinéaste se trouve entre les
lignes du livre autobiographique de John Le Carré, Le tunnel aux pigeons. En deux explications.
La première est apportée par les scènes où David Cornwell –
son véritable nom – est sur le terrain. Le terrain est complexe et il faut bien
que les romans rendent compte de l’embrouillamini qu’est souvent la réalité.
Les lecteurs de ses livres, de La Taupe
à Un traître à notre goût, d’Une petite ville en Allemagne au Chant de la mission se réjouiront de
découvrir le dessous des cartes. Ce qui, dans le travail d’espion sans grade,
dans les rencontres, dans les voyages, a été emprunté à ses notes prises sur le
vif par l’écrivain. On relève au passage qu’il fait davantage confiance à
celles-ci qu’aux photographies qu’il aurait pu prendre – et dont il se passe
donc sans regrets. « Quand j’écris
une note, ma mémoire enregistre cette pensée ; quand je prends une photo,
l’appareil me vole mon travail. »
Certains souvenirs ont une saveur toute particulière.
L’histoire des rencontres avec Yasser Arafat, par exemple, semble inventée tant
elle est hors normes. A cette occasion, et en quelques autres, on comprend
comment Le Carré voyage, quand c’est dans le but d’écrire un roman, en compagnie
de ses personnages : ce qu’il vit, il ne le ressent pas directement
lui-même mais le donne à connaître à ces êtres de fiction qui s’animent et
réagissent à travers lui. « J’ai
longtemps cru ma façon de procéder unique, jusqu’à ce que je rencontre un célèbre
photographe de guerre qui m’avoua que c’était seulement lorsqu’il regardait
dans le viseur de son appareil que sa peur le quittait. »
Parmi les films tirés de ses œuvres, estime John Le Carré,
les meilleurs « sont ceux qui n’ont
jamais vu le jour. » Si l’on en juge d’après les noms des réalisateurs
tentés par une adaptation sans aller jusqu’au bout, il a peut-être
raison : Fritz Lang, Sydney Pollack, Francis Ford Coppola ou Stanley
Kubrick. Mais, lui dira Pollack, « pourquoi
vous acharnez-vous à écrire des bouquins si compliqués ? »
La réponse à la question du cinéaste se trouve entre les
lignes du livre autobiographique de John Le Carré, Le tunnel aux pigeons. En deux explications.
La première est apportée par les scènes où David Cornwell –
son véritable nom – est sur le terrain. Le terrain est complexe et il faut bien
que les romans rendent compte de l’embrouillamini qu’est souvent la réalité.
Les lecteurs de ses livres, de La Taupe
à Un traître à notre goût, d’Une petite ville en Allemagne au Chant de la mission se réjouiront de
découvrir le dessous des cartes. Ce qui, dans le travail d’espion sans grade,
dans les rencontres, dans les voyages, a été emprunté à ses notes prises sur le
vif par l’écrivain. On relève au passage qu’il fait davantage confiance à
celles-ci qu’aux photographies qu’il aurait pu prendre – et dont il se passe
donc sans regrets. « Quand j’écris
une note, ma mémoire enregistre cette pensée ; quand je prends une photo,
l’appareil me vole mon travail. »
Certains souvenirs ont une saveur toute particulière.
L’histoire des rencontres avec Yasser Arafat, par exemple, semble inventée tant
elle est hors normes. A cette occasion, et en quelques autres, on comprend
comment Le Carré voyage, quand c’est dans le but d’écrire un roman, en compagnie
de ses personnages : ce qu’il vit, il ne le ressent pas directement
lui-même mais le donne à connaître à ces êtres de fiction qui s’animent et
réagissent à travers lui. « J’ai
longtemps cru ma façon de procéder unique, jusqu’à ce que je rencontre un célèbre
photographe de guerre qui m’avoua que c’était seulement lorsqu’il regardait
dans le viseur de son appareil que sa peur le quittait. »La deuxième explication à la complexité de ses livres est plus personnelle, liée à son enfance. C’est la plus intéressante. Il écrit : « Ce n’est pas l’espionnage qui m’a initié au secret. La tromperie et l’esquive avaient été les armes indispensables de mon enfance. » La preuve par l’absence de la mère et la carrière assez particulière de son père, escroc de haut vol, séducteur entouré d’une cour d’admirateurs et encore davantage d’admiratrices. Face à lui qui pratiquait le mensonge et la dissimulation comme des arts à part entière, il fallait bien se défendre. Ce qu’apprit très vite l’enfant, l’adolescent, l’adulte – et l’écrivain, « fils du père de l’auteur », comme il l’écrivait en ajoutant sa signature à celle que Ronnie, le père, avait déjà apposée sur certains exemplaires de ses romans. Il avait inventé ses vies, le fils allait en inventer d’autres.
