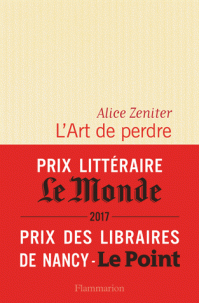 Elle avait déjà reçu le Prix littéraire du Monde pour L'art de perdre, et je m'en étais réjoui (vous aviez lu, à ce moment, quelques passages que j'avais surlignés dans mon exemplaire). Je me réjouis donc à nouveau de voir Alice Zeniter lauréate du Goncourt des Lycéen.ne.s (j'aggrave mon cas, je sais) pour ce beau roman qui mérite, outre les lectrices et lecteurs déjà nombreux, une véritable attention. Et une bande rouge qui va bientôt déborder du livre, puisque le roman avait déjà obtenu le Prix des libraires de Nancy/Le Point.
Au journal Le Monde,
qui venait de la choisir comme lauréate de son cinquième prix littéraire, Alice
Zeniter disait entretenir avec ce type de récompense « un rapport, disons, fluctuant », un peu ennuyée par
l’idée de compétition qui s’y glisse. Mais les prix littéraires se préoccupent
peu des réticences des auteurs : tous les romans d’Alice Zeniter, même
celui qu’elle a publié à 16 ans, en ont reçu. Le cinquième, L’art de perdre, vient de paraître à la
rentrée, et en est déjà au deuxième, après le Prix des libraires de Nancy et
des journalistes du Point, remis ce
week-end lors du Livre sur la Place. Ce n’est peut-être pas fini, car son livre
apparaît dans d’autres sélections, en particulier celles du Goncourt et du
Renaudot.
L’art de perdre
est le roman d’une famille qui s’est perdue et qui, à la troisième génération,
tente de retrouver un sens au présent à travers le passé. Naïma, petite-fille
d’Ali, ne sait pas grand-chose de ce qui est arrivé avant l’arrivée de son
grand-père sur le sol français. Hamid, son père, n’est guère mieux informé. Une
chape de silence pèse sur les années 1954 à 1962, celles de la Guerre
d’Algérie, quand chacun devait, qu’il en ait envie ou non, choisir son camp.
Sous la menace du FLN et sous celle de l’armée française, dans une insoutenable
tension avec les voisins ou même les membres de la famille, Ali a cherché une
protection : « Il fait le
choix, se dira Naïma plus tard en lisant des témoignages qui pourraient être
(mais qui ne sont pas) ceux de son grand-père, d’être protégé d’assassins qu’il
déteste par d’autres assassins qu’il déteste. »
A l’indépendance, Ali se sent indésirable et en danger de
mort, réussit à fuir avec les siens vers la France qui n’a pas vraiment envie
de les accueillir et les parque dans un camp en attendant une illusoire
solution. Harki, c’est-à-dire, vu d’Algérie, collaborateur du pouvoir qui vient
d’être chassé, il n’en est pas moins, aux yeux d’un Français blessé d’une autre
manière par les événements, un « crouille ». Du genre que n’aime pas
un cafetier qui refuse de lui servir une bière malgré les médailles méritées
lors de la bataille de Monte Cassino qu’Ali a pris soin de s’épingler sur la
poitrine. Ce jour-là, un policier appelé par le tenancier pour dégager l’Arabe
lui sauve la mise : il a combattu au même endroit. Mais, en sortant du bar
où il a trinqué avec son compagnon d’armes, Ali sait qu’il n’y reviendra plus.
Riche propriétaire chassé par les circonstances, Ali est
devenu un petit ouvrier soumis à ses chefs, acceptant sa nouvelle et peu
enviable condition – bien obligé. Il n’en va pas de même pour Hamid, un de ses
fils, à qui l’apprentissage de la langue française, l’enseignement et des amis
permettent de refuser la résignation. D’autant que, laissé dans l’ignorance de
ce qui s’est réellement passé en Algérie, il s’est coupé de ses origines. A propos
des racines, il dit : « Les
miennes, elles sont ici. Je les ai déplacées avec moi. C’est des conneries, ces
histoires de racines. Tu as déjà vu un arbre pousser à des milliers de
kilomètres des siennes ? Moi j’ai grandi ici alors c’est ici qu’elles sont. »
Ici, c’est bien sûr la France.
Naïma, qui travaille dans une galerie d’art, est amenée à
essayer de démêler tout ça et à comprendre, avant de se rendre en Algérie sur
les traces d’un artiste que son patron, qui est aussi son amant, veut exposer.
Le voyage ne se fera pas sans inquiétude. Elle s’est renseignée sur Wikipédia,
elle est restée sur Internet pour lire les réactions haineuses qui pullulent
dès qu’il est question de harkis, elle s’est plongée dans des livres. Il lui
reste beaucoup de questions sans réponse.
Elle avait déjà reçu le Prix littéraire du Monde pour L'art de perdre, et je m'en étais réjoui (vous aviez lu, à ce moment, quelques passages que j'avais surlignés dans mon exemplaire). Je me réjouis donc à nouveau de voir Alice Zeniter lauréate du Goncourt des Lycéen.ne.s (j'aggrave mon cas, je sais) pour ce beau roman qui mérite, outre les lectrices et lecteurs déjà nombreux, une véritable attention. Et une bande rouge qui va bientôt déborder du livre, puisque le roman avait déjà obtenu le Prix des libraires de Nancy/Le Point.
Au journal Le Monde,
qui venait de la choisir comme lauréate de son cinquième prix littéraire, Alice
Zeniter disait entretenir avec ce type de récompense « un rapport, disons, fluctuant », un peu ennuyée par
l’idée de compétition qui s’y glisse. Mais les prix littéraires se préoccupent
peu des réticences des auteurs : tous les romans d’Alice Zeniter, même
celui qu’elle a publié à 16 ans, en ont reçu. Le cinquième, L’art de perdre, vient de paraître à la
rentrée, et en est déjà au deuxième, après le Prix des libraires de Nancy et
des journalistes du Point, remis ce
week-end lors du Livre sur la Place. Ce n’est peut-être pas fini, car son livre
apparaît dans d’autres sélections, en particulier celles du Goncourt et du
Renaudot.
L’art de perdre
est le roman d’une famille qui s’est perdue et qui, à la troisième génération,
tente de retrouver un sens au présent à travers le passé. Naïma, petite-fille
d’Ali, ne sait pas grand-chose de ce qui est arrivé avant l’arrivée de son
grand-père sur le sol français. Hamid, son père, n’est guère mieux informé. Une
chape de silence pèse sur les années 1954 à 1962, celles de la Guerre
d’Algérie, quand chacun devait, qu’il en ait envie ou non, choisir son camp.
Sous la menace du FLN et sous celle de l’armée française, dans une insoutenable
tension avec les voisins ou même les membres de la famille, Ali a cherché une
protection : « Il fait le
choix, se dira Naïma plus tard en lisant des témoignages qui pourraient être
(mais qui ne sont pas) ceux de son grand-père, d’être protégé d’assassins qu’il
déteste par d’autres assassins qu’il déteste. »
A l’indépendance, Ali se sent indésirable et en danger de
mort, réussit à fuir avec les siens vers la France qui n’a pas vraiment envie
de les accueillir et les parque dans un camp en attendant une illusoire
solution. Harki, c’est-à-dire, vu d’Algérie, collaborateur du pouvoir qui vient
d’être chassé, il n’en est pas moins, aux yeux d’un Français blessé d’une autre
manière par les événements, un « crouille ». Du genre que n’aime pas
un cafetier qui refuse de lui servir une bière malgré les médailles méritées
lors de la bataille de Monte Cassino qu’Ali a pris soin de s’épingler sur la
poitrine. Ce jour-là, un policier appelé par le tenancier pour dégager l’Arabe
lui sauve la mise : il a combattu au même endroit. Mais, en sortant du bar
où il a trinqué avec son compagnon d’armes, Ali sait qu’il n’y reviendra plus.
Riche propriétaire chassé par les circonstances, Ali est
devenu un petit ouvrier soumis à ses chefs, acceptant sa nouvelle et peu
enviable condition – bien obligé. Il n’en va pas de même pour Hamid, un de ses
fils, à qui l’apprentissage de la langue française, l’enseignement et des amis
permettent de refuser la résignation. D’autant que, laissé dans l’ignorance de
ce qui s’est réellement passé en Algérie, il s’est coupé de ses origines. A propos
des racines, il dit : « Les
miennes, elles sont ici. Je les ai déplacées avec moi. C’est des conneries, ces
histoires de racines. Tu as déjà vu un arbre pousser à des milliers de
kilomètres des siennes ? Moi j’ai grandi ici alors c’est ici qu’elles sont. »
Ici, c’est bien sûr la France.
Naïma, qui travaille dans une galerie d’art, est amenée à
essayer de démêler tout ça et à comprendre, avant de se rendre en Algérie sur
les traces d’un artiste que son patron, qui est aussi son amant, veut exposer.
Le voyage ne se fera pas sans inquiétude. Elle s’est renseignée sur Wikipédia,
elle est restée sur Internet pour lire les réactions haineuses qui pullulent
dès qu’il est question de harkis, elle s’est plongée dans des livres. Il lui
reste beaucoup de questions sans réponse.Alice Zeniter n’évacue rien de la complexité du sujet, des contradictions qui habitent les personnages – Lalla, le vieux peintre qui rêve d’être enterré en Algérie mais ne l’avouera jamais ! On imagine aisément que, comme Naïma qui est probablement son double, elle a dû puiser dans une documentation sans fin, regarder des vieux films d’actualité, écouter les uns et les autres. De cette abondante récolte, elle a nourri un roman qui, bien au-delà des informations, est une masse de chair irriguée de sang, un organisme vivant dont on admire la perfection esthétique en même temps qu’on est gagné par les émotions qui le traversent.
