Ce couple d’anthropologues américains, spécialistes de l’histoire afro-américaine, travaillent, depuis plus de cinquante ans, avec l’un des principaux peuples marrons du plateau des Guyanes, les Saamaka. Ils vivent entre la Martinique et Paris et se rendent chaque année en Guyane où ils continuent leur chemin avec les Saamaka, depuis que des menaces politiques leur interdisent l’accès au Suriname. Africultures a rencontré Richard et Sally Price.
Comment présenteriez-vous le peuple saamaka ?
Richard Price : Partout où il y a eu de l’esclavage, il y a eu du marronnage. Les plus grandes communautés de descendants de Marrons – des Africains qui se sont échappés du système esclavagiste- qui existent toujours se trouvent au Suriname. Au cours de la guerre civile du Suriname qui a eu lieu à la fin du XXème siècle, il y a eu une grande migration de ces Marrons vers la Guyane.
Il y a six nations de Marrons dans la région. Les plus grandes sont les Ndjuka et les Saamaka, chacune composée d’environ 100 000 personnes aujourd’hui. Ces peuples ont signé des traités de paix au XVIIIème siècle. Ils étaient libres 100 ans avant l’émancipation des esclaves au Suriname. Ils ont eu la possibilité de construire leur langue, leur culture, leur religion… sans grande influence des Européens. Dans ce sens-là, ce sont les plus africains de tous les peuples aux Amériques, mais en même temps, ils ne ressemblent à aucune société africaine. Il y a eu une créolisation interafricaine. Des gens venaient du Congo, de ce qui est devenu le Ghana, de l’ancien Dahomey,… de toute la côte ouest de l’Afrique. Ensemble, ils ont créé de nouvelles langues, de nouveaux systèmes politiques, de nouveaux arts plastiques que l’on ne voit nulle part ailleurs dans le monde.
Pourquoi avoir choisi, en 1966, de faire votre long terrain de recherche en pays saamaka et, de ce fait, de consacrer votre vie de chercheurs aux Saamaka ?
Sally : Richard s’intéressait alors aux processus au cours desquels les esclaves africains ont créé des cultures spécifiques. Lorsque nous avons regardé toutes les possibilités, du Canada au Brésil, nous avons constaté que les Marrons du Suriname étaient ceux qui avaient pu construire leur culture de la manière la plus indépendante. Des ethnologues hollandais avaient commencé à travailler avec les Ndjuka dans les années 1960, mais il n’y avait pas de chercheurs au pays saamaka, sauf une brève visite des Herskovits, un couple d’anthropologues fondateurs des études afro-américaines. Ils étaient venus dans les années 1920 et avait décrit ce peuple héroïque avec beaucoup de romantisme.
Dans Dreaming Saamaka, qui raconte vos deux années passées dans le village de Dangogo en pays saamaka, de 1966 à 1968, vous racontez que l’on vous donne accès à tous les pans de la culture, mais qu’il vous est interdit de vous intéresser aux Premiers temps. Pourtant en 1983, vous publiez en anglais un livre majeur sur le sujet, First-time, traduit en 1994 en français sous le titre : Les Premiers temps, la conception de l’histoire des Marrons saamaka. Que sont les Premiers temps ?
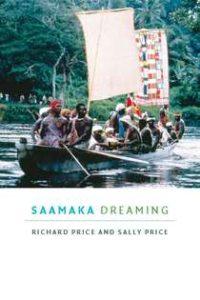
Il y avait une guerre continuelle. Des gangs de mercenaires armés, que les Hollandais faisaient venir d’Europe, ont lutté contre les Marrons dans la forêt pendant des décennies. A la fin, les Marrons ont gagné. Il y a eu des accords. Les colons versaient chaque année un tribut d’armes, de poudre, de balles, de casseroles, de tissus, d’aiguilles, de coutelas… aux Marrons, en échange de l’arrêt des raids sur les plantations de la côte où l’esclavage continuait.
Les Premiers temps sont tout ce qu’il s’est passé avant ce moment-là. C’est la partie de l’Histoire la plus appréciée et la plus sacrée. Dans chaque village, il y a des autels pour les ancêtres qui ont lutté pendant cette guerre. Quand il y a un malade, on trouve souvent, par divination, que c’est une personne du XVIIème-XVIIIème siècles qui a causé cette maladie. Les ancêtres des Premiers temps sont ainsi très présents dans la vie des Marrons jusqu’à aujourd’hui.
Le livre à ce sujet est paru en 1983. Que s’est-il passé entre cette date et votre premier séjour en pays saamaka ?
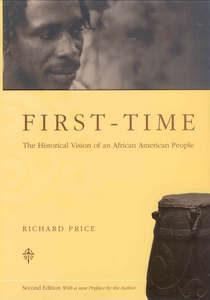
Sally : Richard avait fait des recherches poussées dans les archives du Pays-Bas, et il avait des connaissances à partager avec les historiens saamaka qui les intéressaient beaucoup. Ainsi la conversation sur le Fesiten est devenu un échange.
Richard : En 1975, les autorités saamaka m’ont demandé d’écrire l’histoire de Fesiten. Ce que je fis après beaucoup d’années de recherche dans les archives et avec les historiens saamaka qui détenaient l’histoire orale. Ce livre a été publié en anglais en 1983. En 2010, le peuple saamaka nous a demandé de traduire ce livre dans leur langue pour être le premier livre en saamakatongo. Nous avons mis deux ans pour le traduire avec l’aide d’un linguiste saamaka. (2) Le peuple saamaka en a acheté 3000 exemplaires pour le partager dans les écoles des villages parce que l’histoire de Fesiten est en train de disparaître.
En quoi la publication des Premiers temps a marqué un tournant historiographique ?
Richard : Il y est question d’événements du XVIIème siècle et du début du XVIIIème siècle transmis uniquement par la voie orale jusqu’à aujourd’hui. Dans ce livre, j’ai réuni sur la même page la version saamaka recueillie auprès des différents historiens saamaka et les données que j’ai trouvées dans les archives aux Pays-Bas pour les mêmes événements. Ce sont deux versions de la même histoire, vue de deux perspectives différentes. Dans le monde anglophone, l’ouvrage a été très bien reçu. Il a brisé quelques idées reçues. J’ai convaincu plusieurs historiens américains qu’il était possible de transmettre oralement, pas seulement une mythologie, mais aussi des histoires vraies au travers des siècles. Ce livre était pionnier en ce sens-là.
Comment avez-vous vu évoluer l’imaginaire du marronnage et les représentations des Marrons au cours des 50 dernières années ?
Sally : Jusqu’aux années 1970, personne n’avait considéré ensemble toutes les sociétés marronnes du monde. En 1973, Richard a dirigé un livre (3) qui parlait du phénomène du marronnage comme quelque chose qui n’était pas limité à un seul endroit.
Richard : On parlait déjà du marronnage il y a 50 ans. Les grands poètes et les Haïtiens notamment se disaient et se croyaient nèg marron. C’était une position idéologique mais peu basée sur des connaissances. En même temps pour les gens du peuple dans la Caraïbe, l’idée de nèg marron renvoyait à quelque chose de très sauvage. Parmi nos voisins à la Martinique, dire de quelqu’un qu’il était un nèg marron était une insulte. Dans le carnaval guyanais par exemple, il y a toujours le personnage du nèg marron, effrayant, avec le corps enduit d’huile et de charbon, qui n’est guère apprécié par les descendants de Marrons, qui sont très fiers de leur histoire de résistance et de rébellion.
Depuis 1986, vous n’avez pas pu vous rendre en pays saamaka au Suriname. Depuis trente ans, vous continuez votre travail ethnographique depuis la Guyane voisine. Qu’est-ce que cela implique ?
Richard : Nous ne pouvons plus aller au Suriname car le président Desi Bouterse, qui a mené le coup d’état en 1980, nous envoie des menaces de mort depuis que nous avons commencé à aider les Saamaka dans les procès où ces derniers ont porté plainte contre l’Etat du Suriname qui essaie de vendre leur terre à des multinationales. En 2007, la cour interaméricaine des droits de l’Homme a rendu un jugement en faveur des Saamaka contre l’Etat du Suriname, reconnaissant leurs droits ancestraux sur les terres (4).
Sally : Nous ne savons pas ce que nous aurions fait si nous avions pu continuer à nous rendre au Suriname, c’est un peu pour cela que nous avons écrit notre dernier livre, comme un retour, au moins en rêve au pays saamaka… (5) Chaque année, nous allons en Guyane où vivent beaucoup de Saamaka.
Quelle est la place occupée par les Marrons en Guyane ?
Richard : Aujourd’hui, nous constatons que, selon les statistiques de l’INSEE et nos propres recherches, les Marrons pris dans leur ensemble représentent 26 % de la population guyanaise. Avec au moins 35 000 Marrons sur 45 000 habitants, Saint-Laurent-du-Maroni est la plus grande ville marronne du monde.
Sally : Les Marrons, dont les Saamaka, y vivent globalement dans de moins bonnes conditions que les Guyanais, mais il y a beaucoup de variations au sein des Marrons. (6)
Richard : En 2000, nous avons fait connaissance avec un vieux Saamaka qui vivait à Cayenne depuis des décennies et nous sommes devenus de grands amis. La possibilité de m’entretenir pendant des années avec lui hors du pays saamaka nous a peut-être libéré, nous a permis de développer notre amitié et notre échange de connaissances plus librement qu’en pays saamaka, où il y a des contraintes sociales assez fortes. Il m’a appris des choses, notamment sur les rituels et sur les Premiers temps, que je ne connaissais pas du tout. (7) Le fait que nous ne puissions plus aller au Suriname ne nous a pas empêchés d’acquérir des connaissances et de publier.
Sally Price, vous avez également travaillé sur les représentations des arts dits « premiers » et avez finement analysé la vision essentialiste qui en est entretenue.
Mon intérêt dans ce domaine a commencé juste après notre terrain en pays saamaka. Nous étions commissaires pour une grande exposition itinérante aux Etats-Unis sur les arts des Marrons du Suriname. J’ai alors constaté que les gens avaient des idées fixes sur ce qu’est l’art d’une population noire qui vit pieds nus, dans les bois… qui contredisaient tout ce que nous avions appris auprès des Saamaka. Lorsque nous avons passé une année à Paris dans les années 1980, j’ai mené des entretiens avec les collectionneurs pour comprendre ce qu’était cette notion de soi-disant « art primitif ». Cela a donné le premier livre que j’ai écrit sur le sujet : Arts primitifs, regards civilisés, basé en grande partie sur des entretiens avec des collectionneurs à Paris. (8) C’est alors que le projet du musée du Quai Branly s’est mis en place…

Vous restez peu connus en France. Vous vivez pourtant entre la Martinique et Paris et vous travaillez en Guyane depuis 30 ans. Comment expliquez-vous cela ?
Sally : Nous sommes toujours les Américains ! (Elle rit.)
Richard : C’est une question compliquée, relative à la place des Afro-américains – de toutes les Amériques noires, pas uniquement des étasuniens – en France et dans l’imaginaire français. Cette place est très différente de ce qu’elle est aux Etats-Unis, en Angleterre ou encore aux Pays-Bas. Dans les années 1960 dans les universités américaines, beaucoup de professeurs et d’étudiants revendiquaient des cours sur la Caraïbe, sur l’Afrique, sur le Brésil… En France, rien, c’était toujours Louis XIV.
Dans les années 1980, à l’université des Antilles, les professeurs martiniquais étaient des spécialistes de l’histoire du XVIIIème siècle en France, du Moyen-Age en France, de la Révolution française… Lorsque j’ai enseigné à Nanterre en 1985, c’était le seul cours à Paris sur ce sujet-là, alors qu’en même temps il y en avait 200 aux Etats-Unis ! J’ai ainsi été sollicité pour écrire les articles sur le monde caribéen et les Amériques noires d’un grand dictionnaire d’ethnologie par Maurice Godelier car il n’y avait pas un seul spécialiste pour faire cela en France ! C’est une grande tradition française. Cela a changé. Des jeunes chercheurs travaillent désormais sur ces sujets, mais cela reste faible comparé aux Pays-Bas, à l’Angleterre ou aux Etats-Unis et ses grands départements d’études caribéennes. C’est pour cela qu’Edouard Glissant ou Maryse Condé ont été professeurs aux Etats-Unis et pas en France. C’est la même chose avec la lecture : s’il n’y a pas d’enseignements dans les universités, les lecteurs n’apprécieront pas les livres sur ces sujets.
C’est une question de racisme de deux types différents.
(1) First-time a été traduit et publié en France aux éditions du Seuil en 1994 sous le titre Les premiers temps. Il a été depuis republié par Vents d’ailleurs avec des améliorations, en 2013.
(2) Fesiten a été publié aux éditions Vents d’ailleurs en 2013. En 2016, Richard et Sally traduisent également en saamakatongo le livre Soirées de contes saamaka, Boo go a Kontukonde, aux éditions Vents d’ailleurs.
(3) Maroon societies : Rebel slave communities in the Americas, dirigé par Richard Price, paru en 1973.
(4) Richard Price raconte ce parcours dans Peuple Saramaka contre Etat du Suriname : Combat pour la forêt et les droits de l’homme, IRD & Karthala, 2012.
(5) Richard et Sally Price, Saamaka Dreaming, Duke University Press, 2017.
(6) Richard et Sally Price ont co-écrit Les Marrons, un livre synthétique présentant les peuples et cultures marronnes, destinés au lectorat français et notamment guyanais. Publié en 2003 chez Vents d’ailleurs, les Price travaillent actuellement à une nouvelle édition mise à jour de cet ouvrage.
(7) Richard Price, Voyages avec Tooy : Histoire, mémoire, imaginaire des Amériques noires, Vents d’ailleurs, 2010.
(8) Arts primitifs, regards civilisés est aujourd’hui traduit en huit langues et a été publié dans sa troisième édition en France par l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts en 2012.
(9) Sally Price, Au musée des illusions, le rendez-vous manqué du quai Branly, Editions Denoël, 2011.
