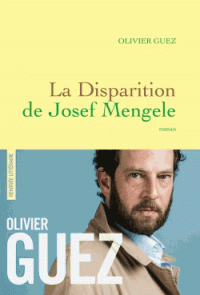 Avant l'annonce du Goncourt, Le Point a grillé tout le monde en présentant Olivier Guez, chroniqueur il est vrai dans ses colonnes, comme Lauréat du Prix Renaudot. Son roman La disparition de Josef Mengele est paru chez Grasset à la rentrée.
La confrontation avec une incarnation du mal peut être
éprouvante. Olivier Guez, en écrivant La
disparition de Josef Mengele, a traversé cette épreuve. Au tour maintenant
du lecteur, qui découvre le médecin nazi en Amérique du Sud dans ses années
d’exil, à partir de 1949. Il multiplie les identités, bénéficie de complicités
diverses, connaît une certaine fortune avant de sombrer. Mais jamais il ne
manifeste de remords. Accompagné de ses instruments de torture et de quelques
reliques de ses expériences, il se sent au contraire injustement condamné par
ceux qui l’accusent. Un incompris, voilà comment se sent l’homme qu’on accompagne
jusqu’à sa mort. Bien sûr, on ne le comprendra pas. Et cela vaut probablement
mieux.
En lisant votre
roman, on se pose en permanence deux questions. La première est extérieure au
livre, mais vous avez dû vous la poser : comment devient-on Josef
Mengele ?
D’après ce que j’ai
lu, son père était très absent. Ce n’est pas pour ça qu’on devient un criminel
contre l’humanité, mais ça définit une psychologie. Ensuite, il y a bien
évidemment l’influence du contexte historique. Il appartient à cette génération
de garçons ayant grandi pendant et après la Première Guerre mondiale. Il est le
prototype du jeune homme ambitieux de l’époque. Il faut comprendre que le
nazisme est un régime entièrement fondé sur la biologie, c’est une
bio-politique. Et, lorsque vous êtes un jeune médecin, vous appartenez à
l’élite de l’élite du régime, dans un nouveau cadre. Mengele a une
responsabilité individuelle, mais il ne faut pas oublier que c’est son
directeur de thèse qui lui propose d’aller à Auschwitz. Après, c’est lui qui
accepte…
La seconde question
obsédante en cours de lecture, c’est : comment reste-t-on Josef Mengele,
sans remords ?
Il reste fidèle à sa
vision du monde.
La dernière
confrontation avec son fils est éclairante. A-t-elle eu lieu ou bien est-une
une liberté romanesque ?
Non, elle a eu lieu. A
partir du moment où je parle de Josef Mengele dans un livre, je suis obligé de
suivre et de respecter au maximum la vérité historique. Sinon je fais comme
Joseph Littell, et je crée un héros dans le genre des Bienveillantes, un personnage composite où il a pris un
peu à l’un et à l’autre.
En même temps, il
reste des zones d’ombre que seule la forme romanesque permettait d’approcher…
Il y a très peu de
choses que j’ai inventées. Je vous donne un exemple. D’après tout ce que j’ai
lu, je suis convaincu que Mengele a eu une relation avec Gitta Stammer, la
Hongroise. Après coup, je n’en sais rien et personne ne le saura jamais. Le
romancier s’empare de cette histoire, mais je ne l’ai pas inventé. C’est ce que
Truman Capote appelait un roman de non-fiction. Par ailleurs, je ne sais pas
vraiment à quoi il pense sur le pont du North King quand il arrive à Buenos Aires et je l’imagine. Voilà aussi pourquoi
c’est un roman.
Aussi peut-être parce
que la traque de Mengele se fait en partie après sa mort, comme une chasse au
fantôme ?
Oui, il est mort,
personne ne le sait et c’est à ce moment-là qu’on se met véritablement à le
chercher. C’est proprement hallucinant dans cette trajectoire. Avec une morale
de l’histoire étonnante, quand les derniers os de Mengele sont confiés à la
science.
N’avez-vous pas
éprouvé, à certains moments, du dégoût pour le personnage, et une envie de vous
en détourner ?
Avant l'annonce du Goncourt, Le Point a grillé tout le monde en présentant Olivier Guez, chroniqueur il est vrai dans ses colonnes, comme Lauréat du Prix Renaudot. Son roman La disparition de Josef Mengele est paru chez Grasset à la rentrée.
La confrontation avec une incarnation du mal peut être
éprouvante. Olivier Guez, en écrivant La
disparition de Josef Mengele, a traversé cette épreuve. Au tour maintenant
du lecteur, qui découvre le médecin nazi en Amérique du Sud dans ses années
d’exil, à partir de 1949. Il multiplie les identités, bénéficie de complicités
diverses, connaît une certaine fortune avant de sombrer. Mais jamais il ne
manifeste de remords. Accompagné de ses instruments de torture et de quelques
reliques de ses expériences, il se sent au contraire injustement condamné par
ceux qui l’accusent. Un incompris, voilà comment se sent l’homme qu’on accompagne
jusqu’à sa mort. Bien sûr, on ne le comprendra pas. Et cela vaut probablement
mieux.
En lisant votre
roman, on se pose en permanence deux questions. La première est extérieure au
livre, mais vous avez dû vous la poser : comment devient-on Josef
Mengele ?
D’après ce que j’ai
lu, son père était très absent. Ce n’est pas pour ça qu’on devient un criminel
contre l’humanité, mais ça définit une psychologie. Ensuite, il y a bien
évidemment l’influence du contexte historique. Il appartient à cette génération
de garçons ayant grandi pendant et après la Première Guerre mondiale. Il est le
prototype du jeune homme ambitieux de l’époque. Il faut comprendre que le
nazisme est un régime entièrement fondé sur la biologie, c’est une
bio-politique. Et, lorsque vous êtes un jeune médecin, vous appartenez à
l’élite de l’élite du régime, dans un nouveau cadre. Mengele a une
responsabilité individuelle, mais il ne faut pas oublier que c’est son
directeur de thèse qui lui propose d’aller à Auschwitz. Après, c’est lui qui
accepte…
La seconde question
obsédante en cours de lecture, c’est : comment reste-t-on Josef Mengele,
sans remords ?
Il reste fidèle à sa
vision du monde.
La dernière
confrontation avec son fils est éclairante. A-t-elle eu lieu ou bien est-une
une liberté romanesque ?
Non, elle a eu lieu. A
partir du moment où je parle de Josef Mengele dans un livre, je suis obligé de
suivre et de respecter au maximum la vérité historique. Sinon je fais comme
Joseph Littell, et je crée un héros dans le genre des Bienveillantes, un personnage composite où il a pris un
peu à l’un et à l’autre.
En même temps, il
reste des zones d’ombre que seule la forme romanesque permettait d’approcher…
Il y a très peu de
choses que j’ai inventées. Je vous donne un exemple. D’après tout ce que j’ai
lu, je suis convaincu que Mengele a eu une relation avec Gitta Stammer, la
Hongroise. Après coup, je n’en sais rien et personne ne le saura jamais. Le
romancier s’empare de cette histoire, mais je ne l’ai pas inventé. C’est ce que
Truman Capote appelait un roman de non-fiction. Par ailleurs, je ne sais pas
vraiment à quoi il pense sur le pont du North King quand il arrive à Buenos Aires et je l’imagine. Voilà aussi pourquoi
c’est un roman.
Aussi peut-être parce
que la traque de Mengele se fait en partie après sa mort, comme une chasse au
fantôme ?
Oui, il est mort,
personne ne le sait et c’est à ce moment-là qu’on se met véritablement à le
chercher. C’est proprement hallucinant dans cette trajectoire. Avec une morale
de l’histoire étonnante, quand les derniers os de Mengele sont confiés à la
science.
N’avez-vous pas
éprouvé, à certains moments, du dégoût pour le personnage, et une envie de vous
en détourner ?Il y a eu trois phases. Jusqu’à présent, je m’étais intéressé aux victimes, à des héros positifs. Mais, en écrivant le scénario de Fritz Bauer, un héros allemand, j’ai beaucoup lu sur l’Argentine des années 50, je suis à plusieurs reprises tombé sur Mengele. Je savais comme tout le monde qu’il n’avait pas été arrêté et je me suis demandé ce qu’avait été sa vie, sur laquelle beaucoup d’histoires avaient circulé. C’était plutôt excitant. Ensuite, j’ai tourné autour. Quand il a fallu monter sur le ring, ça a été terrible ! J’ai eu l’impression de devenir la marionnette de Mengele. Et puis, à partir du moment où j’ai compris comment j’allais raconter cette histoire-là, dix ans de dolce vita et vingt ans de chute abyssale, j’ai repris le dessus sur lui.
Par ailleurs, le Renaudot essai va à Justine Augier pour De l'ardeur (Actes Sud, à la fête aujourd'hui), un document poignant sur la Syrie d'aujourd'hui et plus particulièrement sur une femme avocate, journaliste, activiste des droits de l'homme, disparue depuis presque quatre ans, Razan Zaitouneh.
Et le Renaudot poche confirme l'existence de la filière entre l'autoédition et l'édition traditionnelle, Louisiane C. Dor ayant publié d'abord Les méduses ont-elles sommeil? chez Amazon avant d'être repérée par Gallimard et d'entrer cette année dans la catalogue Folio.
