Après son premier roman, Terre ceinte (Présence Africaine), salué par la critique et récompensé par de nombreux prix, Mohamed Mbougar Sarr vient de publier Silence du chœur, chez le même éditeur.
Le jeune auteur sénégalais se saisit d’un sujet plus qu’actuel, la migration clandestine vers l’Europe avec son lot de drames. Au moment où la crise migratoire devient un débat de société en Europe, le roman va au delà du simple jugement moral, de la prise de position pour accueillir les réfugiés ou d’un coup de gueule contre les délires identitaires qui essaiment sur le lit de la misère humaine. Ce n’est pas un roman humaniste, mais un roman humain.
Mbougar Sarr nous conduit dans l’itinéraire des ragazzi (joli clin d’œil à Pasolini), ces hommes qui ont fui la misère et le quotidien difficile en Afrique pour aller, par des embarcations de fortune, à l’assaut de la forteresse européenne. À Altino, petite bourgade sans histoire nichée en plein cœur de la Sicile, les ragazzi ne laissent personne indifférent. Ils bouleversent un fragile équilibre en inspirant la pitié chez les uns et la haine chez les autres.
Mais Mbougar Sarr évite la facilité d’un roman « de gauche », humaniste, qui se préoccupe de peindre des Noirs écartelés entre les bons d’un coté (ONG, associations et hommes politiques de gauche) et les méchants (militants fascistes, commerçants racistes, voyous, etc.) Il puise chez chaque personnage, qui représente un pan des sociétés européennes face au drame des « migrants », des ressorts profonds qui expliquent sa vision du monde, son attitude face à ces gens que la mer a crachés sur leur sol.
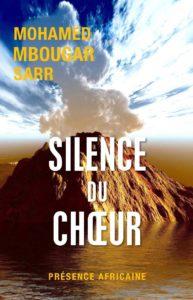
Dans leur drame, l’auteur n’extirpe pas toutefois les ragazzi de leur condition d’homme. Ils ne sont ni pires ni meilleurs que les autres partagés entre ouverture et fermeté. Chez ces migrants comme chez leurs ennemis, il y a la violence, la candeur, la virilité, l’égoïsme et l’ingratitude. À la haine du chef du courant fasciste d’Altino répond celle d’un migrant rescapé de Boko Haram. Tous deux sont nourris à la même source de la mort, à des milliers de kilomètres de distance et dans des circonstances différentes.
Sur plus de 400 pages, Silence du chœur ne traine pas la carcasse du pauvre africain brimé par les méchants fachos européens. L’auteur humanise ces migrants, leur donne des noms, des envies, des sentiments et des défauts. Il les fait exister et les forge avec une précision et une lucidité implacables.
Le roman interroge aussi, dans le style classique et agréable de l’auteur, la notion d’accueil : pourquoi aide-t-on des inconnus ? Pour Dieu ? Pour un dividende politique ? Pour des subventions ? Pour l’inspiration artistique ? Ou pire, pour la bonne conscience humaniste ?
Mbougar Sarr a écrit un grand roman où son érudition rencontre ses goûts (le football, Maria Callas, Goya) et ses lectures marquantes (Dante, Arendt, Pasolini et bien entendu Balzac). Il nous gratifie aussi d’un acte d’écriture réussi qui nous entraine dans plusieurs paysages stylistiques. L’auteur casse aussi les codes d’un texte uniforme en empruntant des procédés mythologiques issus du théâtre. Il évoque aussi la traduction symbole de l’échec des hommes à se comprendre, mais également promesse d’une aube nouvelle qui charriera une langue de l’universel, celle de l’horizontalité, de la compréhension mutuelle. Ce passage rappelle un texte du philosophe Souleymane Bachir Diagne sur la langue des langues : la traduction.
Silence du chœur refuse au lecteur la place confortable de spectateur face à la linéarité romanesque, froide. Il s’agit d’un enchâssement de récits, une conjonction d’humanités, de personnages qui, chacun nous interpelle, et nous invite à la compassion ou la défiance, en tout cas la réaction. L’auteur nous refuse la neutralité et nous interpelle pour rompre toute distance de raison. Enfin, l’auteur pose une interrogation actuelle et lourde de sens que devront féconder les débats des écrivains et penseurs dans les prochaines années : pourquoi les artistes écrivent-ils encore quand tout le monde se sent digne d’écrire ? Quelle valeur la littérature a-t-elle aujourd’hui ? Les réponses seront apportées peut-être dans un prochain roman de Mbougar Sarr qui ne se détache pour l’instant, à aucun moment, d’une haute exigence de la littérature.
