 Le patriote russe Lebedeff
Le patriote russe Lebedeff
Le gérant du ministère de la Marine russe, M. Lebedeff, qui vient de donner sa démission pour se consacrer à la formation de corps de volontaires, en accord avec le généralissime Korniloff, est une figure des plus intéressantes. Notre collaborateur Albert Londres a connu M. Lebedeff à Salonique, alors qu’il était lieutenant de la légion étrangère ; il évoque pour nous dans cet article quelques souvenirs de ce patriote qui aideront peut-être à comprendre l’âme de la nouvelle Russie dirigeante.
Un soir, à Salonique, un ami me présenta un lieutenant, il portait l’uniforme français et la croix de guerre. Son nom, comme toujours, se perdit dans les moustaches de l’introducteur, je n’en dis pas moins : — Enchanté. Et l’on s’assit. On parla. L’officier français à la croix de guerre s’exprimait parfaitement dans notre langue mais avait un accent affecté. Comme je m’en étonnais. — Notre ami est Russe, reprit l’introducteur. — Alors, dis-je, répétez-moi le nom, car j’étais distrait. L’officier à la croix de guerre se représenta lui-même : — Lebedeff. On alla dîner ensemble. Lebedeff était jeunes, les yeux troublants. Où qu’il fût, il donnait l’impression d’être ailleurs, il semblait vivre d’une autre vie que de celle qu’il vivait. On devint tout de suite camarades. — Vous êtes Français, me disait-il avait envie. Ah ! la France, mon ami ! Et, dévoilant son caractère mystérieux, sans transition il ajoutait : — Moi, je vivais en Italie. On dînait. Il se mit à parler bizarrement. Il sautait d’un sujet léger aux grands problèmes sociaux. Et ces problèmes il les traitait avec une fantaisie déroutante. Cependant, parfois, un mot profond perçait. Ce mot s’échappait d’une telle atmosphère que, malgré sa justesse, il fallait le peser plusieurs fois en dedans de soi pour constater qu’il n’était pas faux. Je le revis. Une nuit il me prit par le bras et tout le long de l’avenue de la Reine-Olga m’accompagna trois kilomètres. — Vous avez fait la guerre russo-japonaise, lui dis-je ? — Oui. — D’une façon épatante, même ! Et comme s’il répondait directement à ma question, du même ton il répliqua : — L’avenir est un haut fourneau, il est bien difficile de savoir ce qui s’y cuit. Et pourtant, je m’en doute. — Lebedeff, lui dis-je, vous me plaisez, mais vous êtes un peu fou. — Non, mon ami, mais votre folie à vous, Français, remonte à plus d’un siècle, elle est devenue depuis de la sagesse ; la nôtre est jeune, et un enfant ne sait pas toujours se modérer en société. — Pourquoi viviez-vous en Italie, Lebedeff ? — Je suis révolutionnaire. On ne vous l’a pas dit ? — Vous étiez un révolutionnaire actif ? Lebedeff, de son accent mignard, détourna la conversation. Il avouait bien qu’il était révolutionnaire, mais ne consentait pas à découvrir ni comment, ni pourquoi, ni avec qui. On eût dit qu’il se retranchait derrière un secret professionnel. Entre sa révolution et le monde il avait fait tomber un rideau de fer. Ce n’était ni par pudeur, ni par calcul qu’il ne se lançait pas sur ses projets de chambardement du monde, c’était par passion intérieure. Ça le dévorait, il ne pensait qu’à cela, ses regards, ses silences ne faisaient que le crier, il ne l’avouait jamais. C’est par lui que j’entendis pour la première fois prononcer le nom de Kerensky. C’était un autre soir, car Lebedeff n’aimait pas se coucher de bonne heure. Il marchait longtemps sous le clair de lune d’Orient. — Eh bien ! vos amis vous donnent-ils des nouvelles de la Russie ? — Je n’en ai pas besoin. Je sais. — Que savez-vous ? — Ce que vous autres, trop vieux, vous ne savez pas. Il y a des forces qui ne peuvent plus tenir dans leur enveloppe et qui éclateront. — Vous avez des hommes prêts à des rôles en Russie ? — Kerensky. Je n’avais pas parfaitement saisi le nom. — Kerensky. Comme s’il en avait trop dit, il se remit à parler de la guerre. — L’Allemagne, déclara-t-il dans un de ses apartés mystérieux, c’est l’obstacle à tout. Puis, un matin, il vint à moi : — Venez m’offrir quelque chose, je m’en vais. — Où allez-vous ? — En Russie. — Pas vrai ? — Si. Je viens même de prendre congé du général Sarrail… — Reviendrez-vous ? — Je vais revoir l’Italie, la France, dans un mois je serai à Petrograd. — Vous n’êtes donc plus révolutionnaire ? Il ne répondit rien. Il savait. C’était quarante jours avant le grand soir.
Le Petit Journal
, 8 septembre 1917.Aux Editions de la Bibliothèque malgache, la collection Bibliothèque 1914-1918, qui accueillera le moment venu les articles d'Albert Londres sur la Grande Guerre, rassemble des textes de cette période. 21 titres sont parus, dont voici les couvertures des plus récents:
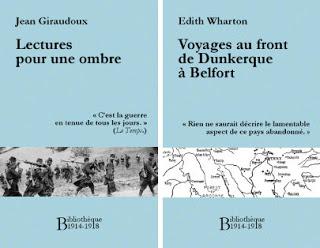
Dans la même collection
Jean Giraudoux Lectures pour une ombre Edith Wharton Voyages au front de Dunkerque à Belfort Georges Ohnet Journal d’un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914. Intégrale ou tous les fascicules (de 1 à 17) en autant de volumes Isabelle Rimbaud Dans les remous de la bataille
