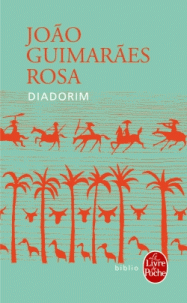 Diadorim est un long monologue, tenu sans faiblir sur 900
pages (au format de poche de cette réédition). Riobaldo y raconte sa vie
aventureuse et amoureuse, avec un élan impossible à contenir et dans un
désordre auquel il faut bien se faire, d’autant qu’il nous demande si gentiment
de le lui pardonner : « Veuillez
m’excuser, je sais que je parle trop, des à-côtés. Je dérape. C’est le fait de
la vieillesse. » Mais aussi, qu’est-ce qui vaut et qu’est-ce qui ne
vaut pas ? Tout. En effet, comment choisir parmi les souvenirs quand tout
revient à la surface de la mémoire avec la même force ? Le problème, c’est
que la mémoire, bien qu’elle fasse mine de trier des informations reçues n’accomplit
ce travail qu’avec une fantaisie pour le moins légère. Et c’est cette légèreté
même, appliquée jusqu’aux choses les plus graves, qui permet de tout faire
passer.
En même temps, l’écrivain João Guimarães Rosa s’est
trouvé une bonne raison à ce désordre. Ce n’est pas lui qui parle, c’est son
personnage. Et son personnage dit : « Pardonnez
ces licences maladroites dans ma narration. C’est l’ignorance. Je ne converse, ou
presque, avec personne de l’extérieur. Je ne sais pas raconter selon les règles.
J’ai un peu appris avec mon compère Quelemém ; mais il veut tout savoir
différemment : ce qu’il veut ce n’est pas l’affaire en soi, en elle-même, mais
le suc de la chose, l’autre-chose. » Voilà la clé : tous ces
détours ne sont pas là pour égarer, mais pour éclairer.
João Guimarães Rosa situe Diadorim, un roman publié en 1956, à la fin du siècle dernier, dans
une région bien précise du Brésil, – et ceci compte davantage encore que cela
–, dans le Minas-Geraïs, dans un paysage géographique qui s’étend, depuis l’ouest
de Bahia, et le Goïas, jusqu’aux Etats du Piaui et du Maranhao. Faudrait-il une
carte ? Pas du tout : il est question, l’auteur le souligne lui-même,
d’un paysage. Qu’on sache donc seulement ce qu’est ce paysage : des « veretas »,
mot que la traductrice a rendu, selon les cas, par clairière, fond de vallée, parfois
basse-plaine, etc. Dans cette oasis où pousse une espèce de palmier, le buriti,
la fertilité attise les convoitises. Et à une époque où les propriétaires sont
prêts à se battre, voire même à lever de véritables armées, pour défendre ou
conquérir leur bien, on imagine l’importance de tel lieu. Il constitue la clé
du roman – une des clés car, comme le soulignait Mario Vargas Llosa, le plus
bel éloge qu’on puisse faire à ce roman est d’être ambigu, multiple, destiné à
durer, difficilement saisissable dans sa totalité, trompeur et fascinant comme
la vie immédiate, profond et inépuisable comme la réalité elle-même.
Une autre clé serait le lien de nature
homosexuelle qui lie le narrateur, Rio Baldo, à son ami Diadorim : plus qu’un
ami, un amant de cœur, avec la violence de la jalousie qui se manifeste
régulièrement.
Diadorim est un long monologue, tenu sans faiblir sur 900
pages (au format de poche de cette réédition). Riobaldo y raconte sa vie
aventureuse et amoureuse, avec un élan impossible à contenir et dans un
désordre auquel il faut bien se faire, d’autant qu’il nous demande si gentiment
de le lui pardonner : « Veuillez
m’excuser, je sais que je parle trop, des à-côtés. Je dérape. C’est le fait de
la vieillesse. » Mais aussi, qu’est-ce qui vaut et qu’est-ce qui ne
vaut pas ? Tout. En effet, comment choisir parmi les souvenirs quand tout
revient à la surface de la mémoire avec la même force ? Le problème, c’est
que la mémoire, bien qu’elle fasse mine de trier des informations reçues n’accomplit
ce travail qu’avec une fantaisie pour le moins légère. Et c’est cette légèreté
même, appliquée jusqu’aux choses les plus graves, qui permet de tout faire
passer.
En même temps, l’écrivain João Guimarães Rosa s’est
trouvé une bonne raison à ce désordre. Ce n’est pas lui qui parle, c’est son
personnage. Et son personnage dit : « Pardonnez
ces licences maladroites dans ma narration. C’est l’ignorance. Je ne converse, ou
presque, avec personne de l’extérieur. Je ne sais pas raconter selon les règles.
J’ai un peu appris avec mon compère Quelemém ; mais il veut tout savoir
différemment : ce qu’il veut ce n’est pas l’affaire en soi, en elle-même, mais
le suc de la chose, l’autre-chose. » Voilà la clé : tous ces
détours ne sont pas là pour égarer, mais pour éclairer.
João Guimarães Rosa situe Diadorim, un roman publié en 1956, à la fin du siècle dernier, dans
une région bien précise du Brésil, – et ceci compte davantage encore que cela
–, dans le Minas-Geraïs, dans un paysage géographique qui s’étend, depuis l’ouest
de Bahia, et le Goïas, jusqu’aux Etats du Piaui et du Maranhao. Faudrait-il une
carte ? Pas du tout : il est question, l’auteur le souligne lui-même,
d’un paysage. Qu’on sache donc seulement ce qu’est ce paysage : des « veretas »,
mot que la traductrice a rendu, selon les cas, par clairière, fond de vallée, parfois
basse-plaine, etc. Dans cette oasis où pousse une espèce de palmier, le buriti,
la fertilité attise les convoitises. Et à une époque où les propriétaires sont
prêts à se battre, voire même à lever de véritables armées, pour défendre ou
conquérir leur bien, on imagine l’importance de tel lieu. Il constitue la clé
du roman – une des clés car, comme le soulignait Mario Vargas Llosa, le plus
bel éloge qu’on puisse faire à ce roman est d’être ambigu, multiple, destiné à
durer, difficilement saisissable dans sa totalité, trompeur et fascinant comme
la vie immédiate, profond et inépuisable comme la réalité elle-même.
Une autre clé serait le lien de nature
homosexuelle qui lie le narrateur, Rio Baldo, à son ami Diadorim : plus qu’un
ami, un amant de cœur, avec la violence de la jalousie qui se manifeste
régulièrement.On y verra aussi le récit presque mystique d’un pacte avec le diable. On y verra, à travers des scènes guerrières dites parfois, avec un sens aigu du paradoxe, pacifique, une leçon d’humanité, sans complaisance ni maladresse. On y verra, pour être simple, tout ce qu’on veut, tant on y trouve de facettes complémentaires d’une existence envisagée dans sa totalité : livre total, Diadorim est en effet inépuisable.
