Romancière, poète, mais aussi organisatrice du « Festival de la palabra » de Porto Rico, Mayra Santos-Febres était de passage en France pour accompagner la publication de son premier roman traduit en français, Silena Selena. Publié en version originale en 2000, il vient de sortir aux Editions Zulma. L’auteure nous plonge dans les quartiers populaires de Porto Rico, dans le quotidien de la communauté gay et trans.
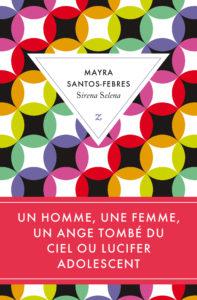
Dans ce manuscrit, vous nous plongez avec des descriptions fines dans son quotidien et celui de ses proches. Le discours sur les opérations concernant le changement de sexe, les astuces du maquillage, de l’épilation, les débrouilles de la vie de tous les jours, entre drogue, prostitutions, vols, croyances religieuses et vie familiale sont décrits avec une grande proximité. Comment avez-vous connu de près cette réalité ? Vous êtes-vous documentée ?
Au moment où j’ai écrit ce roman, l’épidémie de SIDA était vraiment violente sur l’île de Porto Rico. Et en tant qu’écrivaine j’avais beaucoup d’amis, danseurs et peintres gays, qui se sont engagés comme activistes contre la prolifération du SIDA. Il y a eu une publication très importante « SIDA AORA » en espagnol, la première en Amérique Latine et c’était vraiment important parce qu’on y trouvait des informations très précises, les directives des docteurs, car dans les années 80 et 90 beaucoup de médecins ne touchaient même pas aux malades de ce virus…Donc, quand l’idée de cette nouvelle est née dans ma tête, j’avais accès, comme activiste et comme journaliste, à leurs vies. J’ai donc fait beaucoup de recherches, je cherchais des livres d’histoires, articles de documentation, sur la population des gays et des travestis. Mais je n’ai rien trouvé concernant les années 80 et 90. Donc j’ai commencé à copier les interviews que j’ai pu avoir avec eux, sans savoir exactement ce que j’allais faire avec. Je ne pouvais pas écrire un livre d’histoire, j’ai donc écrit un roman. Je n’ai pas voulu dire leurs noms, pour respecter leur intimité. Certains m’ont laissé les mentionner, mais la majorité est sous pseudonyme. J’ai mélangé la fiction avec beaucoup de recherches.Pour ce qui concerne la spiritualité, je suis portoricaine et je la pratique, je crois à la connexion, dans le monde, des forces de la nature, comme je les décris dans le roman. Je suis « santera ». La prière de la pierre par exemple, je la connais car elle m’a été enseignée par ma grand-mère. Je suis issue d’une culture pour laquelle tout est connectée, je viens d’une façon de percevoir et ressentir le monde et la vie différente de ceux qui pensent que les choses sont divisées, (le corps divisé du cerveau etc). Et j’ai étudié tout cela, pour pouvoir créer un cursus épistémologie voulant analyser de façon spéculaire les philosophies de l’ouest des philosophies afro-centriste. Je n’ai pas peur d’être considérée une primitive avec un PHD. Je suis les deux.
Pourquoi concernant les transexuels et travestis de l’histoire jonglez-vous entre « il » et « elle » en parlant de chaque personnage ?
Parce que c’est la façon dont ils parlent d’eux /d’elles-mêmes. En espagnol on a un genre pour tous les mots, et eux ils changent le genre des personnes comme des objets. Ils/Elles le font selon leur apparence ou les moments où ils parlent. Et j’ai voulu recréer cette ambivalence. C’est comme si il s’agissait d’un roman travesti ! Lui aussi !
Dans plusieurs passages de votre roman Sirena Selena vous traitez des scènes érotiques avec une certaine poésie, malgré les conditions dans lesquelles elles se déploient. A un moment d’ailleurs Martha affirme « Pour nous l’essentiel a toujours été de nier la réalité grossière qui nous entourait » Pourquoi avez-vous choisi ce registre qui sublime les faits ?
Je pense que c’est une question éthique. Je n’ai jamais aimé la spectacularisation de la misère et du malheur des autres personnes. Je n’aime vraiment pas « épater les bourgeois » (rires). Je comprends si quelqu’un d’autre veut le faire et je le respecte complètement, ces écrivains ont leur place dans le monde, parce que des fois les choses doivent être nommées, mais il faut aussi faire très attention aux sentiments des gens. Pas le lecteur forcement, mais la personne que tu es en train d’imaginer. Ce personnage qui peut être tellement de gens à la fois. Beaucoup de personnes ont lu Sirena Selena et sont venues me voir et m’ont dit « Tu as écrit ma vie. Et merci de ne pas m’avoir rendu un monstre. J’étais cet enfant et il m’est arrivé la même chose ». J’ai pris des parties de vies de beaucoup de gens par-ci par-là, et c’est peut-être pour ça qu’il y a une si forte identification entre certains lecteurs et les protagonistes de mon roman. Beaucoup de personnes me l’ont dit, hommes comme femmes : « J’ai fait beaucoup de choses que je regrette pour pouvoir survivre, j’ai fait beaucoup de choses que je regrette pour être une personne et merci d’avoir écrit cette histoire ». Donc quand j’écris de ces situations voilà… Je n’ai aucun problème avec le sexe, je pense que c’est magnifique, que les personnes devraient en faire le plus possible, (rires) La vie n’est pas courte, mais c’est important de le vivre. Plein d’auteurs ont abordé ce genre de scènes, par exemple Jean Genet, Henry Miller, Raymond Carver, le mouvement du « realismo soucio », le cubain Pedro Juan Gutiérrez, et plein d’autres écrivains qui peuvent le faire dans des façon magnifiques. De sublimer ces scènes est la façon dans laquelle je peux le faire moi. De m’approcher, m’approcher, mais au final ouvrir et laisser l’imagination du lecteur, sans lui dire exactement ce qu’il se passe. Je n’aime pas diriger vers la réalité crue de l’acte. Les lecteurs peuvent le deviner d’eux même.
Dans votre roman on parle de l’orphelinat comme de l’un des cercles de l’enfer, lieu où l’on abuse des enfants, on les tabasse et viole. Cette réalité, qui jette une lumière sombre sur l’Aide Sociale à l’Enfance, est-elle une constante de Porto Rico ?
C’est un traitement commun à plusieurs endroits dans le monde où j’ai été. Les enfants sont les plus fragiles de la communauté. La première priorité pour tout le monde devrait être de prendre soin des enfants. Si les gamins perdent leur famille, qu’ils se retrouvent dehors dans la rue, ils sont livrés à la prostitution, qui est vraiment commune au Brésil, à Porto Rico, aussi bien qu’aux abus. Voilà un des secrets dont personne ne veut parler et qui représente un gros problème, par exemple, dans le département des affaires familiales. Ils prennent les enfants des familles et ils les mettent dans d’autres familles, qui sont payées. Certaines entre elles, une minorité, font leur travail, mais la plupart ne le fait pas. Et la première des violences qu’endurent ces enfants indigents est celle d’être sexuellement exploités. On voit ça dans beaucoup d’endroits dans le monde, par exemple en Inde, mais aussi à Bogotà, ou dans le sud du Méxique. Peut-être que c’est parce que c’est un sujet douloureux, mais il faut souligner que peu de romans parle de ça, et pourtant c’est tellement répandu ! C’est quelque chose que nous ne voulons pas regarder. Donc pour moi c’était impossible de raconter l’histoire sans cet aspect social. Et d’aborder donc un problème plus global des droits de l’enfant… De parler de ces pays où c’est absolument légal de marier un enfant de quatorze avec une autre de neuf ans. C’est quelque chose de complètement anormal, mais qui est devenu usuel. Et passer de ça au crime, c’est juste une étape. Dans le cadre de la prostitution il y a toujours quelqu’un prêt à acheter ces beautés angéliques à la sexualité douteuse : ces enfants que nous avons aussi été, que tout le monde est, à un moment de sa vie. C’est à cause de la culture patriarcale. Et c’est horrible. Je dois être très attentive dans la façon de le dire et de traiter ce sujet qui concerne une certaine partie de la population.
La voix mélodieuse possédée, sauve la vie à Sirena Selena. C’est une voix qui existe avant tout pour elle, mais qu’elle met, pour gagner de l’argent, à disposition de son public. Que symbolise-t-il le chant, dans ce roman ?
Je viens d’une culture musicale. Si tu penses à la culture afrodiasporique, une des plus importantes contributions que nous avons données au monde a été la musique. Je me réfère au blues, au jazz, le jazz tu vois ! La nouvelle musique classique du monde ! Et puis le rock, le zouk, la salsa, la bomba, la bachata, le brasilian bossanova… Et encore beaucoup d’autres ! (rires). C’est une façon mathématique de regarder le monde, une manière différente de penser au concept du temps, parce que la musique c’est le son organisé dans une façon qui créé une particulière expérience du temps. Il ne s’agit pas de la routine de la productivité, mais d’un autre temps, magique, qui ouvre la danse et le chant des gens.

Et personnellement, je viens d’un endroit où, avant d’apprendre comment parler, tu es en train de chanter, et avant de savoir comment marcher correctement, tu es en train de danser. Je me souviens de mon père mettant mes pieds sur les siens et me montrer comment on danse la rumba, la salsa… Et cela avant que j’aie trois ans ! C’est un des premiers souvenirs de ma vie ! Donc tu vois, à la source de mes souvenirs il n’y a pas un livre, mais un son. Ou encore, ma mère chantant un boléro pendant qu’elle arrosait les plantes. Ou pensons encore aux fêtes de Noël, où tout le monde prenait un instrument ou un objet quelconque et n’importe qui devenait un musicien. La musique est un moyen de créer une communauté et de créer des narrations. Parce qu’à travers le texte de la chanson tu racontes ce qu’il s’est passé dans ta communauté, « mataron el nergo… » (elle chante) : c’est la chanson d’un homme qui a été tué dans une confrontation raciale, dans un lieu et une île particulière, qu’on connait. Voilà ce que c’est de chanter. Et tu entends ces voix magnifiques dans les églises, dans les rues… Si tu viens à Porto Rico tu entends la musique de partout. Et dans le roman, j’ai voulu recréer cette ambiance. Et en plus, Sirena Selena, elle/il a quinze ans et apparaît comme une diva.
Pourquoi les femmes de ce milieu s’appellent-elle réciproquement « les folles »?
Personnellement j’aime être une femme folle. Et je pense, plus généralement, qu’être une femme c’est de la folie. C’est à cause du fait que le patriarcat a été en place pour si longtemps. Malgré le fait que les femmes aient gagné des droits civils, et que surtout celles ayant accès à la classe moyenne, et donc à l’éducation, puissent travailler et élever des enfants en même temps,- je pense que c’est tellement exagéré tout ce qu’on doit gérer, que des fois tu deviens un peu folle quand même. Car tu as trop de choses contre lesquelles et pour lesquelles tu dois lutter en même temps ! Tellement de négociations à faire! Des négociations avec la famille, des négociations avec le père, avec la mère, des négociations avec ton propre corps, des négociations avec le savoir, tu vois, parce que si tu es une femme passionnée par la culture et la connaissance, les personnes te regardent avec crainte. Ils sont effrayés par les femmes cultivées. Puis les hommes ne te considèrent plus de la même façon, ou ils te disent « Je peux te parler comme je parle à d’autres hommes » et t’as envie de répondre : « Excuse-moi, et qu’est-ce que je vais faire avec cette information ? ». De la sorte : « Ah parce que je peux parler, maintenant je deviens un homme à tes yeux? ». Moi je ne veux pas être ton égal, je veux seulement que justice soit faite. Je ne suis pas un homme. La façon dont je décide d’être une femme doit être respectée dans le monde. Par exemple, maintenant nous avons le même accès au travail. Et donc, où tu laisses tes enfants quand tu travailles ? Si il n’y a pas d’école, tu ne peux pas prendre tes enfants et les donner à une nurserie qui les garde pendant le temps que tu travailles ? Le féminisme n’a pas lutté pour ça. In Porto Rico si tu as un enfant, tu as le congé maternité, mais pas les hommes. C’est injuste car ces gens aussi ont un enfant. Si tu penses que les droits civiques de la femme ont été établis en 1954 par les Nations Unies !!! C’était hier ! Et on est encore à lutter pour avoir droit à l’avortement : en Honduras par exemple il est illégal. Et si tu es kidnappée et violée et que tu avorte, tu prends 30 ans de prison… Et donc tu ne penses pas que vivre toutes ces choses assez bizarres ne te rendent folle à un moment ? Je suis égale, mais je ne peux pas faire ça, ni ça, ni ça… Comment négocier tout cela ? Je peux aller à l’université, avoir une carrière, mais je vais être regardée bizarrement par les miens, et des femmes aussi, si je décide d’avoir un enfant, comme si c’était une maladie. On m’a déjà dit que je ne pouvais pas participer à des conférences car j’avais un enfant en bas âge. Je leur ai dit qu’il fallait qu’ils se démerdent pour me permettre de venir avec mon fils. J’ai porté une vie humaine dans ce monde, ce qui est bien plus important qu’un congrès littéraire ! (rires)
Quand vous écrivez, pensez-vous davantage à un public de lecteurs plutôt local ou étranger ou les deux ?
Dans la pensée afrodiasporique, au niveau épistémologique, nous croyons au fait que l’« un est un mais multiple à la fois ». Par exemple, quand nous pensions à la famille, c’est une famille oui, mais c’est aussi un clan, une plus vaste communauté, un pays. Il n’y a pas vraiment de séparation, c’est un continuum. Donc moi, quand j’écris, je cherche toujours à diriger mon message à un lecteur particulier, mais le lecteur est une multiplication… Par exemple quand j’ai écrit Sirena Selena, le point de départ c’était de parler de ce jeune homme très efféminé, et qui voulait être une diva de la chanson pour sortir de la pauvreté. Donc il s’agit d’une manière d’être tout de même assez particulière. Mais en effet j’ai pensé au Caribéens, à quel point ils sont similaires, avec leur culture, à l’histoire de ce jeune homme. Parce que nous, les Caribéens, nous sommes toujours en train de « nous habiller comme » quelqu’un que nous ne sommes pas. Nous sommes tous des travestis. Nous, les femmes, quand nous sortons de la douche, « nous ne sommes pas des femmes » (rires), on se maquille, on se dessine les yeux, les lèvres, tout ça pour sembler plus professionnelles par exemple, et nous situer dans le monde d’une façon d’être précise… La mise en scène de notre identité devient une action faisant partie d’une mascarade ! Nous avons grande conscience du tourisme économique grâce auquel nous survivons. C’est marrant quand tu observes les personnes qui sont en train de te regarder, tu sais que ton identité n’est pas complètement la tienne, mais toujours en relation avec ces gens qui viennent de l’extérieur. Et alors tu t’habilles « à la portoricaine » car tu veux sembler autochtone ou tu mets de la kératine dans les cheveux et tu les lisses si tu es une femme noire, tu enlèves la noirceur de la peau pour apparaître plus claire et donc plus « professionnelle » à l’instar des européennes. Et toutes ces actes de mascarade de ton identité ou, au contraire, qui pointent les différences ont à faire à la relation au monde. Donc je fais la même chose dans la narration : il s’agit de représenter par exemple la voix d’une chanteuse, d’une « bolerista » qui veut séduire l’audience, mais également de personnifier milles autres manières d’être, de telle sorte qu’on puisse rentrer dans le roman de différentes façon, qui ont toutes le même point de départ, c’est-à-dire ce que tu es, comme lecteur. Si tu es un homme, tu le lis d’une certaine façon, si tu es une femme, d’une autre, si tu viens des Caraïbes, si tu viens d’Afrique ou de sa diaspora d’un autre endroit encore. Je tiens beaucoup donc, dans mon écriture, à faire en sorte que les personnes puissent y entrer de manières différentes.
En voyant votre parcours il est assez naturel de vous demander si vous vous sentez plus romancière ou poète.
En fait je me sens écrivaine. J’écris par n’importe quel moyen je trouve. Mon premier roman est sorti quand j’étais en train de faire une transition entre la poésie et la narration, voilà pourquoi Sirena Selena est si poétique. J’ai écrit de la poésie, des opéras, des scénarios, des séries télé, des livres pour enfants, des essais académiques ou d’opinion et également un essai philosophique, des récits – je ne sais pas si je suis très bonne en ce format mais je l’ai expérimenté quand même… Donc voilà, je suis une écrivaine. Tu me dis quoi écrire et je trouverai le moyen afin que l’histoire te donne ce dont tu attends d’un sujet. Il faut être patiente, détaillée, mais finalement je trouve la façon juste de l’écrire, et c’est du travail, il faut du polissage, du polissage, du polissage… Tu dois connaître cela en tant que journaliste ! Et le format des articles change continuellement selon les personnes à qui tu as à faire, comme aussi les relations qui ont produit ces textes te donnent la façon dont ils doivent être écrits.
En octobre vous présiderez la 8ème édition du Festival de la Palabra, né en 2010. A ce moment-là vous aviez déjà publié 8 œuvres entre recueil de nouvelles, poèmes et romans – et vous décidiez de créer le Festival de la Palabra dans la ville de San Juan. Pourquoi ?
J’ai beaucoup voyagé. Notamment après la publication de Sirena Selena, qui a été traduit, entre autre, en italien par Mondadori. Après tous ces voyages et rencontres, je me suis dit qu’il fallait trouver le moyen d’amener toutes ces connections sur l’île. Une île relativement isolée. Nous sommes entre nous. Mes voyages m’avaient offert une vision de fraternité plus ample que celle que nous avions à l’époque. Puis, en 2010, il y a eu une grève d’étudiants particulièrement violente. Je suis professeur à l’université de Porto Rico, donc j’ai vécu ça de près. L’université a été occupée, les hélicoptères tournaient dans le ciel, les étudiants ont fermé la faculté et ont commencé une autogestion. Le débat a été tellement dramatique que voilà…en février 2010 j’ai décidé d’organiser ce festival. J’y ai invité Paco Ignacio Taibo du Mexique, des écrivains francophones, des écrivains d’Haïti, de la Guadeloupe, de Martinique, puis Patrick Deville de la Maison des Ecrivains… Pour ce premier festival nous avions convié toutes les personnes qu’on pouvait. Paco Ignacio marchait avec les étudiants. Nous voulions ouvrir non tant l’université en soi, mais l’île entière au monde. Voilà comme ce festival est né.
Un mot qui revient dans votre présentation du festival c’est l’internationalisation de la littérature portoricaine. Pourquoi est-il important pour vous de sortir de l’île et mondialiser vos créations ?
Je suis très contente de voir que mes livres sont vendus à l’étranger, à travers plusieurs maisons d’éditions. Qu’ils aient eu cette chance. Je suis une des très rares auteures portoricaines traduite en français, en anglais et dans d’autres langues. C’est vraiment important car Porto Rico n’est pas connu, ni sa littérature, ni son art ni sa musique. . Et ce n’est pas une spécificité de Porto Rico ou du Paraguay… ça arrive pour d’autres pays aussi. Par exemple on ne connait pas beaucoup de littérature venant de la Guinée équatoriale, l’un des rares pays africains où l’on parle espagnol. Je pense que pour la grandeur de l’être et la compréhension mutuelle nous devons connaître la culture, les désirs, les espoirs, les rêves des autres personnes dans le monde. Nous sommes plus similaires que différents. Le pouvoir exploite les différences, pas les similitudes. Il en exclut certains des besoins primaires, comme la nourriture, la boisson, l’eau, les droits civils, l’éducation. Et cela, en raison généralement de différences. Donc je pense que la culture est une des façons les plus puissantes de traduire les différences en points communs. C’est pour cela que c’est si important pour moi de contribuer de cette manière et de dire voilà ce que nous sommes dans les Caraïbes et en particulier à Porto Rico, colonie des Etats Unis, pays qui a la moitié de ses habitants en dehors de l’île. Et cela est une réalité que nous avons en partage avec d’autres pays dans le monde. Si tu regardes au-delà de la superficialité de la différence tu peux voir les points communs. A travers la littérature, je pense le faire, à ma manière avec mes spécificités, ma propre voix, tout en mettant les écrivains en contact les uns avec les autres. Nous pouvons donc créer une communion, une communauté de bons traducteurs des mutuelles différences.
Est-ce que la rencontre entre les agents littéraires et les talents émergents, lors du festival, a donné lieu à des collaborations qui durent jusqu’ici ?
Oh oui. Nous avons eu beaucoup d’inputs positifs. Chaque année nous publions une anthologie. Il y a par exemple des maisons d’édition à Brooklyn, New York et en Turquie. On a aussi une anthologie qui s’appelle « Someone noir ». Il y a « Kingston noire », « Naples noire »… Il s’agit d’une collection d’histoires noires venant des différentes villes importantes du monde. Nous les avions invités au Festival et ils y sont venus. Nous avons aussi des prix littéraires. Par exemple « Les nouvelles voix portoricaines ». Ça fait sept ans qu’on fait le festival et chaque année on renouvelle nos engagements et trouvons des nouveautés à proposer. Nous avons aussi une anthologie de littérature portoricaine qui est traduite en coréen et en français, en lien avec la « Maison des écrivains étrangers et traducteurs de Saint-Nazaire » de Patrick Deville, et beaucoup d’autres collaborations avec le Pérou, la Colombie, l’Espagne les Etats Unis, et bien évidemment la France. Et aussi, une des choses que nous aimerions faire prochainement est d’inviter plus d’écrivains africains à Porto Rico, de la Guinée Equatoriale, du Cap Vert. C’est très important de chercher à créer un point de rencontre lors du Festival.
Dans les objectifs de votre Festival on voit à quel point le partenariat avec l’école est important. Pensez-vous que l’Education est la première base solide d’une potentielle créativité artistique et littéraire ?
Je pense que l’éducation c’est une première base solide pour tout. Si tu n’as pas d’éducation tu n’as pas grande chose. Nous vivons dans un monde qui est en grand besoin de services spécialisés et de production de savoir. A partir de ça nous devons produire certaines choses spécifiques comme des machines, des nouvelles technologies, mais la production du savoir est très importante pour la durabilité du monde. Et aussi la production de « comment créer une communauté qui soit soutenable et vivable pour tout le monde ». Une des choses les plus importantes est de trouver les savoirs qui ont marché dans une ville et les amener dans une autre, un système solaire qu’on amène à un autre endroit, un plan urbain qu’on amène à un autre endroit. La possibilité d’accéder à la connaissance est à la base de l’éducation : on doit avoir l’école et l’université, mais également des concerts, des musées ouverts pour toute la communauté… La culture n’est pas quelque chose qui vient de l’élite, ou que tu peux acheter, ce n’est pas non plus un objet. C’est une façon d’être et de produire de la valeur. A cet effet, l’éduction est vraiment importante. Pour cela, au Festival de la Palabra nous avons des partenariats avec 150 écoles et 6 milliers d’étudiants. Il faut savoir que je suis également lectrice… Les écrivains ne sont pas forcément amenés à parler de ce qu’ils écrivent, mais ils partagent leur passion pour la lecture, et de n’importe quel bouquin. Par exemple, des livres de cuisine ! De navigation, d’astronomie ! Tout ce qui les amène à avoir envie de créer des nouveaux mondes et communiquer des nouveaux messages aux gens qui, à leur tour, feront la même chose. Je n’arrive vraiment pas à imaginer un monde où l’éducation et la santé ne constituent pas les créations basiques pour une communauté en santé mentale, physique, sociale… C’est pour ça que la littérature n’est surement pas un privilège, un produit du capitalisme culturel, comme si tu avais ta carte visa de la culture qui dit que tu es mieux que moi parce que tu lis Shakespeare : qui s’en soucie ? Est-ce qu’au moins tu comprends Shakespeare ? (rire) Parce que peut-être que moi aussi je l’ai lu – ou pas ! Pourquoi utiliser la culture dans ce sens alors que la culture aujourd’hui doit vraiment être au service et à l’avantage de l’humanité dans sa globalité ! Je pense que l’art et les sciences sont des façons participatives de donner la possibilité d’être éduquée, cultivée. C’est comme un jeu, par exemple au Festival des gens viennent avec leur livre, ou les choses qu’ils ont pensées, ou des marionnettes, ou autre chose provenant de l’interaction avec d’autres écrivains et personnes venu d’ailleurs. Ça c’est stimuler la curiosité au lieu de la passivité typique de l’éducation traditionnelle. Il ne faut pas que boire les informations, mais faire en sorte que les personnes se sentent en mesure de contribuer avec quelque chose qu’ils ont pensé. Qu’il s’agisse d’une machine pour nettoyer l’eau, ou pour transporter des gens, tout ça nait d’un rêve, d’un moment d’imagination ! Et il faut encourager cette imagination pour que les choses adviennent, surtout dans les pays en phase de développement.
