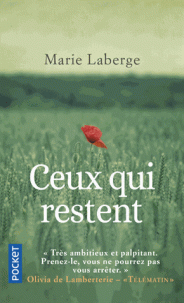 La romancière québécoise Marie Laberge, qui travaille aussi beaucoup
pour le théâtre, ne déteste pas les sujets graves. Mais jamais traités de
manière théorique. Elle prend ses personnages comme ils sont, avec aussi leur
manière de parler parfois surprenante quand on ne pratique pas le vocabulaire
local. Et leur dessine des trajectoires complexes.
Le suicide est un choix personnel. Il ne tient pas toujours
compte des conséquences sur les proches, Ceuxqui restent, comme les appelle Marie Laberge en titre de son nouveau roman.
Sylvain s’est tué en 2000. Mélanie-Lyne, sa veuve, tente de protéger leur fils,
Stéphane, qui échappe de plus en plus à son influence. Charlène, qui était la
maîtresse de Sylvain, se souvient des moments partagés. Vincent, le père du
disparu, regarde décliner son épouse Muguette, dont il est séparé, et devient
un habitué du bar où officie Charlène. Ceux qui restent, donc, suivent les
trajectoires choisies par la romancière. Elle leur fournit de multiples
occasions de rencontres et de méprises, ainsi que les armes pour faire, tant
bien que mal, leur deuil.
De retour sous dans une maison d’édition française après
avoir déjà publié quelques romans à Paris il y a une dizaine d’années,
l’écrivaine n’a fait aucune concession linguistique au public non québécois. On
lit par exemple, à la fin du premier paragraphe : « Faut-tu être tarte ! Faut-tu vouloir ! » Le
sens de certaines expressions utilisées par Charlène nous échappe. Cela
méritait une explication, avant toute autre question.
Cela vous échappe
peut-être dans le sens précis des termes, mais pas en ce qui concerne leur
force émotive. Les niveaux de langage sont importants. Pour un Québécois moyen,
lire Charlène, c’est comme recevoir une insulte. Les jeunes sont plus enclins à
comprendre ce type de violence verbale. Mais, si on saisit Charlène dans sa
charge verbale, on comprend quelque chose d’important chez elle.
Vous aviez décidé
d’écrire un roman autour du suicide ?
Surtout sur ceux qui
restent. C’est le suicide qui déclenche l’intérêt que j’ai pour ces gens. Quand
un coup de tonnerre pareil arrive dans une vie, l’orage ne laisse pas le
paysage intact. Quand on réussit à absorber le choc, le moment présent et la
vie gagnent en intensité.
Les relations entre
vos personnages font un sac de nœuds assez complexe…
C’est vrai, je suis
d’accord. Ce n’est pas ce que je voulais. Je ne pars jamais avec un plan. Au
début, j’ai un point très fort, avec des personnages assez nets dans mon cœur,
et je les laisse aller, je m’y abandonne. Je ne les prends pas en otages, c’est
eux qui me ravissent, dans tous les sens du terme : ils me prennent en
otage et ils me font aussi plaisir.
Est-ce que l’écriture
pour le théâtre, qu’on connaît en Europe où plusieurs de vos pièces ont été
montées, influence vos romans ?
Sûrement, et je pense
que c’est dans ce roman que cela apparaît le plus nettement. Le fait d’avoir
trois personnages qui s’adressent eux-mêmes au lecteur, avec des niveaux de
langage si précis, vient probablement de l’oralité du théâtre qui fait qu’un
personnage s’exprime dans son choix de mots et dans son rythme. Oui, c’est un
héritage du théâtre… De la même manière, comme au théâtre, on est dans le
présent, dans ce qui se passe, dans ce qui se dit, et que le lecteur en tire
ses conclusions.
Le roman est paru au
Québec un an avant son édition française. Comment réagissent les
lecteurs ?
La romancière québécoise Marie Laberge, qui travaille aussi beaucoup
pour le théâtre, ne déteste pas les sujets graves. Mais jamais traités de
manière théorique. Elle prend ses personnages comme ils sont, avec aussi leur
manière de parler parfois surprenante quand on ne pratique pas le vocabulaire
local. Et leur dessine des trajectoires complexes.
Le suicide est un choix personnel. Il ne tient pas toujours
compte des conséquences sur les proches, Ceuxqui restent, comme les appelle Marie Laberge en titre de son nouveau roman.
Sylvain s’est tué en 2000. Mélanie-Lyne, sa veuve, tente de protéger leur fils,
Stéphane, qui échappe de plus en plus à son influence. Charlène, qui était la
maîtresse de Sylvain, se souvient des moments partagés. Vincent, le père du
disparu, regarde décliner son épouse Muguette, dont il est séparé, et devient
un habitué du bar où officie Charlène. Ceux qui restent, donc, suivent les
trajectoires choisies par la romancière. Elle leur fournit de multiples
occasions de rencontres et de méprises, ainsi que les armes pour faire, tant
bien que mal, leur deuil.
De retour sous dans une maison d’édition française après
avoir déjà publié quelques romans à Paris il y a une dizaine d’années,
l’écrivaine n’a fait aucune concession linguistique au public non québécois. On
lit par exemple, à la fin du premier paragraphe : « Faut-tu être tarte ! Faut-tu vouloir ! » Le
sens de certaines expressions utilisées par Charlène nous échappe. Cela
méritait une explication, avant toute autre question.
Cela vous échappe
peut-être dans le sens précis des termes, mais pas en ce qui concerne leur
force émotive. Les niveaux de langage sont importants. Pour un Québécois moyen,
lire Charlène, c’est comme recevoir une insulte. Les jeunes sont plus enclins à
comprendre ce type de violence verbale. Mais, si on saisit Charlène dans sa
charge verbale, on comprend quelque chose d’important chez elle.
Vous aviez décidé
d’écrire un roman autour du suicide ?
Surtout sur ceux qui
restent. C’est le suicide qui déclenche l’intérêt que j’ai pour ces gens. Quand
un coup de tonnerre pareil arrive dans une vie, l’orage ne laisse pas le
paysage intact. Quand on réussit à absorber le choc, le moment présent et la
vie gagnent en intensité.
Les relations entre
vos personnages font un sac de nœuds assez complexe…
C’est vrai, je suis
d’accord. Ce n’est pas ce que je voulais. Je ne pars jamais avec un plan. Au
début, j’ai un point très fort, avec des personnages assez nets dans mon cœur,
et je les laisse aller, je m’y abandonne. Je ne les prends pas en otages, c’est
eux qui me ravissent, dans tous les sens du terme : ils me prennent en
otage et ils me font aussi plaisir.
Est-ce que l’écriture
pour le théâtre, qu’on connaît en Europe où plusieurs de vos pièces ont été
montées, influence vos romans ?
Sûrement, et je pense
que c’est dans ce roman que cela apparaît le plus nettement. Le fait d’avoir
trois personnages qui s’adressent eux-mêmes au lecteur, avec des niveaux de
langage si précis, vient probablement de l’oralité du théâtre qui fait qu’un
personnage s’exprime dans son choix de mots et dans son rythme. Oui, c’est un
héritage du théâtre… De la même manière, comme au théâtre, on est dans le
présent, dans ce qui se passe, dans ce qui se dit, et que le lecteur en tire
ses conclusions.
Le roman est paru au
Québec un an avant son édition française. Comment réagissent les
lecteurs ?Autant il y a de façons de faire son deuil, autant le roman a touché les lecteurs de façons différentes. J’ai de très belles réactions de lecteurs qui m’ont approché avec une immense confiance et cela me fait un bien fou en même temps que cela crée beaucoup d’émotion.
