 Comment Constantin se soumit
Les vingt-quatre heures de colère impuissante
Comment Constantin se soumit
Les vingt-quatre heures de colère impuissante
(De l’envoyé spécial du Petit Journal.) Athènes. (Suite.) Donc, lundi 11, à deux heures, il abdique, – plutôt il passe la main, remarquez qu’il n’a pas abdiqué. À 2 h. 10, les anciens présidents et les ministres sortent du palais. Nous en abordons un. — Émouvant, dit-il, et il ajoute : « Non, je ne puis pas en dire plus long, j’ai le cœur trop plein. » Constantin a passé la main. Le conseil de la Couronne et nous, sommes les seuls à le savoir. Comment la ville le prendra-t-elle ? Quatre heures, cinq heures, les journaux n’annoncent rien. Après cinq heures, subitement, la physionomie de la ville est retournée. On la voit pâlir comme un vrai visage : la ville sait. Alors tout s’enchevêtre. Cent événements différents actionnés par un même mobile n’ont plus l’air d’en faire qu’un seul. Une première bande formée on ne sait où, forte de trois cents hommes, précédée comme d’un tambour-major, d’un véritable géant, vient vers le palais. En passant devant l’hôtel Grande-Bretagne, séjour des étrangers, ils lancent des regards haineux. Tous les Européens qui, à un titre quelconque, travaillèrent au détrônement du roi habitèrent cet hôtel. C’est lui qui reçoit les premiers contre-coups. Les bandes circulent mais ne s’arrêtent pas. Les journaux vénizélistes ne sont pas encore assiégés. Nous gagnons la Patris. « Le Tocsin » Un rédacteur entre essoufflé et crie : « Les épistrates courent aux cloches, on va sonner le tocsin. » La ville s’anime, se peuple et grouille plus fort de minute en minute. 6 h. 40, voilà le tocsin ! C’est une cloche d’abord au son aigre ; celui qui l’agite y va à tour de bras, elle ne tinte pas, elle bredouille, tellement elle se presse. Puis en voici une autre, puis une troisième, puis nous ne les comptons plus : c’est le tocsin. C’est comme si un crêpe vous tombait sur l’âme. Le visage de la ville change encore de couleur ; soudain elle se souvient. On voit repasser sur lui les terreurs du 1er décembre. La foule revoit du sang. Elle fuit, sans savoir où, sans savoir pourquoi. Elle se lève, apeurée, des terrasses des cafés, des pâtisseries. Beaucoup ont trouvé des voitures et, assis, se penchent en avant come pour aider le cheval. Les gens riches se précipitent sur les autos pour filer. Le tocsin plane sur cette panique, il est 7 h. 15 : une allumette dans cette paille et il semble que tout va flamber. Zaïmis a promis que l’ordre ne serait pas troublé. Mais Zaïmis a fait prévenir les chefs et les tient à l’œil. Les officiers blêmes, n’ayant pas reçu de mot d’ordre sont dans les rues comme des statues de sel. Livieratos, le chef des énergumènes, est avec les siens devant le palais. Le palais est entouré par la foule. Livieratos veut voir le roi. À la tête d’une délégation, il franchit les grilles du palais. Un frère du roi le reçoit. « Rien n’est définitif, dit le prince. S. M. vous demande de ne pas troubler l’ordre. Évitez un irréparable malheur à la patrie. » Les irréparables malheurs sont près d’ici : nos canons, nos autos blindées, nos troupes sont sur les eaux bleues du Phalère. Et la foule toujours plus dense, dense jusqu’à être bientôt toute la ville, monte, monte, vers le palais. La nuit tombe là-dessus. Pas un soldat, pas une patrouille. Dans la nuit Huit heures, neuf heures, la foule monte, monte. Elle est faite maintenant d’hommes, de femmes, d’enfants. Son aspect a changé. Entre cinq et sept, sous le tocsin, elle était agressive ; elle devient promeneuse. Elle passe, passe sans arrêt devant le palais. Elle a l’air de défiler devant un catafalque. Les cinémas, les cafés, les théâtres sont fermés. Est-ce que les troupes françaises vont débarquer ? La ville s’allume. Les officiers se rendent tous au club. Ils ne peuvent pas croire qu’ils ne peuvent rien. Ils vont se consulter. La foule défile toujours. Les portes, les fenêtres du cercle militaire sont grandes ouvertes. L’armée paraît vouloir délibérer au grand jour. Des épistrates essayent de soulever la rue ; la rue ne répond pas. Les officiers en uniforme blanc se promènent fébrilement sous les lumières des salles du cercle. Tous les galons de la garnison d’Athènes sont réunis là. Ils viennent de déléguer quinze d’entre eux pour aller demander des instructions au roi. Ces quinze sortent. Il est dix heures. Ils vont à pied, ce n’est pas loin. Ils font une tache blanche dans la nuit ; ils vont demander la permission d’en faire de rouges. Ils marchent à travers le peuple, et arrivent devant les grilles du palais ; des épistrates y sont accrochés. « Qu’on les laisse entrer », crient-ils. Ils entrent. Un frère du roi les reçoit. « Gardez votre épée, leur dit-il, autrement d’effroyables malheurs tomberont sur la patrie. » Ils s’en reviennent. Le cercle les attend, piétinant. Ils rendent compte de leur mission. Au dehors, on suit le jeu. Et, surexcités, ils recommencent à se promener sous les lumières. Le peuple défile toujours devant le catafalque… devant le palais, veux-je dire. Au seuil de la violence À minuit – l’heure n’est pas inventée : c’est bien à minuit – Livieratos, le sanguinaire, se présente au club des officiers. Il veut les entraîner au palais. « Nous en venons, disent les officiers ; l’ordre est de ne rien faire. » — Passons sur l’ordre ! crie Livieratos, et ses éclats de voix s’entendent à 100 mètres sur le trottoir. « Passons sur l’ordre, vengeons le roi, refaisons le 1er décembre. » Mais les officiers s’en tiennent à l’ordre. Ce qui prouve qu’au 1er décembre, ils s’y étaient tenus et que l’ordre était de tirer. Livieratos sort du club. Le tocsin, subitement dans l’obscurité, se remet à sonner. La nuit ajoute à son effet. Trente excités s’écrient : « Chez Lampsas ! » Lampsas est le propriétaire de l’hôtel Grande-Bretagne, mitraillé le 1er décembre. Ils répètent : « Chez Lampsas ! » Mais ils ne sont plus que dix en arrivant à la porte. Les ordres n’y sont pas, ni peut-être le désir. Le tocsin ne produit pas son effet ; on sent vraiment dès cette minute qu’il n’y aura pas de sang : l’affaire a été bien menée. Le premier matin arrive. Les journaux peuvent être vendus. Il n’est pas un seul homme sur les dix milliers que nous croisons qui ait le nez en l’air. Tous sont plongés dans un journal qu’engloutit leur regard. Les journaux ont sur le coup changé de politique ; ils qualifient l’heure « d’heure de la suprême sagesse ». Le peuple avale sans grimace la nouvelle pilule. Il pense visiblement : « Si c’est le remède qui doit nous guérir, avalons ! » La matinée avance. Aucun magasin n’ouvre ses portes, la ville processionne toujours vers le palais. Le roi doit partir à midi. « Il ne partira pas, crient les épistrates qui entourent le palais ; nous l’empêcherons de sortir. » Et ces centaines d’hommes vont tenir huit heures la ville en haleine. À dix heures, le métropolite arrive en voiture pour faire prêter serment au nouveau roi. Ils détournent sa voiture et le forcent à repartir. À 10 heures et demie, trois ministres se présentent à la grille. « Vous allez faire évader notre roi », disent-ils. Ils les prennent par les épaules et les obligent au demi-tour. Plus tard, un des leurs, Stratos, apparaît. « Pourquoi dans le conseil de la Couronne, n’as-tu pas dissuadé le roi d’abdiquer ? » Et ils le rossent. Le roi essaye le dernier moyen Mais on apprend que le roi, qui devait partir à midi, ne quittera pas son palais. Il ne peut pas, dit-il. La foule l’en empêche. Visiblement, la foule ne l’en empêche pas. Sont-ce les complications qui commencent ? La ville sait cela. Immédiatement, la fièvre la reprend. Des autos roulent à toute vitesse au Phalère. On va prévenir M. Jonnart. Midi. Le roi n’est pas parti. Une panique reprend la ville. On croit que tout recommence. On entend des gens qui crient : « Toute l’armée vient de se joindre aux épistrates. » C’était simplement une patrouille qui causait avec eux. C’est tout de même grave. Le roi prétend qu’il veut bien partir, mais qu’il ne le peut pas. Deux heures et il est encore là. Et voilà qu’un bruit s’empare de la ville : « Constantin, crie-t-on, est malade ! Sa plaie s’est rouverte ! » Le peuple s’excite. À l’École française, où siège notre mission, on perçoit tout le danger. Il n’y a plus de temps à perdre, il faut tailler hardiment. Un avion apparaît. C’est notre premier avertissement. C’est peu et beaucoup : il montre que nous supportons bien d’être patients une heure, mais pas deux. Allons ! nous devons en arriver au grand moyen. Le général Regnault doit débarquer nos troupes. Elles débarquent. Les Français ! Route de Phalère, voilà les Français ! Ils passent, devant les deux palaces de la plage. Des palaces, poilus ! Des dames aux grands yeux d’Orient qui vous regardent ! des enfants élégants qui jouent sur le sable ; la mer, l’Acropole. Ah ! poilus, quelle g… vous avez dans ce décor ! C’était le remède. Nos troupes, joyeuses, avancent sur la grande route propre. À leur approche, les postes grecs courent pour disparaître plus vite. À quatre heures et demie, émerveillées, elles sont à trois kilomètres d’Athènes : Constantin va subitement mieux. Cinq heures ! Des cris percent une foule : « Zito ! Zito ! » L’âme d’Athènes s’exhale une dernière fois. C’est Constantin, en pékin, qui démarre. (À suivre.)
Le Petit Journal, 28 juin 1917.
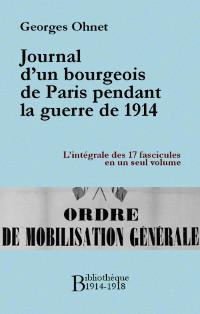 La Bibliothèque malgache publie une collection numérique, Bibliothèque 1914-1918, dans laquelle Albert Londres aura sa place, le moment venu.
Isabelle Rimbaud y a déjà la sienne, avec Dans les remous de la bataille, le récit des deux premiers mois de la guerre.
Et Georges Ohnet, avec son Journal d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914, dont le dix-septième et dernier volume est paru, en même temps que l'intégrale de cette volumineuse chronique - 2176 pages dans l'édition papier.
La Bibliothèque malgache publie une collection numérique, Bibliothèque 1914-1918, dans laquelle Albert Londres aura sa place, le moment venu.
Isabelle Rimbaud y a déjà la sienne, avec Dans les remous de la bataille, le récit des deux premiers mois de la guerre.
Et Georges Ohnet, avec son Journal d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914, dont le dix-septième et dernier volume est paru, en même temps que l'intégrale de cette volumineuse chronique - 2176 pages dans l'édition papier.
