 Comment Constantin se soumit…
Comment Constantin se soumit…
Les télégrammes de notre envoyé spécial, M. Albert Londres, nous ont résumé les incidents qui ont marqué le départ d’Athènes du roi Constantin. Mais l’histoire de ce roi qui tombe vaut d’être connue dans les détails. Notre collaborateur, qui l’a vue et vécue, nous en adresse le récit plein de couleur dans les pages qu’on va lire. Athènes, juin. Depuis six mois, l’honneur de la France traînait dans la poussière de Grèce ; il vient de se relever. Athènes étouffait sous le malaise ; la ville sentait qu’elle touchait à une fin. Le pays étranglé par la haine et la famine ne pouvait plus respirer. Le pendu, arrivé à son dernier souffle de vie, de ses propres mains, pour avoir de l’air, commençait à se déchirer la gorge. M. Jonnart arriva et le dépendit. Le dimanche 3 juin, Constantin, en grand plumet, sortit dans la ville. C’était sa fête ; on lui chantait un Te Deum à la métropole ; il allait l’entendre. Il était en daumont, la reine Sophie à ses côtés. Il saluait, il souriait, mais ce salut et ce sourire étaient tels que Constantin semblait être une figure immobile sur laquelle un mécanisme faisait passer de temps en temps un mouvement et un rictus. Il s’était, avant de sortir, maquillé d’amabilité. Le peuple ne s’y trompa pas. — C’est sa dernière fête, dit à mes côtés un tondeur de chiens. Ce tondeur de chiens ne pâlissait pas les nuits sur la politique, il comprenait cependant ce que d’autres personnes – il ne s’agit pas de M. Guillemin – dont c’était le métier, n’arrivaient pas à entendre. « Zonnart ! » Le 4 juin, rien ; quelques hoquetements du pendu seulement. Le 5, un nom éclate dans la ville : Jonnart ! plutôt Zonnart avec un Z. Il n’était pas dans les journaux mais sur toutes les langues – avec un Z. On n’entendait plus que Zonnart, Zonnart. Le 6, la presse boche, en grande manchette imprimait : « Zonnart vient mettre les traîtres à la raison ». Les traîtres, c’étaient nos amis. Il est vrai qu’en Grèce nous en avions vu d’autres. Où était Jonnart ? On ne parlait que de lui, on ne le voyait jamais. Ce fut le commencement du trouble pour les Grecs. Un homme qui est tout puissant et invisible comme Dieu ne pouvait être qu’un diable. M. Jonnart était sur un bateau, à Keratsini. Il y recevait les ministres de l’Entente puis nos attachés militaires. « Où est Jonnart ? où est Jonnart » se demanda, le 7, tout Athènes. M. Jonnart était devenu le nombril de la ville. On ne pouvait plus s’en passer. Mais il avait gagné Salonique. Athènes l’apprit et pâlit. « Si Jonnart est à Salonique, ce n’est pas un ami » se dit-elle. Athènes l’avait déjà vu embrassant le roi et Zaïmis, dînant chez l’un, dansant chez l’autre et roulé par les deux. Et c’était chez Sarrail et chez Venizelos qu’il allait ! Jonnart du coup fut dédoré. Les Athéniennes ne l’eurent plus comme chéri, car ces dames sont royalistes : c’est chic. Passons le 8, et arrivons au 9. Le 9, un coup terrible frappa Athènes en plein dans le cœur. Ce ne fut pas la prise de Janina par les Italiens, peuh ! Ce fut une dépêche annonçant que M. Jonnart, publiquement et en grande pompe, avait pris un de ses repas avec Sarrail, Venizelos et un tas d’autres lépreux horrifiants. Athènes est subtile. Elle comprit que M. Jonnart avait choisi sa table. Le soir même, le ministre de France partit et l’événement se précipita. M. Jonnart, la nuit, revint à Keratsini, il y apportait le cercueil à poignées d’or de Constantin.
L’heure finale
Donc nous sommes au dimanche 10. Athènes se réveille et son souffle est suspendu. Ses journaux ne lui disent rien de précis, mais elle renifle. Elle n’entend pas encore résonner la marche funèbre, mais elle voit qu’on en prépare les partitions. C’est l’heure finale. Les amis du roi vont se lancer dans une suprême tentative de sauvetage. Ces amis qui ne sont pas tous des Grecs ni des Allemands ne se connaissent pas. Ils vont, de nuit, à Keratsini réveiller M. Jonnart. Ils lui disent : « Vous allez faire couler des ruisseaux de sang, dans les rues d’Athènes. » Ces messieurs ont des idées personnelles. D’inadmissibles escamotages ont tant de fois sauvé le roi que ces manœuvres travaillent. Des cuirassés, des troupes sont là, nous le savons, nous les voyons. Mais nous les avions déjà vus en juin 1916 et en août, deux mois plus tard… Le gouvernement occulte se démène. Dousmanis et Gounaris échangent des serments de fidélité, de résistance et de Saint-Barthélemy. Dousmanis et Gounaris, dans leur fièvre de partisans, croient que le Grec va se dresser pour défendre son roi. Ils pensent au 1er décembre où nos marins furent assassinés. Ils vivent sur les tombes de nos marins. Toute la bande de Boches s’excite. Livieratos, général civil des épistrates, énergumène à ressort, déclare qu’il va se substituer au roi, à l’armée et à la nation. Il lance la mobilisation de ses réservistes. Il leur donne rendez-vous pour le soir, à minuit, place de la Concorde, – car Athènes a une place de la Concorde – ; il compte qu’ils viendront cinq mille. Pour l’instant, il n’est que midi. Attendons douze heures. Ne perdez pas le fil, nous sommes toujours au dimanche 10, la veille de la renonciation du roi. Les officiers, à la terrasse des pâtisseries, se font menaçants. Ces gens-là, parce qu’ils ont assassiné quarante-trois petits marins, se croient les héros de la grande guerre. Athènes est petite. Chacun sait quel est celui qui passe ; ils disent sur nos pas et dans un clair français : « Ce ne sera pas plus difficile que la dernière fois. » Et ils se remettent à sucer leur glace – sans doute pour se refroidir le sang. Comment savent-ils que l’on va détrôner leur roi ? Leur a-t-on dit ? Non. Ils le savent. La ville sait par les domestiques de la cour qu’au palais on ficelle les malles. Comment l’opération se passera-t-elle ? Jonnart descendra-t-il à terre ? Ah ! Jonnart ! les Athéniens n’ont que vous dans la bouche, ils s’empiffrent réellement de votre nom. Il est trois heures de l’après-midi. Il faut que les Athéniens soient hors d’eux-mêmes, pour n’être pas encore au lit ! Mais il est quatre heures. M. Jonnart a fait appeler Zaïmis. M. Jonnart est toujours sur son bateau. Les officiels seulement savent cela, pas la foule. Les officiels retiennent leur pouls : il sauterait. Zaïmis, sa communication reçue, est allé la porter au roi. Dousmanis, aussi furieux qu’un taureau lardé, court en auto vers le palais. De tous ses yeux il avale la route qu’il trouve trop longue.
Coup de vent et coup de barre
Huit heures. Subitement une dépression s’abat sur les Français renseignés : l’affaire est dans l’eau. Oui, pendant quelques heures de cette nuit de dimanche à lundi, notre justice fut encore sur le point de s’évanouir : nous allions nous en retourner à Salonique. Que la France sache ce qu’elle doit à M. Jonnart, au général Sarrail et aux généraux Caubone, Mas et Braquet. Dans le milieu de la nuit, le rétablissement était accompli. Ce coup de vent et ce coup de barre se passaient sur mer. Et c’est à minuit que les épistrates de Livieratos devaient épistrater. Ils épistratèrent, mais à cinq cents seulement au lieu de cinq mille. Ils étaient serrés comme des froussards. Nous avons traversé leur masse, en voiture. Ils ne se plaignirent même pas d’être dérangés. À un moment, Livieratos leva pourtant son revolver et fit friser quelque chose dessus – mais il n’y avait pas de balles dedans. Athènes ne dormit pas et le roi fuma, et neuf heures du matin trouvèrent Zaïmis chez M. Jonnart. M. Jonnart lui disait : « Le roi doit abdiquer aujourd’hui 11 juin et être parti le 12 à minuit. La matinée était chaude. Les officiels en tenue de campagne, le revolver visible, passaient par groupes résolus. Une réunion les appelait. Dousmanis, empoisonné, tournait en auto dans toutes les rues de la ville. Les ministres de l’Entente, encore ici, tournaient de même. Les dames – et ce fut bien ma plus grande peine – sur le passage d’un « sale Français » maniaient leur ombrelle comme un bâton. Mais, vision décisive : les anciens présidents du Conseil se rendaient au palais. Midi. Le dernier conseil de la Couronne se tient. Zaïmis rapporte la volonté de M. Jonnart. Gounaris est pour la résistance. Les autres, apercevant l’ombre de Sarrail au nord, au sud et en face, douloureusement se taisent et s’épongent. Constantin se soumet. Alors il fait appeler sa famille : « Il faut partir » dit-il simplement. La plus petite des princesses qui perdait son poney éclata en sanglots. France, de cette aventure, ne regrette que les larmes de la petite princesse. (À suivre.)
Le Petit Journal, 26 juin 1917
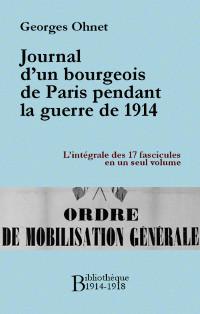 La Bibliothèque malgache publie une collection numérique, Bibliothèque 1914-1918, dans laquelle Albert Londres aura sa place, le moment venu.
Isabelle Rimbaud y a déjà la sienne, avec Dans les remous de la bataille, le récit des deux premiers mois de la guerre.
Et Georges Ohnet, avec son Journal d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914, dont le dix-septième et dernier volume est paru, en même temps que l'intégrale de cette volumineuse chronique - 2176 pages dans l'édition papier.
La Bibliothèque malgache publie une collection numérique, Bibliothèque 1914-1918, dans laquelle Albert Londres aura sa place, le moment venu.
Isabelle Rimbaud y a déjà la sienne, avec Dans les remous de la bataille, le récit des deux premiers mois de la guerre.
Et Georges Ohnet, avec son Journal d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914, dont le dix-septième et dernier volume est paru, en même temps que l'intégrale de cette volumineuse chronique - 2176 pages dans l'édition papier.
