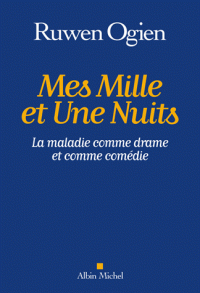 On (et ce "on" vaut pour un "je") a beau vouloir tout lire, y passer du temps, toujours un peu plus de temps, il faut accepter l'évidence: ce n'est pas possible.
Alors, "on" fait des impasses dont parfois "je" souffre. Ruwen Ogien, par exemple. Pas pour moi, me suis-je dit souvent, dans la mesure où d'autres sont mieux placés pour en parler, commenter, discuter...
Sinon que cette position, défendable d'un point de vue professionnel, ne l'est pas sur le plan personnel. Si je ne lis pas Ruwen Ogien, c'est moi qui en suis d'abord privé, et comment savoir, sans y aller, ce que je perds à ne pas connaître ses livres? On (je) reporte sans cesse, remettant à plus tard, et puis un jour on apprend qu'il est mort.
Car, comme il l'écrivait dans son dernier livre, Mes mille et une nuits, "les philosophes ont des soucis de santé comme tout le monde".
Il y cite Marcel Proust décrivant le passage brutal de la redescente sur le sol de la souffrance physique sans justification existentielle grandiose:
On (et ce "on" vaut pour un "je") a beau vouloir tout lire, y passer du temps, toujours un peu plus de temps, il faut accepter l'évidence: ce n'est pas possible.
Alors, "on" fait des impasses dont parfois "je" souffre. Ruwen Ogien, par exemple. Pas pour moi, me suis-je dit souvent, dans la mesure où d'autres sont mieux placés pour en parler, commenter, discuter...
Sinon que cette position, défendable d'un point de vue professionnel, ne l'est pas sur le plan personnel. Si je ne lis pas Ruwen Ogien, c'est moi qui en suis d'abord privé, et comment savoir, sans y aller, ce que je perds à ne pas connaître ses livres? On (je) reporte sans cesse, remettant à plus tard, et puis un jour on apprend qu'il est mort.
Car, comme il l'écrivait dans son dernier livre, Mes mille et une nuits, "les philosophes ont des soucis de santé comme tout le monde".
Il y cite Marcel Proust décrivant le passage brutal de la redescente sur le sol de la souffrance physique sans justification existentielle grandiose:
C’est dans la maladie que nous nous rendons compte que nous ne vivons pas seuls mais enchaînés à un être différent, dont des abîmes nous séparent, qui ne nous connaît pas et duquel il est impossible de nous faire comprendre : notre corps. Quelque brigand que nous rencontrions sur la route, peut-être pourrons-nous arriver à le rendre sensible à son intérêt personnel sinon à notre malheur. Mais demander pitié à notre corps, c’est discourir devant une pieuvre, pour qui nos paroles ne peuvent pas avoir plus de sens que le bruit de l’eau, et avec laquelle nous serions épouvantés d’être condamnés à vivre.Oui, j'aurais dû lire Ruwen Ogien. Je me console (un peu) en pensant qu'il n'est pas trop tard.
