 Comment croire qu’on va participer à la reconstruction d’un
monde quand on en est à mesurer les dégâts, quand trop de jeunes de votre âge,
autour de vous, sont morts, quand tout s’est arrêté à un moment précis ?
Le moment où la première bombe atomique utilisée comme arme de guerre est
tombée sur Hiroshima – émouvant soixantième anniversaire en ce mois d’août,
quelques jours avant la sortie en français du superbe roman que Shirley Hazzard
a consacré à l’après-guerre. Et à quelques jeunes gens vieillis trop vite.
Aldred Leith se trouve au Japon au printemps 1947, triste héros
encombré par la victoire des Alliés, les siens. Il a trente-deux ans, il s’est
placé sans trop le vouloir dans les pas de son père, écrivain à succès, en
préparant un livre sur la Chine et le Japon. Une mission quasi officielle, dont
il entend dépasser les limites grâce à des contacts avec les habitants du pays,
ceux-là même qui ont perdu la guerre.
Et quand, se demanda-t-il, saluant le marin des
antipodes, pourrai-je me mêler librement à ces mêmes vaincus ? – ce pour
quoi je suis venu. Cela, et Hiroshima.
A peine arrivé, il a le temps d’échanger un regard avec le
majordome japonais du général Driscoll avant de trouver, le lendemain, le corps
sans vie du jeune homme humilié, qui a préféré se donner la mort. En guise de
contact avec la population, Aldred pouvait espérer mieux…
La société des occupants a mis au point une hiérarchie très
fine entre les nationalités. Les Japonais sont, bien entendu, au bas de
l’échelle. A l’autre extrémité de celle-ci, on trouve les Américains, dont la
bombe a une fois pour toutes établi le pouvoir. Entre les deux, les
Britanniques (comme Aldred) et les Australiens (comme Driscoll) sont acceptés
dans certaines limites, puisqu’ils doivent demander des autorisations aux
Américains pour un certain nombre de choses. La marge de manœuvre est mince, il
faut s’en contenter à défaut de s’en satisfaire.
Très vite, heureusement, Aldred rencontre les enfants de
l’insupportable Driscoll : Helen, une adorable adolescente qui est sur le
point de s’épanouir en femme ; et Benedict, une intelligence et une
sensibilité attachantes mais presque effrayantes tant elles sont aiguës, qui
souffre par ailleurs d’une maladie mortelle peu connue. Le frère et la sœur
forment une sorte de couple atypique dont Aldred tombe amoureux – mais surtout
de Helen, bien entendu, malgré la quinzaine d’années qui les séparent.
Leur relation, bâtie sur une vive estime réciproque et sur
une attirance sensuelle qui n’a pas besoin d’explication, illumine le roman en
même temps qu’elle met les personnages en déséquilibre par rapport à leurs
situations respectives, et même en danger : Helen est mineure…
Comment, de la terre encore imbibée du sang d’innombrables
victimes, peuvent surgir des forces vitales sous la forme d’un couple prêt à
lutter pour son bonheur, autant que sous la forme d’une nature exceptionnelle,
voilà le nœud d’un récit qui se plaît parfois à la contemplation du bonheur.
Bonheur partagé tant Shirley Hazzard fait vibrer les lumières et les couleurs,
tant elle creuse avec naturel le penchant si banal à être bien ensemble,
simplement – et quelles que soient les obstacles créés par l’époque et par
l’entourage.
Il est possible de retenir bien des éléments d’un roman où
l’histoire d’amour, pour en être la colonne vertébrale, laisse la place à d’autres
considérations, toutes centrées sur la chance de vivre – au milieu des morts.
La baie de midi (traduit par Claude et Jean Demanuelli, 2010)
Comment croire qu’on va participer à la reconstruction d’un
monde quand on en est à mesurer les dégâts, quand trop de jeunes de votre âge,
autour de vous, sont morts, quand tout s’est arrêté à un moment précis ?
Le moment où la première bombe atomique utilisée comme arme de guerre est
tombée sur Hiroshima – émouvant soixantième anniversaire en ce mois d’août,
quelques jours avant la sortie en français du superbe roman que Shirley Hazzard
a consacré à l’après-guerre. Et à quelques jeunes gens vieillis trop vite.
Aldred Leith se trouve au Japon au printemps 1947, triste héros
encombré par la victoire des Alliés, les siens. Il a trente-deux ans, il s’est
placé sans trop le vouloir dans les pas de son père, écrivain à succès, en
préparant un livre sur la Chine et le Japon. Une mission quasi officielle, dont
il entend dépasser les limites grâce à des contacts avec les habitants du pays,
ceux-là même qui ont perdu la guerre.
Et quand, se demanda-t-il, saluant le marin des
antipodes, pourrai-je me mêler librement à ces mêmes vaincus ? – ce pour
quoi je suis venu. Cela, et Hiroshima.
A peine arrivé, il a le temps d’échanger un regard avec le
majordome japonais du général Driscoll avant de trouver, le lendemain, le corps
sans vie du jeune homme humilié, qui a préféré se donner la mort. En guise de
contact avec la population, Aldred pouvait espérer mieux…
La société des occupants a mis au point une hiérarchie très
fine entre les nationalités. Les Japonais sont, bien entendu, au bas de
l’échelle. A l’autre extrémité de celle-ci, on trouve les Américains, dont la
bombe a une fois pour toutes établi le pouvoir. Entre les deux, les
Britanniques (comme Aldred) et les Australiens (comme Driscoll) sont acceptés
dans certaines limites, puisqu’ils doivent demander des autorisations aux
Américains pour un certain nombre de choses. La marge de manœuvre est mince, il
faut s’en contenter à défaut de s’en satisfaire.
Très vite, heureusement, Aldred rencontre les enfants de
l’insupportable Driscoll : Helen, une adorable adolescente qui est sur le
point de s’épanouir en femme ; et Benedict, une intelligence et une
sensibilité attachantes mais presque effrayantes tant elles sont aiguës, qui
souffre par ailleurs d’une maladie mortelle peu connue. Le frère et la sœur
forment une sorte de couple atypique dont Aldred tombe amoureux – mais surtout
de Helen, bien entendu, malgré la quinzaine d’années qui les séparent.
Leur relation, bâtie sur une vive estime réciproque et sur
une attirance sensuelle qui n’a pas besoin d’explication, illumine le roman en
même temps qu’elle met les personnages en déséquilibre par rapport à leurs
situations respectives, et même en danger : Helen est mineure…
Comment, de la terre encore imbibée du sang d’innombrables
victimes, peuvent surgir des forces vitales sous la forme d’un couple prêt à
lutter pour son bonheur, autant que sous la forme d’une nature exceptionnelle,
voilà le nœud d’un récit qui se plaît parfois à la contemplation du bonheur.
Bonheur partagé tant Shirley Hazzard fait vibrer les lumières et les couleurs,
tant elle creuse avec naturel le penchant si banal à être bien ensemble,
simplement – et quelles que soient les obstacles créés par l’époque et par
l’entourage.
Il est possible de retenir bien des éléments d’un roman où
l’histoire d’amour, pour en être la colonne vertébrale, laisse la place à d’autres
considérations, toutes centrées sur la chance de vivre – au milieu des morts.
La baie de midi (traduit par Claude et Jean Demanuelli, 2010)
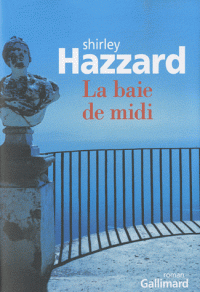 Quand Jenny arrive à Naples comme traductrice pour l’OTAN
après la Seconde guerre mondiale, quitter l’Angleterre ne lui fait pas peur.
Elle a passé plusieurs années déjà en Afrique. En revanche, elle souffre de
s’éloigner de son frère dont, elle a mis du temps à se l’avouer, elle est
amoureuse. Mais elle trouve, dans une ville où la beauté côtoie la crasse, une
liberté que même son travail ne diminue pas.
Elle a eu très vite la chance de rencontrer Gioconda, une
écrivaine au charme fou dont elle devient la meilleure amie et qui l’initie aux
habitudes napolitaines, du moins celles de la classe supérieure. Gianni,
l’amant cinéaste de Gioconda, qui a adapté un de ses livres, complète son
éducation avec un enthousiasme qui s’apparente parfois à un flirt poussé. Un
peu gênant, mais si piquant…
Shirley Hazzard, qui a vécu un an à Naples dans les années
cinquante, s’est inspirée de ce qu’elle a connu pour écrire ce roman, son
deuxième, publié en 1970. Elle restitue à la perfection les craintes et les
joies d’une expatriée à laquelle elle donne son âge – et peut-être une partie
des émotions vécues alors.
Le temps écoulé entre l’écriture du roman et sa traduction
est un atout plutôt qu’un handicap. Il utilise en effet ce que représente, pour
un enfant, le prestige chronologique : « Je
me disais que ce devait être merveilleux de pouvoir étaler des preuves de son
expérience du genre : “Ça date d’au moins dix ans” ou bien “Je ne l’avais
pas revu depuis vingt ans”. » La patine du temps renforce les
événements fixés par des images désormais immuables, gravées dans la mémoire.
Quand Jenny arrive à Naples comme traductrice pour l’OTAN
après la Seconde guerre mondiale, quitter l’Angleterre ne lui fait pas peur.
Elle a passé plusieurs années déjà en Afrique. En revanche, elle souffre de
s’éloigner de son frère dont, elle a mis du temps à se l’avouer, elle est
amoureuse. Mais elle trouve, dans une ville où la beauté côtoie la crasse, une
liberté que même son travail ne diminue pas.
Elle a eu très vite la chance de rencontrer Gioconda, une
écrivaine au charme fou dont elle devient la meilleure amie et qui l’initie aux
habitudes napolitaines, du moins celles de la classe supérieure. Gianni,
l’amant cinéaste de Gioconda, qui a adapté un de ses livres, complète son
éducation avec un enthousiasme qui s’apparente parfois à un flirt poussé. Un
peu gênant, mais si piquant…
Shirley Hazzard, qui a vécu un an à Naples dans les années
cinquante, s’est inspirée de ce qu’elle a connu pour écrire ce roman, son
deuxième, publié en 1970. Elle restitue à la perfection les craintes et les
joies d’une expatriée à laquelle elle donne son âge – et peut-être une partie
des émotions vécues alors.
Le temps écoulé entre l’écriture du roman et sa traduction
est un atout plutôt qu’un handicap. Il utilise en effet ce que représente, pour
un enfant, le prestige chronologique : « Je
me disais que ce devait être merveilleux de pouvoir étaler des preuves de son
expérience du genre : “Ça date d’au moins dix ans” ou bien “Je ne l’avais
pas revu depuis vingt ans”. » La patine du temps renforce les
événements fixés par des images désormais immuables, gravées dans la mémoire.
