 Monastir attend le Prince et Sarrail
Monastir attend le Prince et Sarrail
(De l’envoyé spécial du Petit Journal.) Monastir (par Salonique), 22 novembre. (Retardée dans la transmission.) Tout grouille, ce matin, les femmes courent d’une maison à l’autre s’emprunter ce qui manque pour décorer les façades ; les enfants, habillés en dimanche, se contemplent personnellement et mutuellement ; les hommes d’âge – il n’y a que des hommes d’âge – ont endossé les vêtements de leur mariage ; toute la population n’est pas encore réveillé de sa joie : impatiente, énervée, elle ne fait qu’entrer chez elle et sortir dans la rue. On finit de faire sauter les plaques de bois qui marquent les rues à la bulgare ; on retire les volets des magasins, des magasins sinistrement vides, où il n’y a plus rien à montrer ni à vendre. Des volontaires balayent les rues, et, la première fois, peut-être en Orient, les gens se baissent pour ramasser les papiers qui traînent. Un vieux Serbe, qui avait tenu pendant un an un portrait du roi Pierre caché dans sa cave, l’accroche à son balcon ; les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, comme si c’était pour le bon Dieu, mettent des draps blancs sur leurs murs. Monastir attend le prince et Sarrail. Ceux qui reviennent Les obus que les Bulgares ont lancés hier sur la ville n’ont apeuré personne. Le préfet, qui guettait, à Sorovitch, l’heure de la rentrée, passe en tirant son chapeau. Plus que les premiers soldats vainqueurs, il fait sentir à la population, qui le regarde ahurie, qu’elle est bien délivrée : les soldats, elle ne les avait jamais vus ; le préfet, elle le reconnaît. Le maire, le chef de gare qui avait fait partir, l’autre novembre, le dernier train ; le chef des tabacs qui, l’autre novembre aussi, avait entassé sa marchandise sur les chars à bœufs ; le directeur de la prison qui, toujours, l’autre novembre, avait libéré ses prisonniers ; tous rentrent, cherchent leur demeure et la contemplent. Le préfet ne retrouve que des ruines, le chef de gare que deux rails, le directeur des prisons que ses barreaux : les prisonniers ne sont pas revenus avec la victoire. Le drapeau serbe flotte sur le télégraphe et le maître d’école y a conduit ses élèves pour le leur montrer. Monastir attend le prince et Sarrail. On porte en terre le huitième des dix-sept moribonds que les Allemands nous ont laissés à l’ambulance ; les autres, déjà entrés dans la mort, quoique respirant toujours, ne s’aperçoivent de rien ; ils agonisent dans de la joie ambiante. Le consul d’Angleterre cherche un vitrier ; on lui a démoli ses carreaux ; le patron du cinéma placarde que les films seront expliqués en français ; avec la tête qu’il possède, on voit très bien qu’il afficha, voilà un an, qu’ils le seraient en allemand. Des propriétaires, qui n’entendent pas perdre le mois que les officiers bulgares n’ont pu finir, proposent leurs chambres aux nouveaux venus ; des photographes installés dans la rue veulent fixer, au prix de un franc le carton, la gloire de chaque vainqueur. Monastir attend le prince et Sarrail. Le colonel Vassitch, dans son manteau le plus neuf, se promène tout seul. Vassitch a pris Monastir en 1912 ; Vassitch l’a défendue en 1915 jusqu’au moment où le dernier pain est devenu vert ; Vassitch, pendant tout le temps que dans la vallée a duré la bataille, de la côte toujours la plus proche, n’a cessé de la désirer. Le général russe qui avait fait des bonds de Florina à Kistina, de Kistina à Lazek, et qui, chaque fois, certain de lui, disait : « Mon cheval ira à Monastir », passe à cheval à Monastir. Le consul grec, qui avait tout vu avec les Serbes, lors du désastre ; qui a tout vu avec les Bulgares lors de l’occupation, se prépare à tout revoir sous le nouveau régime. Le muezzin, avec la même fatalité, chante du haut de son minaret, comme il a chanté hier, comme il chantera demain ; la nationalité des auditeurs ne lui importe guère. Monastir attend le prince et Sarrail. Les deux autos mystérieuses Deux autos fermées pénètrent dans la ville ; dans la première, il y a toute la catastrophe d’un petit peuple sur qui tout tombe de tous les côtés, puis l’Albanie, ses neiges, sa famine, ses cadavres. Puis la mer ; puis, loin du tombeau de ses ancêtres, Corfou, puis Salonique, puis la vallée de Monastir avec ses pluies, ses masures, ses espérances exaspérées et ses croix de bois tout du long, tout du long, puis la revanche : Alexandre de Serbie. Dans la deuxième auto, il y a Guevgueli, Stroumitza, puis la hardiesse de Demir-Kapou ; puis, malgré qu’ils n’étaient qu’un contre cinq, et qu’il n’eût rien de rien pour l’entraver, la poussée sur Krivolak, puis les nuits dans l’angoisse, puis la vision de la réalité plus que toutes les suggestions, puis la main qui se ferme et tire en arrière, pendant dix jours sans que l’ennemi s’en aperçoive, toute l’armée qu’il avait lancée en avant, puis la cuirasse forcée sur Salonique, puis l’été terrible, puis les terrains désespérants, puis la ténacité de vouloir quand même, puis la victoire : Sarrail. Les autos ralentissent, les passants surpris dans leur croyance ne reconnaissent qu’après les voyageurs. Ils avaient appris que le prince et le général allaient venir ; ils avaient imaginé de superbes chevaux et des drapeaux et des fanfares et des buccins. Ils avaient vu l’héritier et le soldat sur de belles bêtes, au pas de parade, tête haute, main sur l’épée, s’avancer de front. Ils avaient cru à des arcs de triomphe qui se dresseraient subitement, à des palmes, à des apothéoses. Les autos ne s’arrêtent pas, la ville est presque traversée ; l’une fait halte devant une maison, l’autre cherche un poste de commandement. Le prince entre chez le maire, le général chez un général, les habitants du quartier viennent flairer les voitures. Le prince remonte, le général remonte. À tout hasard, comprenant mal, ces passants les applaudissent. Les autos tournent un peu ; de petits groupes plus avertis jettent les fleurs préparées. Les autos repartent vers Salonique. En redingote, en habits du dimanche, pas encore convaincue, Monastir attend le prince et Sarrail.
Le Petit Journal, 6 décembre 1916.
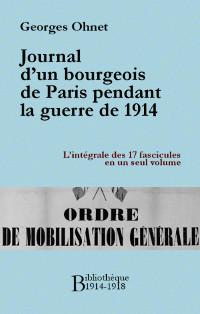 La Bibliothèque malgache publie une collection numérique, Bibliothèque 1914-1918, dans laquelle Albert Londres aura sa place, le moment venu.
Isabelle Rimbaud y a déjà la sienne, avec Dans les remous de la bataille, le récit des deux premiers mois de la guerre.
Et Georges Ohnet, avec son Journal d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914, dont le dix-septième et dernier volume est paru, en même temps que l'intégrale de cette volumineuse chronique - 2176 pages dans l'édition papier.
La Bibliothèque malgache publie une collection numérique, Bibliothèque 1914-1918, dans laquelle Albert Londres aura sa place, le moment venu.
Isabelle Rimbaud y a déjà la sienne, avec Dans les remous de la bataille, le récit des deux premiers mois de la guerre.
Et Georges Ohnet, avec son Journal d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914, dont le dix-septième et dernier volume est paru, en même temps que l'intégrale de cette volumineuse chronique - 2176 pages dans l'édition papier.
