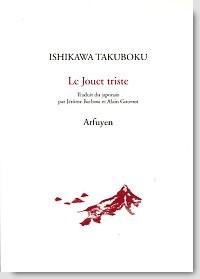 Le lecteur occidental est souvent mal à l’aise face au poème court japonais. Soit qu’il y voie (sans toujours oser l’avouer) de la platitude, de l’anecdote, une fadeur dont il ne sait que faire, soit au contraire qu’il surinvestisse, par réflexe de compensation, son « esprit zen » au bénéfice d’une sagesse orientale largement fantasmée. Les poèmes d’Ishikawa Takuboku – ce sont des tankas qui, s’ils sont présentés sous la forme de trois vers successifs, ne répondent pas aux mêmes règles rythmiques que le haïku – n’échapperont sans doute pas au malentendu.
Le lecteur occidental est souvent mal à l’aise face au poème court japonais. Soit qu’il y voie (sans toujours oser l’avouer) de la platitude, de l’anecdote, une fadeur dont il ne sait que faire, soit au contraire qu’il surinvestisse, par réflexe de compensation, son « esprit zen » au bénéfice d’une sagesse orientale largement fantasmée. Les poèmes d’Ishikawa Takuboku – ce sont des tankas qui, s’ils sont présentés sous la forme de trois vers successifs, ne répondent pas aux mêmes règles rythmiques que le haïku – n’échapperont sans doute pas au malentendu.
Même si Takuboku (1886-1912) aura voulu être un rénovateur du genre (et de la forme, notamment en y introduisant la ponctuation occidentale), il y a bien dans ces poèmes ce qui fait le fond de la tradition japonaise, à savoir un privilège accordé à l’observation directe. Contrairement à la pratique ancienne, ce n’est pas tant la nature qui est l’objet de l’observation que la ville et les menus événements du quotidien, les aléas d’une « vie moderne » de modeste employé. Et même, franche innovation pour le coup, l’observation peut porter sur ce qui se passe à l’intérieur de la conscience. Le poème a toujours sa source dans un fait qui sollicite, qui éveille, mais cet appel du poème peut avoir lieu au-dedans de la pensée.
Comme si demain pouvait advenir quelque chose de bon,
ce sentiment,
je le gronde en m’endormant.
C’est le soin apporté au surgissement de la pensée, l’attention prêtée au flux de la conscience qui sont nouveaux et qui sont caractéristiques de ce poète.
Comme si cette marche n’avait pas de terme,
mes pensées jaillissent
au cœur de la nuit, d’une rue à l’autre.
Pour autant ce jaillissement de la pensée n’est en rien l’amorce d’une analyse, d’une introspection ou d’une interprétation qu’il s’agirait d’introduire au sein du poème. Le poète s’y refuse car la pensée est elle-même événement, au même titre que les événements du monde extérieur qui la font naître. La pensée n’est pas le traitement poétique d’une chose vue ; elle est un trait, une donnée brute, un élément du réel. Ce surgissement d’une pensée ou plus simplement d’une émotion (joie, tristesse, crainte, etc.) est une sollicitation parmi d’autres, il s’insère dans la trame des sollicitations devant laquelle, sur laquelle plutôt, le poème s’arrête, comme suspendu. La réussite poétique consiste alors à trouver une adéquation entre l’émotion et l’événement qui en fut l’occasion. Adéquation qui peut bien entendu n’être pas exempte de décalage et d’ironie :
Je fixe ces mains sales ― ―
Exactement
semblables à mon esprit ces jours-ci.
ou bien
Aujourd’hui pourquoi
deux fois, trois fois même
j’ai pensé que je désirais une montre plaqué or.
Une émotion (une pensée) peut être tout à fait hors de propos, incongrue, il n’empêche qu’elle appartient au moment poétique qu’il s’agit d’exprimer. Le poème met tout sur un même plan d’égalité : il tire un trait qui d’un même coup égalise et comme biffe l’unité du monde et de la pensée. Il dit un continuum et le dit en le condensant (mais sans resserrer à l’excès : la densité doit être légère). Là où le poème occidental surévalue l’extraordinaire, ou du moins cherche derrière l’événement son sens et une révélation, le haïku – le tanka – n’aime rien tant que ce qui arrive. Ce qui arrive tout court. Et qui laisse désemparé. La question du banal ne se pose pas à lui. Ce qui compte, ce qui est remarquable et ce qui est à noter, c’est lorsque viennent le monde et les sentiments ensemble, comme indéfectiblement mêlés dans une confusion qui est leur vraie saveur :
Par cette belle journée, quelle tristesse !
Penché à la fenêtre de la salle de soins
je savoure une cigarette.
L’instantanéité et la simultanéité semblent être les vertus premières du poème.
L’été est arrivé à l’improviste.
Si plaisante aux yeux du convalescent
la lumière de la pluie !
Mais le recueil est poignant aussi parce qu’il est le dernier du poète mort à vingt-six ans, composé pendant les dix-huit mois qui précédèrent sa fin, en grande partie à l’hôpital. L’heure est à la souffrance, à l’accablement, et le poète ne trompe pas ses émotions. Il les reçoit comme autant de faits ; il les accepte, c’est-à-dire que d’abord il ne les dénie pas, n’enjolive rien et surtout pas son esprit en proie à de sombres pensées. Maladie, pauvreté, rien n’est épargné au poète et la poésie fonctionne alors en effet comme un « jouet triste » soit quelque chose qui a priori divertit, détourne mais qui en réalité par son sérieux ramène au cœur de la réalité. « La poésie est mon jouet triste », propos de l’auteur qui donnera posthumément son titre à un recueil resté initialement sans titre, la formule est parfaite : c’est un jouet mais un jouet doué de sentiment, donc vivant. Sauf que c’est de tristesse qu’il est animé, comme une poupée désarticulée en laquelle viendrait gésir – et gémir – la vie, cette vie qui se retire.
Laurent Albarracin
Ishikawa Takuboku, Le Jouet triste, traduit du japonais et présenté par Jérôme Barbosa et Alain Gouvret, Éditions Arfuyen, 2016, 97 pages, 14 €

