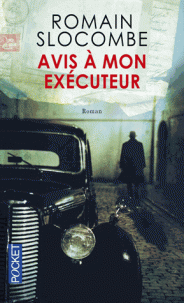 Le parcours de Romain Slocombe explique en partie la
difficulté à le situer clairement dans le paysage : il a été dessinateur
et l’érotisme japonais est une de ses spécialités. Mais il s’est imposé par des
romans souvent noirs et profondément ancrés dans le réel. Monsieur le Commandant, paru en 2011, a reçu plusieurs prix
littéraires : Prix Nice-Baie des Anges, Prix Jean d’Heurs, Prix Calibre 47
et Trophée 813. Quant à Avis à mon exécuteur, paru il y a deux ans en édition originale, il impressionne à
plusieurs titres.
D’abord par les informations qu’il contient. La
bibliographie en témoigne (même si le romancier n’a pas lu intégralement tous
les livres cités, reconnaît-il volontiers) : Romain Slocombe a exploré en
profondeur les années trente, côté soviétique, et leurs implications sur la
politique mondiale, en particulier la Guerre d’Espagne.
Ensuite par la manière dont il coule cette information dans
un récit attribué à un ancien général de l’Armée rouge, Victor Krebnisky, dont
la personnalité et la connaissance des réseaux souterrains font un témoin
pertinent, bien qu’imaginaire, de cette époque.
Cela donne un livre qui dévoile la part sombre du
pouvoir : duplicité, calcul, mépris de la vie humaine. Rien de très
réjouissant si on rapporte cette époque à la nôtre, ce qu’il est peut-être néanmoins
nécessaire de faire…
Avez-vous conscience
du désespoir que peut engendrer votre livre ?
Je n’aime pas trop
faire des romans pour faire croire que tout est joli. Quand on s’intéresse à
l’Histoire, on s’aperçoit que tout est un peu mensonge. J’essaie de déterrer la
vérité. Quand on parle de politique, d’Histoire, de guerre, d’espionnage, une
logique assez terrifiante se met en place et on peut difficilement y échapper.
Vous parlez de
mensonge. Le titre du récit de votre personnage principal s’intitule d’ailleurs
Le grand mensonge. C’est le fondement
de tout ?
C’est un énorme
mensonge, avec beaucoup de petits mensonges dedans.
Le grand mensonge en
question est-il l’appartenance de Staline aux hommes du tsar avant la
Révolution ?
Evidemment, il y a une
ironie à penser que le Petit Père des peuples était un simple mouchard de la
police à ses débuts. Mais, au-delà de ça, il y a le symbole du grand mensonge
des lendemains qui chantent. Le fascisme est basé sur la brutalité, le pouvoir,
le droit clairement affiché des peuples forts à opprimer les peuples faibles,
avec le racisme, l’antisémitisme, etc. Tandis que le communisme se présente
comme la libération de l’humanité et justifie, par ce but, les pires crimes.
Tous les faits rapportés
par votre narrateur, Victor Krebnisky, sont-ils réels ?
Certains ne sont pas
prouvés. L’appartenance de Staline à la police tsariste n’est pas
historiquement prouvée, par exemple. Mais il a fait tout ce qu’il fallait pour
le cacher et il y a des indices. J’ai suffisamment de sources pour être
persuadé que c’est vrai. D’autres choses sont avérées mais peu connues. Par
exemple le fait que Staline a fait venir tout l’or de la banque d’Etat
espagnole, qu’il a vraiment volé. Ce gigantesque hold-up est un fait historique
qui n’apparaît pas dans les livres. Beaucoup d’exécutions, comme celle du fils
de Trotsky empoisonné à l’occasion d’une opération de l’appendicite, ne peuvent
pas être prouvées…
Cette période reste
très présente dans la littérature d’aujourd’hui. Est-ce parce qu’elle existe
toujours en nous, d’une certaine manière, ou par volonté de ne pas
l’oublier ?
Le parcours de Romain Slocombe explique en partie la
difficulté à le situer clairement dans le paysage : il a été dessinateur
et l’érotisme japonais est une de ses spécialités. Mais il s’est imposé par des
romans souvent noirs et profondément ancrés dans le réel. Monsieur le Commandant, paru en 2011, a reçu plusieurs prix
littéraires : Prix Nice-Baie des Anges, Prix Jean d’Heurs, Prix Calibre 47
et Trophée 813. Quant à Avis à mon exécuteur, paru il y a deux ans en édition originale, il impressionne à
plusieurs titres.
D’abord par les informations qu’il contient. La
bibliographie en témoigne (même si le romancier n’a pas lu intégralement tous
les livres cités, reconnaît-il volontiers) : Romain Slocombe a exploré en
profondeur les années trente, côté soviétique, et leurs implications sur la
politique mondiale, en particulier la Guerre d’Espagne.
Ensuite par la manière dont il coule cette information dans
un récit attribué à un ancien général de l’Armée rouge, Victor Krebnisky, dont
la personnalité et la connaissance des réseaux souterrains font un témoin
pertinent, bien qu’imaginaire, de cette époque.
Cela donne un livre qui dévoile la part sombre du
pouvoir : duplicité, calcul, mépris de la vie humaine. Rien de très
réjouissant si on rapporte cette époque à la nôtre, ce qu’il est peut-être néanmoins
nécessaire de faire…
Avez-vous conscience
du désespoir que peut engendrer votre livre ?
Je n’aime pas trop
faire des romans pour faire croire que tout est joli. Quand on s’intéresse à
l’Histoire, on s’aperçoit que tout est un peu mensonge. J’essaie de déterrer la
vérité. Quand on parle de politique, d’Histoire, de guerre, d’espionnage, une
logique assez terrifiante se met en place et on peut difficilement y échapper.
Vous parlez de
mensonge. Le titre du récit de votre personnage principal s’intitule d’ailleurs
Le grand mensonge. C’est le fondement
de tout ?
C’est un énorme
mensonge, avec beaucoup de petits mensonges dedans.
Le grand mensonge en
question est-il l’appartenance de Staline aux hommes du tsar avant la
Révolution ?
Evidemment, il y a une
ironie à penser que le Petit Père des peuples était un simple mouchard de la
police à ses débuts. Mais, au-delà de ça, il y a le symbole du grand mensonge
des lendemains qui chantent. Le fascisme est basé sur la brutalité, le pouvoir,
le droit clairement affiché des peuples forts à opprimer les peuples faibles,
avec le racisme, l’antisémitisme, etc. Tandis que le communisme se présente
comme la libération de l’humanité et justifie, par ce but, les pires crimes.
Tous les faits rapportés
par votre narrateur, Victor Krebnisky, sont-ils réels ?
Certains ne sont pas
prouvés. L’appartenance de Staline à la police tsariste n’est pas
historiquement prouvée, par exemple. Mais il a fait tout ce qu’il fallait pour
le cacher et il y a des indices. J’ai suffisamment de sources pour être
persuadé que c’est vrai. D’autres choses sont avérées mais peu connues. Par
exemple le fait que Staline a fait venir tout l’or de la banque d’Etat
espagnole, qu’il a vraiment volé. Ce gigantesque hold-up est un fait historique
qui n’apparaît pas dans les livres. Beaucoup d’exécutions, comme celle du fils
de Trotsky empoisonné à l’occasion d’une opération de l’appendicite, ne peuvent
pas être prouvées…
Cette période reste
très présente dans la littérature d’aujourd’hui. Est-ce parce qu’elle existe
toujours en nous, d’une certaine manière, ou par volonté de ne pas
l’oublier ?
En ce qui me concerne, c’est une volonté de remettre les pendules à l’heure. Ça m’énerve quand je vois des documentaires qui expédient le pacte germano-soviétique en quelques mots, comme s’il avait surgi tout à coup. Walter Krivitsky, qui m’a servi de modèle, m’a révélé que Staline, depuis la fin de 1936, faisait des manœuvres d’approche, au début refusées par Hitler, pour s’allier avec lui. Cela n’apparaît pas, habituellement.
