 L’enfer du Carso
L’enfer du Carso
(De notre envoyé spécial.) Monfalcone, … août. Il y a deux sortes de succès dans les guerres : les sentimentaux et les stratégiques. Parfois, les sentimentaux sont stratégiques et les stratégiques sont sentimentaux. Tout se mêle dans ces grands mouvements de vie et de mort : l’un peut tenir de l’autre, l’autre peut tenir de l’un. Ils sont tantôt séparés, tantôt conjoints. Le plus souvent ils ne s’empruntent rien. Dans la marche des Italiens à travers les montagnes hérissées de la Vénétie, on trouve ces deux sortes de victoires. L’une a sonné plus clairement que l’autre : c’est Gorizia. L’autre a moins retenti : c’est le Carso. On croirait que la première fut annoncée dans un instrument de cuivre et la seconde dans un instrument de bois. Cette chose arrive chaque fois qu’une victoire d’accroche à une ville. La ville a un nom, ce nom est connu, il véhicule le succès. Pour des armées, une ville prise c’est leur victoire du coup répercutée. Les pas des régiments, quand ces régiments pénètrent dans la cité, se heurtent à son nom comme une voix à une montagne et l’écho s’en répand sur la terre. Il n’existe pas d’écho quand vous prenez le la campagne sans nom. Dans le même temps qu’ils enlevaient Gorizia, les Italiens avançaient de quinze kilomètres sur le Carso ; mais aucun nom qui frappe ne s’est trouvé au bout pour en renvoyer la gloire à l’étranger. Les balles de Gorizia avaient trouvé une raquette ; les balles du Carso ne l’ont pas encore rencontrée. Le Carso est cette partie de la Vénétie qui, de Gorizia à Monfalcone, en s’inclinant vers la mer, descend sur Trieste. Ce fut la bataille des cimes et des catacombes. Gorizia fut le succès trébuchant des Italiens ; le Carso, c’est une avance réelle, qu’avec moins de bruit ils se sont payée, pour peu, des Autrichiens. La forteresse autrichienne Les Autrichiens étaient installés dans le Carso, comme dans leur château fort les anciens seigneurs attaqués. Ils avaient creusé, maçonné, élevé tous les fossés, créneaux et tourelles nécessaires et, à l’abri de leur pont-levis, les nuits, ils dormaient. C’était leur fief. On pourrait lui donner assaut, on ne saperait pas. Derrière ses murs blasonnés, la famille continuerait de faire souche. Les blasons n’intimident pas les Italiens ; ils les connaissent et la morgue des grandes maisons aussi ; et, par une journée d’août, ils se jetèrent contre les murs du Carso. Vous entendez parfaitement qu’il n’y avait pas de murs sur le Carso, que c’est des montagnes que je veux parler et que le château fort non plus n’existe pas, qu’il n’est là que pour figurer à vos yeux l’armée autrichienne et ses défenses. Il en est certainement de semblables sur d’autres terrains de guerre. Souchez, le Labyrinthe, les Éparges n’avaient pas attendu le Carso pour prendre le masure de leur armure. Toutefois, dans un tournoi, l’armure du Carso aurait pu s’aligner devant toutes celles-là. Tous les monts de cette contrée, forteresse d’Autriche, avaient été reliés entre eux. Les collines qui les rejoignaient étaient devenues des cavernes. L’œuvre de Dieu, jugée insuffisante par les hommes, avait été parachevée. Dans ses masses les plus gigantesques, ils s’étaient mis à la corser. Mieux que lui, les hommes avaient fini par connaître les besoins sans limite des hommes. Ils se sont mis à perforer ce qu’il n’avait pensé qu’à élever. Chaque montagne, comme un kangurou, avait le ventre ouvert pour lui permettre, dans les heures de danger, de recueillir ses enfants en péril. Les ennemis n’étaient plus dessus les monts, mais dedans, et le canon ne pouvait rien. Les usines humaines n’ont pas encore forgé d’engins capables de faire baisser la tête aux travaux de la nature. Un 420, c’est sûrement beaucoup contre les hommes et les pierres amassées par les hommes et les aciers forgés par les hommes ; ce n’est rien contre la terre, quand elle est géante comme dans les montagnes. La montagne, dans ses poches, en toute sécurité, portait les hommes à la barbe du feu le plus dévorant et les hommes furent forcés d’aller déloger les hommes. Torche à la main, les Italiens rentrèrent dans ces cavernes. Par cela, ils n’inventaient rien, car, vous le savez déjà, la guerre ne consiste plus à fouiller seulement la surface du sol, mais aussi l’intérieur. Ils avaient, avec eux, amené du pétrole. Où les dernières créations infernales du feu n’avaient rien pu faire, le vieux feu, veilleur de foyers, opéra. De la lampe paisible où il éclairait la douceur des scènes de famille, il était passé dans l’enfer de la haine terrestre. Et devant lui, les Autrichiens se rendirent. L’arsenal de la mort Ce morceau de champ de bataille ressemble bien, en effet, à un corridor d’enfer. On y trouve, au milieu d’instruments bien connus, d’autres qui ne le sont pas mais dont la mine vous annonce qu’ils n’ont pu être faits que pour lacérer les chairs. Vous avez des entrecroisements d’acier ou des bois qui ont l’air de chevalets. Vous en avez d’autres qui figurent la croix de saint André ; d’autres la croix de Jésus. Vous y voyez aussi le gril de saint Sébastien, et, s’il n’y manque que des bêtes pour rappeler à votre mémoire les carnages visibles et cachés des cirques et des colisées, c’est sans doute qu’ici les fauves ne vaudraient pas les hommes. C’est ce spectacle que je sens et que je vois depuis que je suis au milieu de la bataille du Carso. Il y a même des choses qui ne s’apparentent à aucune réminiscence. Ces matraques, par exemple, œuvres autrichiennes, longues de soixante centimètres et terminées par de petites ficelles qui, elles-mêmes, le sont par de solides hameçons et qui déchirent un visage mieux que la patte de la lionne. Et ces grands tubes de zinc qui s’élèvent entre ces deux collines, qui donnent l’impression de l’interminable système de cheminées d’un paquebot colossal fait pour des mers encore inconnues et en partance pour un gigantesque pays de fous. Que signifient ces cheminées, à quoi servent-elles, quelle est encore cette invention ? C’était, paraît-il, un nouvel abri pour les canons. Mais personne n’y a rien compris. Il y a certainement, en enfer, des moyens encore ignorés. Le Carso comptera parmi les grands arsenaux de la mort. On y respire l’odeur du sang ; on y entend des râles éteints, mais on y distingue la route de Leibach.
Le Petit Journal, 31 août 1916.
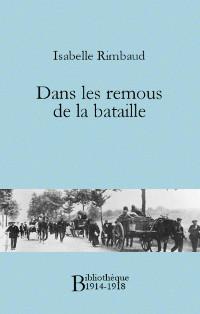 La Bibliothèque malgache édite une collection numérique "Bibliothèque 1914-1918". Au catalogue, pour l'instant, les 15 premiers volumes (d'une série de 17) du Journal d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914, par Georges Ohnet (1,99 € le volume). Une présentation, à lire ici.
Et le récit, par Isabelle Rimbaud, des deux premiers mois de la Grande Guerre, Dans les remous de la bataille (1,99 €).
La Bibliothèque malgache édite une collection numérique "Bibliothèque 1914-1918". Au catalogue, pour l'instant, les 15 premiers volumes (d'une série de 17) du Journal d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914, par Georges Ohnet (1,99 € le volume). Une présentation, à lire ici.
Et le récit, par Isabelle Rimbaud, des deux premiers mois de la Grande Guerre, Dans les remous de la bataille (1,99 €).
