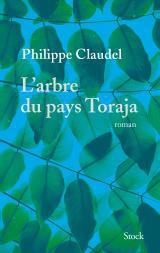
Quatrième de couverture :
« Qu’est-ce que c’est les vivants ? À première vue, tout n’est qu’évidence. Être avec les vivants. Être dans la vie. Mais qu’est-ce que cela signifie, profondément, être vivant ? Quand je respire et marche, quand je mange, quand je rêve, suis- je pleinement vivant ? Quand je sens la chaleur douce d’Elena, suis-je davantage vivant ? Quel est le plus haut degré du vivant ? »Un cinéaste au mitan de sa vie perd son meilleur ami et réfléchit sur la part que la mort occupe dans notre existence. Entre deux femmes magnifiques, entre le présent et le passé, dans la mémoire des visages aimés et la lumière des rencontres inattendues, L’Arbre du pays Toraja célèbre les promesses de la vie.
Avertissement préalable : je me suis demandé si j’allais chroniquer cette lecture…
Le sujet est loin de me déplaire ou de me faire peur. A la cinquantaine bien sonnée, un homme (narrateur qui restera anonyme, selon le choix de l’auteur) revisite sa vie, ses amours, son travail ou plutôt sa création de cinéaste, tout ce qui nourrit cette vie d’artiste, à la lumière de l’amitié d’Eugène, son producteur, mort d’un cancer deux ans auparavant. Ce décès est l’occasion d’une méditation sur l’amitié, sur l’irruption de la mort dans la vie, sur la manière dont chacun appréhende cette réalité, par le déni, la fuite, l’acceptation, l’angoisse ou l’apprivoisement progressif. Tout au long de son récit, notre narrateur est confronté à cette question à travers d’autres expériences, d’autres facettes comme celle de sa mère qui, déjà retirée de la vie, s’éteint peu à peu dans une maison de retraite, ou celle d’un enfant mort-né.
Cette méditation, cette relecture, Philippe Claudel la mène à la façon d’un cinéaste (ce qu’il est aussi), avec des retours en arrière, des zooms sur des moments ou des visages précis, des descriptions très cinématographiques de certaines situations (comme ce qu’il voit à travers les fenêtres de sa voisine d’en face). Le propos est clair et élégant, la réflexion est profonde, humaniste, le parcours du deuil de l’ami trop tôt disparu est pudique et digne. L’image de l’arbre du pays Toraja, tradition indonésienne, est belle : les vivants, « ceux qui restent », continuent à grandir en englobant dans leurs racines et leurs branchages le souvenir vivant des disparus.
Mon bémol ou ma perplexité ? C’est que, ayant entendu Philippe Claudel parler de son livre (pour une fois que je suivais un peu l’actualité littéraire à la télé), j’ai sans cesse eu à l’esprit la situation réelle, la part d’autobiographie du livre, c’est-à-dire la douleur pour Philippe Claudel d’avoir perdu son ami et éditeur, Jean-Marc Roberts, et que, même en ayant bien conscience du travail de relecture, de distance, de recomposition (« Vivre, en quelque sorte, c’est savoir survivre et recomposer »), j’avais du mal à accepter l’étiquette de « roman » apposée sur la couverture (très jolie et paisible au demeurant). Les amateurs ou connaisseurs d’auto-fiction ne seront sans doute pas ennuyés par la chose, moi cela m’a un peu gênée aux entournures. Ceci dit, je me suis fait la réflexion que Philippe Claudel a beau aborder sereinement cette présence grandissante de la mort dans la vie à mesure que l’on avance en âge, il n’en garde pas moins une certaine angoisse ; cette vision romancée de son histoire est sans doute un des derniers masques qu’il veut garder, qu’il s’autorise pour conjurer cette peur bien naturelle de la mort.
« Je me rends compte qu’écrire est une inhumation qui ensevelit tout autant qu’elle met de nouveau au jour. le cinéma n’opère pas de la même façon, mais il est vrai qu’il n’est pas constitué non plus de la même matière. » (p. 139)
« La mort d’Eugène ne m’a pas seulement privé de mon meilleur et seul ami. Elle m’a aussi ôté toute possibilité de dire, d’exprimer ce qui en moi s’agite et tremble. Elle m’a également fait orphelin d’une parole que j’aimais entendre et qui me nourrissait, qui me donnait, à la façon dont opère un radar, la mesure du monde que, seul désormais, je ne parviens à prendre qu’imparfaitement. « (p. 141)
Je suis quand même bien contente d’avoir trouvé ce livre sur les étagères de ma bibli !
Philippe CLAUDEL, L’arbre du pays Toraja, Stock, 2016
Classé dans:Des Mots français Tagged: amitié, L'arbre du pays Toraja, mort, Philippe Claudel, Stock
