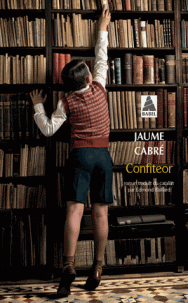 Il faut l’avouer :
voici un roman autour duquel on a beaucoup tourné avant de se décider à le lire
vraiment. Il y avait sa taille et son poids, bien sûr, mais on a déjà vu et lu
plus long, plus lourd. Il y avait surtout le concert unanime d’éloges entonné
par les lecteurs, professionnels ou non, qui avaient franchi le pas. C’était
presque trop, jusqu’à faire naître l’impression d’une œuvre surévaluée, mais
comment savoir sans vérifier ?
Un beau jour – le jour
fut beau, en effet, même s’il a duré plus d’un jour –, on y est entré. Après
quoi il ne reste qu’à ajouter un éloge aux éloges, parce qu’en effet on n’en
est pas sorti : Confiteor est un
grand, un très grand livre.
En fait, on comprend
assez vite que Confiteor est une
construction romanesque inhabituellement ambitieuse et même, sur le plan
formel, d’une audace peu fréquente. Essayons de fixer quelques points de repère
– alors qu’ils ne sont pas d’une grande utilité une fois qu’on est lancé dans
un récit où tout s’impose avec naturel. Adrià, le personnage principal, qui est
aussi le narrateur, ou du moins celui dont la voix domine à travers le
truchement de Bernat, son meilleur ami, parle parfois de lui à la première
personne, puis passe sans prévenir au « il ». De la même manière,
c’est sans s’annoncer qu’une époque dont on était très éloigné arrive ou
revient d’un coup au premier plan. Au fil d’un ouvrage qui joue sans cesse à
nous surprendre, on se trouve presque simultanément à Auschwitz, à Barcelone
aujourd’hui ou presque, à Rome dans les années soixante, dans les œuvres les
plus puissantes de la littérature et dans la création pure susceptible
d’émouvoir même quand elle est imaginaire.
Sous les aspects d’un
bric-à-brac qui pourrait égarer, Confiteor
(dont il faut peut-être donner le sens en français : « je reconnais,
j’avoue ») est un livre organisé à la perfection, mais souterrainement,
sous les couches du temps qui donnent de l’épaisseur aux thèmes et sous-thèmes
dont on ne finit pas d’épuiser la richesse.
Suivons deux lignes
mélodiques, dont personne (pas nous, en tout cas) n’osera dire qu’elles sont
les principales tant elles sont tressées avec les autres, qui aideront à
comprendre de quoi il s’agit. Parlons donc d’un violon et d’un amour.
Le père d’Adrià,
vaguement antiquaire ou collectionneur, en tout cas passionné par les objets
anciens dont l’existence peut être reliée à des faits marquants de l’histoire
de l’intelligence et de la sensibilité, possède un violon enfermé dans un
coffre. Ce violon, il rêve d’en faire l’instrument de la gloire de son fils
quand celui-ci sera devenu un musicien de talent. Sinon qu’Adrià n’est pas
particulièrement doué, beaucoup moins en tout cas que Bernat – qui rêve, lui,
d’être écrivain. Mais c’est une autre histoire, tout en étant la même. Et ce
violon singulier, marqué par le sang et qu’on viendra un jour réclamer à Adrià,
est lié à la succession des cruautés dont l’humanité s’est montrée capable au
cours des siècles, en passant par Auschwitz.
Tout cela n’est pas sans
rapport – répétons-le, tout est lié – avec l’amour d’Adrià pour Sara. Amour
comblé autant qu’amour impossible, en raison des circonstances, des origines
juives de Sara, du parcours du violon, des fautes du père d’Adrià qui retombent
sur celui-ci, dans un vaste tourbillon où le lecteur est entraîné sans aucune
chance d’en sortir. D’autant que le mode de fonctionnement de ce tourbillon ne
lui est donné que petit à petit. C’est seulement en refermant le livre – et
avec l’envie presque physique, comme un besoin, de le recommencer aussitôt –
qu’il comprendra quelle place avait chaque élément de cet ensemble.
Il faut l’avouer :
voici un roman autour duquel on a beaucoup tourné avant de se décider à le lire
vraiment. Il y avait sa taille et son poids, bien sûr, mais on a déjà vu et lu
plus long, plus lourd. Il y avait surtout le concert unanime d’éloges entonné
par les lecteurs, professionnels ou non, qui avaient franchi le pas. C’était
presque trop, jusqu’à faire naître l’impression d’une œuvre surévaluée, mais
comment savoir sans vérifier ?
Un beau jour – le jour
fut beau, en effet, même s’il a duré plus d’un jour –, on y est entré. Après
quoi il ne reste qu’à ajouter un éloge aux éloges, parce qu’en effet on n’en
est pas sorti : Confiteor est un
grand, un très grand livre.
En fait, on comprend
assez vite que Confiteor est une
construction romanesque inhabituellement ambitieuse et même, sur le plan
formel, d’une audace peu fréquente. Essayons de fixer quelques points de repère
– alors qu’ils ne sont pas d’une grande utilité une fois qu’on est lancé dans
un récit où tout s’impose avec naturel. Adrià, le personnage principal, qui est
aussi le narrateur, ou du moins celui dont la voix domine à travers le
truchement de Bernat, son meilleur ami, parle parfois de lui à la première
personne, puis passe sans prévenir au « il ». De la même manière,
c’est sans s’annoncer qu’une époque dont on était très éloigné arrive ou
revient d’un coup au premier plan. Au fil d’un ouvrage qui joue sans cesse à
nous surprendre, on se trouve presque simultanément à Auschwitz, à Barcelone
aujourd’hui ou presque, à Rome dans les années soixante, dans les œuvres les
plus puissantes de la littérature et dans la création pure susceptible
d’émouvoir même quand elle est imaginaire.
Sous les aspects d’un
bric-à-brac qui pourrait égarer, Confiteor
(dont il faut peut-être donner le sens en français : « je reconnais,
j’avoue ») est un livre organisé à la perfection, mais souterrainement,
sous les couches du temps qui donnent de l’épaisseur aux thèmes et sous-thèmes
dont on ne finit pas d’épuiser la richesse.
Suivons deux lignes
mélodiques, dont personne (pas nous, en tout cas) n’osera dire qu’elles sont
les principales tant elles sont tressées avec les autres, qui aideront à
comprendre de quoi il s’agit. Parlons donc d’un violon et d’un amour.
Le père d’Adrià,
vaguement antiquaire ou collectionneur, en tout cas passionné par les objets
anciens dont l’existence peut être reliée à des faits marquants de l’histoire
de l’intelligence et de la sensibilité, possède un violon enfermé dans un
coffre. Ce violon, il rêve d’en faire l’instrument de la gloire de son fils
quand celui-ci sera devenu un musicien de talent. Sinon qu’Adrià n’est pas
particulièrement doué, beaucoup moins en tout cas que Bernat – qui rêve, lui,
d’être écrivain. Mais c’est une autre histoire, tout en étant la même. Et ce
violon singulier, marqué par le sang et qu’on viendra un jour réclamer à Adrià,
est lié à la succession des cruautés dont l’humanité s’est montrée capable au
cours des siècles, en passant par Auschwitz.
Tout cela n’est pas sans
rapport – répétons-le, tout est lié – avec l’amour d’Adrià pour Sara. Amour
comblé autant qu’amour impossible, en raison des circonstances, des origines
juives de Sara, du parcours du violon, des fautes du père d’Adrià qui retombent
sur celui-ci, dans un vaste tourbillon où le lecteur est entraîné sans aucune
chance d’en sortir. D’autant que le mode de fonctionnement de ce tourbillon ne
lui est donné que petit à petit. C’est seulement en refermant le livre – et
avec l’envie presque physique, comme un besoin, de le recommencer aussitôt –
qu’il comprendra quelle place avait chaque élément de cet ensemble.Confiteor est un roman sournois, intelligent, on en sort effaré d’avoir connu, une fois dans sa vie, une telle expérience de lecture.
