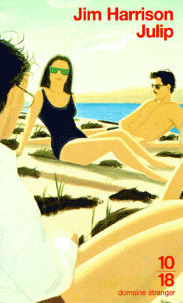 Julip
Au tout début d’un mariage passablement alcoolisé, ses
parents la nommèrent Julip, un mélange de fleur et de cocktail du Sud. Reste à
savoir si elle est plutôt fleur ou plutôt cocktail. On a cent pages pour le
découvrir dans la première des trois nouvelles, avant « L’homme aux deux
cents grammes » (deux cents grammes de quoi ?) et « Le Dolorosa
beige ». Ce sont de brefs romans noirs plutôt que des nouvelles, en fait, dans
lesquels Jim Harrison fait mousser ses personnages et les détails qui les
accompagnent, avec ce tour de main qui n’appartient qu’à lui. Ecrivain-culte
comme John Fante ou Raymond Carver, Jim Harrison possède cette facilité
apparente propre à ces écrivains américains auxquels rien ne semble impossible.
Il y a une sorte de magie qui fascine d’emblée et fonctionne jusqu’au bout de
ses textes.
Julip
Au tout début d’un mariage passablement alcoolisé, ses
parents la nommèrent Julip, un mélange de fleur et de cocktail du Sud. Reste à
savoir si elle est plutôt fleur ou plutôt cocktail. On a cent pages pour le
découvrir dans la première des trois nouvelles, avant « L’homme aux deux
cents grammes » (deux cents grammes de quoi ?) et « Le Dolorosa
beige ». Ce sont de brefs romans noirs plutôt que des nouvelles, en fait, dans
lesquels Jim Harrison fait mousser ses personnages et les détails qui les
accompagnent, avec ce tour de main qui n’appartient qu’à lui. Ecrivain-culte
comme John Fante ou Raymond Carver, Jim Harrison possède cette facilité
apparente propre à ces écrivains américains auxquels rien ne semble impossible.
Il y a une sorte de magie qui fascine d’emblée et fonctionne jusqu’au bout de
ses textes.
 De Marquette à
Veracruz
Trois décennies, est-ce assez pour construire un homme ?
David Burkett se le demande, même s’il sait qu’il s’en est sorti. Sorti de sa
famille devenue trop riche en exploitant la terre et les ouvriers. Sorti des
péchés de son père, des tourments de sa mère, de ses propres frustrations… Formidable
initiation prolongée, le roman grouille de personnages fascinants. Jim Harrison
s’offre un casting parfait, tout droit sorti de son imagination – et peu
coûteux. Il ne masque pas sa préférence pour les femmes, qui sont ici
exceptionnelles (même la mère de David le deviendra). On pense comme lui. Bien
obligé, il ne laisse pas le choix. Les femmes, dont certaines très jeunes, donnent
l’élan au livre et à son héros plein de questions.
De Marquette à
Veracruz
Trois décennies, est-ce assez pour construire un homme ?
David Burkett se le demande, même s’il sait qu’il s’en est sorti. Sorti de sa
famille devenue trop riche en exploitant la terre et les ouvriers. Sorti des
péchés de son père, des tourments de sa mère, de ses propres frustrations… Formidable
initiation prolongée, le roman grouille de personnages fascinants. Jim Harrison
s’offre un casting parfait, tout droit sorti de son imagination – et peu
coûteux. Il ne masque pas sa préférence pour les femmes, qui sont ici
exceptionnelles (même la mère de David le deviendra). On pense comme lui. Bien
obligé, il ne laisse pas le choix. Les femmes, dont certaines très jeunes, donnent
l’élan au livre et à son héros plein de questions.
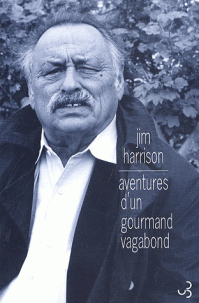 Aventures d’un
gourmand vagabond
Jim Harrison boit du gigondas dans des verres de 33
centilitres. Il préconise, dans les dîners officiels, un magnum de vin par
convive. C’était, il est vrai, dans l’euphorie de l’élection de Bill Clinton à
la présidence. Si cette pratique avait été adoptée, on ne se demanderait plus
si certains chefs d’Etat arrivent ivres à une conférence de presse…
L’écrivain ne recule pas devant la boisson. Ni devant la
nourriture. Les repas qu’il raconte sont pantagruéliques. Et fins. Le gourmand,
comme il se définit lui-même, est aussi un gourmet. Pas de place ici pour le fast
food. Mais une célébration quotidienne de la bonne chère, d’une nourriture
saine et riche bien éloignée des régimes minceurs. Il note pourtant, en 1993, qu’il
a perdu trois livres depuis 1970 et qu’il compte bien continuer à ce rythme, pas
trop contraignant.
La gastronomie serait-elle pour lui une religion ? Bien
mieux : un art de vivre au plus près du meilleur de ce que nous offre la
nature. Dans une parfaite cohérence avec lui-même, Jim Harrison fait mijoter
avec ses plats les autres aspects de l’existence. Et, bien qu’il s’en défende, ses
chroniques gastronomiques fondent une sorte de philosophie.
Aventures d’un
gourmand vagabond
Jim Harrison boit du gigondas dans des verres de 33
centilitres. Il préconise, dans les dîners officiels, un magnum de vin par
convive. C’était, il est vrai, dans l’euphorie de l’élection de Bill Clinton à
la présidence. Si cette pratique avait été adoptée, on ne se demanderait plus
si certains chefs d’Etat arrivent ivres à une conférence de presse…
L’écrivain ne recule pas devant la boisson. Ni devant la
nourriture. Les repas qu’il raconte sont pantagruéliques. Et fins. Le gourmand,
comme il se définit lui-même, est aussi un gourmet. Pas de place ici pour le fast
food. Mais une célébration quotidienne de la bonne chère, d’une nourriture
saine et riche bien éloignée des régimes minceurs. Il note pourtant, en 1993, qu’il
a perdu trois livres depuis 1970 et qu’il compte bien continuer à ce rythme, pas
trop contraignant.
La gastronomie serait-elle pour lui une religion ? Bien
mieux : un art de vivre au plus près du meilleur de ce que nous offre la
nature. Dans une parfaite cohérence avec lui-même, Jim Harrison fait mijoter
avec ses plats les autres aspects de l’existence. Et, bien qu’il s’en défende, ses
chroniques gastronomiques fondent une sorte de philosophie.
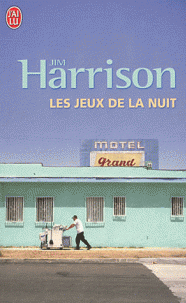 Les jeux de la nuit
Pourquoi Jim Harrison cède-t-il à un fantastique de
pacotille en déclinant paresseusement le thème du loup-garou dans la troisième
nouvelle ? Les deux autres sont bien plus fortes. La fille du fermier, en particulier, la première, où Sarah, blessée
à jamais par le quasi viol qu’elle a subi, décide de se venger et organise la
traque. Pour en arriver à se reconstruire presque malgré elle, grâce à la haine
et à la force intérieure qui l’animent.
Les jeux de la nuit
Pourquoi Jim Harrison cède-t-il à un fantastique de
pacotille en déclinant paresseusement le thème du loup-garou dans la troisième
nouvelle ? Les deux autres sont bien plus fortes. La fille du fermier, en particulier, la première, où Sarah, blessée
à jamais par le quasi viol qu’elle a subi, décide de se venger et organise la
traque. Pour en arriver à se reconstruire presque malgré elle, grâce à la haine
et à la force intérieure qui l’animent.
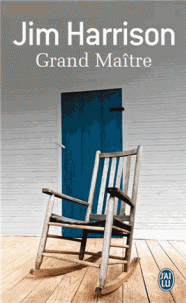 Grand Maître
La retraite ne suffit pas à Sunderson pour renoncer à
traquer le gourou d’une secte sur qui pèsent de forts soupçons de pédophilie. Il
en fait une affaire personnelle. Ainsi que, surtout, un prétexte à mettre de l’ordre
dans sa propre vie : tenter de résister à l’appel du sexe et de l’alcool, retrouver
la sérénité d’un bord de rivière, marcher, pêcher, accepter son âge. Un hymne à
la nature et à l’humanité, dans certaines limites pour celle-ci.
Grand Maître
La retraite ne suffit pas à Sunderson pour renoncer à
traquer le gourou d’une secte sur qui pèsent de forts soupçons de pédophilie. Il
en fait une affaire personnelle. Ainsi que, surtout, un prétexte à mettre de l’ordre
dans sa propre vie : tenter de résister à l’appel du sexe et de l’alcool, retrouver
la sérénité d’un bord de rivière, marcher, pêcher, accepter son âge. Un hymne à
la nature et à l’humanité, dans certaines limites pour celle-ci.
