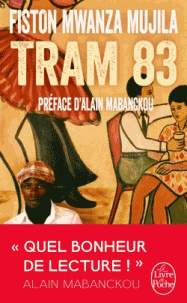 Le roman de Fiston Mwanza Mujila, Tram 83, tranche sur l’habituelle production de premiers romans.
Son sujet est d’abord un lieu, un bar de nuit dans une ville africaine
imaginaire, à côté de la gare du Nord à « la
construction métallique inachevée ». Une clientèle haute en couleurs
boit, drague, fait son business. On ne quitte le bar que pour mieux y revenir.
De cette circulation intense et chaotique au milieu de laquelle un jeune
écrivain tente d’imposer des textes qui n’intéressent personne, le romancier a
restitué le rythme et la musique dans une langue exceptionnelle. Il crée son
monde à travers des mots qu’il a promenés un peu partout entre l’Afrique et
l’Europe, avant de les voir imprimés.
Il était chez lui, à Graz, en Autriche, quand nous l’avons
interrogé. Mais c’est dans les années 90, quand il était étudiant à Lubumbashi
(République démocratique du Congo), où il est né en 1981, qu’il avait commencé
à écrire. La littérature ne s’y portait pas très bien et les centres culturels
étrangers fermaient. Faute de réussir à faire lire ses textes, il les faisait
entendre dans des bars. On est, déjà, presque dans son roman.
D’où vient le titre Tram 83 ?
Le bar se trouvait
près d’une gare et je l’avais d’abord appelé « Train ». Mais ça ne
passait pas, et c’est devenu « Tram », tout court. Et puis, j’ai
découvert qu’une ligne de tram 83, qui circulait la nuit, avait été créée à
Bruxelles en 2008. Je me suis dit que, le samedi soir, la plupart des passagers
étaient peut-être ivres et ça collait bien avec mon roman.
Lucien, l’écrivain,
est le personnage central. Et votre double ?
Il se pose des
questions que je me posais : comment peut-on vivre comme écrivain dans un
pays où tout est en ruine, et comment faire de la littérature autrement ?
Il a l’espoir d’un salut qui pourrait venir d’Europe grâce à son pote qui
habite Porte de Clignancourt, à Paris, mais le salut ne vient pas.
Le salut, s’il s’agit
de publier, pourrait venir de l’éditeur suisse qui traîne dans le même bar.
Mais il est aussi ambigu que le recruteur de jeunes footballeurs africains
interprété par Benoît Poelvoorde dans Les
rayures du zèbre.
Il n’a pas d’alibi
pour être là, au contraire d’un Français ou d’un Belge. Mais, comme il est
suisse, sans liens historiques avec le Congo, on se demande un peu ce qu’il
fait là.
Il participe au
pourrissement de la situation, peut-être ?
Oui, d’une certaine
manière. J’étais devant un dilemme : je ne voulais pas écrire un essai
politique et j’avais envie d’avoir du plaisir en écrivant. Le plaisir est venu
en déconstruisant la langue, en jouant avec les mots. Il m’a permis de quitter
une vision politique et de rester dans un entre-deux, dans ce chaos…
L’écriture a un côté
chanté avec le retour de phrases qui font comme des refrains dans le texte.
Pourquoi ce choix ?
La musique naît, je
crois, de la répétition, en particulier dans le jazz.
Répétition et
variation ?
Oui, et variation,
avec des formes d’improvisation. Tram 83
est un livre qui peut être lu à haute voix et les répétitions lui donnent un
rythme.
Dans ce bar de nuit,
on entend des bribes de conversations. Comment les extraire de la bouillie
sonore qui les environne ?
C’est un bar, un
bordel, un abattoir où on égorge des chiens, un restaurant, une salle de
concert et, dès le début, le chaos est total. Le roman s’est construit progressivement,
par l’émergence d’extraits de conversations. J’avais intégré assez vite cette
phrase qui revient souvent : « Vous avez l’heure ? », par
laquelle les filles de la nuit prennent contact, puis j’ai imbriqué d’autres
interlocuteurs.
Le roman est construit
comme une polyphonie, mais dans la cacophonie…
Oui, oui… [Rires.]
C’est pourquoi il y a plusieurs types de
musiques : le jazz, les musiques cubaines et africaines. C’était important
pour restituer l’atmosphère de ce bar de nuit.
On pense parfois au bar
décrit par Alain Mabanckou dans Verre
cassé, mais en beaucoup plus délirant. Ce rapprochement vous a-t-il
traversé l’esprit ?
Le roman de Fiston Mwanza Mujila, Tram 83, tranche sur l’habituelle production de premiers romans.
Son sujet est d’abord un lieu, un bar de nuit dans une ville africaine
imaginaire, à côté de la gare du Nord à « la
construction métallique inachevée ». Une clientèle haute en couleurs
boit, drague, fait son business. On ne quitte le bar que pour mieux y revenir.
De cette circulation intense et chaotique au milieu de laquelle un jeune
écrivain tente d’imposer des textes qui n’intéressent personne, le romancier a
restitué le rythme et la musique dans une langue exceptionnelle. Il crée son
monde à travers des mots qu’il a promenés un peu partout entre l’Afrique et
l’Europe, avant de les voir imprimés.
Il était chez lui, à Graz, en Autriche, quand nous l’avons
interrogé. Mais c’est dans les années 90, quand il était étudiant à Lubumbashi
(République démocratique du Congo), où il est né en 1981, qu’il avait commencé
à écrire. La littérature ne s’y portait pas très bien et les centres culturels
étrangers fermaient. Faute de réussir à faire lire ses textes, il les faisait
entendre dans des bars. On est, déjà, presque dans son roman.
D’où vient le titre Tram 83 ?
Le bar se trouvait
près d’une gare et je l’avais d’abord appelé « Train ». Mais ça ne
passait pas, et c’est devenu « Tram », tout court. Et puis, j’ai
découvert qu’une ligne de tram 83, qui circulait la nuit, avait été créée à
Bruxelles en 2008. Je me suis dit que, le samedi soir, la plupart des passagers
étaient peut-être ivres et ça collait bien avec mon roman.
Lucien, l’écrivain,
est le personnage central. Et votre double ?
Il se pose des
questions que je me posais : comment peut-on vivre comme écrivain dans un
pays où tout est en ruine, et comment faire de la littérature autrement ?
Il a l’espoir d’un salut qui pourrait venir d’Europe grâce à son pote qui
habite Porte de Clignancourt, à Paris, mais le salut ne vient pas.
Le salut, s’il s’agit
de publier, pourrait venir de l’éditeur suisse qui traîne dans le même bar.
Mais il est aussi ambigu que le recruteur de jeunes footballeurs africains
interprété par Benoît Poelvoorde dans Les
rayures du zèbre.
Il n’a pas d’alibi
pour être là, au contraire d’un Français ou d’un Belge. Mais, comme il est
suisse, sans liens historiques avec le Congo, on se demande un peu ce qu’il
fait là.
Il participe au
pourrissement de la situation, peut-être ?
Oui, d’une certaine
manière. J’étais devant un dilemme : je ne voulais pas écrire un essai
politique et j’avais envie d’avoir du plaisir en écrivant. Le plaisir est venu
en déconstruisant la langue, en jouant avec les mots. Il m’a permis de quitter
une vision politique et de rester dans un entre-deux, dans ce chaos…
L’écriture a un côté
chanté avec le retour de phrases qui font comme des refrains dans le texte.
Pourquoi ce choix ?
La musique naît, je
crois, de la répétition, en particulier dans le jazz.
Répétition et
variation ?
Oui, et variation,
avec des formes d’improvisation. Tram 83
est un livre qui peut être lu à haute voix et les répétitions lui donnent un
rythme.
Dans ce bar de nuit,
on entend des bribes de conversations. Comment les extraire de la bouillie
sonore qui les environne ?
C’est un bar, un
bordel, un abattoir où on égorge des chiens, un restaurant, une salle de
concert et, dès le début, le chaos est total. Le roman s’est construit progressivement,
par l’émergence d’extraits de conversations. J’avais intégré assez vite cette
phrase qui revient souvent : « Vous avez l’heure ? », par
laquelle les filles de la nuit prennent contact, puis j’ai imbriqué d’autres
interlocuteurs.
Le roman est construit
comme une polyphonie, mais dans la cacophonie…
Oui, oui… [Rires.]
C’est pourquoi il y a plusieurs types de
musiques : le jazz, les musiques cubaines et africaines. C’était important
pour restituer l’atmosphère de ce bar de nuit.
On pense parfois au bar
décrit par Alain Mabanckou dans Verre
cassé, mais en beaucoup plus délirant. Ce rapprochement vous a-t-il
traversé l’esprit ?Pas en écrivant le roman. Mais plus tard, oui, en me relisant. J’étais influencé par le milieu d’où je viens : mon grand-père a tenu une boîte de nuit, un bar, pendant plus de 35 ans, mes parents ont vendu de la bière, j’ai travaillé comme serveur pour financer mes études et j’ai grandi à côté d’une brasserie. Donc, la bière a fait partie de mon environnement, même si, quand nous étions enfants et que nous allions chez les grands-parents, on nous interdisait d’y toucher. Du coup, il y avait une certaine fascination…
